Titres de séjour pour motif professionnel ou d’études : mise à jour de la partie règlementaire du Ceseda
30/06/2025
Un décret du 13 juin 2025 adapte la partie règlementaire du Ceseda à la loi “immigration” et à la directive “carte bleue européenne”. La plupart des modifications concernent les titres de séjour “talent”, “recherche d’emploi-création d’entreprise” et “entrepreneur profession libérale”.
Un long décret relatif aux cartes de séjour “talent” et modifiant certaines dispositions du Ceseda relatives aux cartes de séjour “recherche d’emploi-création d’entreprise” et “entrepreneur et profession libérale” est entré en vigueur le 16 juin 2025. Il vise notamment à mettre en œuvre certaines dispositions de la loi “immigration” du 26 janvier 2024, pour tirer les conséquences, d’une part, du changement de dénomination du dispositif “passeport talent” en “talent”, de la fusion à droit constant sous un titre de séjour unique mention “talent – salarié qualifié” et “talent – porteur de projet” de six motifs de séjour et, d’autre part, de la création d’une nouvelle carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – profession médicale et de la pharmacie”.
En complément de la loi du 30 avril 2025, relative notamment à la carte “talent-carte bleue européenne”, le décret transpose également dans la partie réglementaire du Ceseda (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) les dispositions de la directive (UE) 2021/1883 du 20 octobre 2021 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, qui s’est substitué à la directive 2009/50/CE du Conseil.
Enfin, le décret rétablit au niveau règlementaire un certain nombre de dispositions qui avaient été supprimées lors de la recodification du Ceseda intervenue le 1er mai 2021 : seuils de rémunération pour la délivrance de certaines cartes de séjour pluriannuelles portant la mention “talent”, conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire mention “recherche d’emploi ou création d’entreprise”, mention des étrangers titulaires d’une convention de séjour de recherche.
► En complément de ce décret, un arrêté est attendu afin de mettre à jour la liste des pièces justificatives à fournir à l’appui d’une demande de titre de séjour, liste qui figure en annexe 10 du Ceseda. Notons également que l’article 6 du texte est consacré à l’application des dispositions du décret à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie.
Cartes de séjour pluriannuelles “talent”
Fusion de cartes “talent”
La partie règlementaire du Ceseda est mise à jour des modifications résultant de la fusion par la loi “immigration” du 26 janvier 2024 :
- des trois catégories de cartes délivrées à des salariés qualifiés (diplômés master, jeune entreprise innovante, salarié en mission mobilité intragroupe) en une seule dénommée “talent-salarié qualifié” ;
- des cartes en lien avec la création d’entreprise et les investissements (“création d’entreprise”, “projet économique innovant” et “investissement économique direct”) en une carte unique mention “talent-porteur de projet”.
En outre, la partie règlementaire du Ceseda et le code du travail sont modifiés pour prendre en compte le changement de dénomination des cartes “passeport talent” devenus “talent” depuis la loi de 2024 (articles 2, 3 et 7 du décret).
Carte de séjour pluriannuelle “talent-carte bleue européenne”
Le décret modifie également la partie règlementaire du Ceseda afin de tenir compte des dispositions de la directive (UE) 2021/1883 et de l’article 40 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, qui a transposé cette directive dans la partie législative du code.
Le décret ajoute notamment cinq nouvelles mentions sur les cartes “talent-carte bleue européenne” (article R.421-21 B du code des étrangers), selon que la carte est délivrée à un étranger :
- qui bénéficie de la protection internationale accordée par la France ou par un autre Etat membre ;
► Est ainsi transposée la possibilité pour les bénéficiaires d’une protection internationale hautement qualifiés de demander une carte bleue européenne dans l’Etat membre qui leur a accordé la protection internationale mais aussi dans les autres États membres (directive (UE) 2021/1883, article 9, § 4 et 5).
- sur la base de compétences professionnelles élevées pour une profession non énumérée à l’annexe I de la directive (UE) 2021/1883 ;
► Cette annexe vise les managers et les spécialistes des technologies de l’information et de la communication qui ont acquis au moins trois ans d’expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande de carte bleue européenne.
- qui bénéficie de la protection internationale accordée par la France ou par un autre Etat membre et possède des compétences professionnelles élevées pour une profession non énumérée à l’annexe I de la directive (UE) 2021/1883.
S’agissant des délais de délivrance de cette carte « talent », il est précisé (article R.421-23 du code des étrangers) :
- la décision de l’administration sur la demande de carte de séjour est notifiée au plus tard 90 jours après la date d’introduction de la demande complète. Comme auparavant, le silence gardé sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme de ce délai ;
- en cas de mobilité, si l’étranger est titulaire d’une “carte bleue européenne” en cours de validité délivrée par un autre Etat membre, la décision est notifiée à l’étranger et au premier Etat membre au plus tard 30 jours après la date d’introduction de la demande complète. En cas de circonstances exceptionnelles justifiées par la complexité de la demande, le délai peut être prolongé de 30 jours (l’étranger en est alors informé). Par dérogation à l’article R.432-2 du Ceseda, le silence gardé sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de 30 jours suivant le dépôt de la demande complète ou la prolongation.
L’article R.421-37-7 précise ensuite les délais de délivrance de la carte “talent (famille)” selon qu’elle est demandée en même temps que la carte “talent-carte bleue européenne” ou postérieurement. Ainsi, en cas de demandes simultanées, les décisions du préfet sont notifiées en même temps ou au plus tard dans un délai de 90 jours après le dépôt des demandes complètes. En cas de demande complète postérieure à celle du titulaire de la carte « talent-carte bleue européenne », la décision du préfet est notifiée dans un délai de 90 jours après son dépôt.
► Le même article précise les délais en cas de mobilité, lorsque la famille était déjà constituée dans un Etat membre de l’Union européenne où elle était admise au séjour.
Autorisation provisoire de séjour
Dans l’attente de la délivrance d’un titre “talent”, l’article R.421-11 du Ceseda prévoit que le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois, l’objectif étant de faciliter la mobilité des publics concernés. Le décret ajoute qu’elle ouvre le droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
Seuils de rémunération requis
Le décret rétablit également dans le Ceseda la mention des seuils de rémunération pour la délivrance de certaines cartes de séjour pluriannuelles portant la mention “talent”. En effet, depuis la recodification du code intervenue le 1er mai 2021, la partie règlementaire du code ne contenait plus ces seuils de rémunération. Certains étaient mentionnés dans l’annexe 10 issue de l’arrêté du 4 mai 2022 (qui fixe la liste des pièces justificatives à fournir à l’appui d’une demande de titre de séjour) tandis que d’autres n’étaient plus fixés par aucun texte.
► Rappelons, s’agissant de la carte “talent-carte bleue européenne”, que le tribunal administratif de Nantes avait annulé un refus de délivrer un visa de long séjour “talent-carte bleue européenne” considérant que la condition relative à la rémunération minimale n’était pas opposable, faute de décret d’application (tribunal administratif de Nantes, 30 octobre 2023, n° 2215675).
Les seuils requis sont les suivants :
- carte “talent salarié qualifié” : l’étranger doit justifier d’une rémunération annuelle brute au moins égale au montant du salaire brut moyen annuel de référence fixé par arrêté du ministre en charge de l’immigration (arrêté à paraître) (article R.421-16 A du code des étrangers) ;
- carte “talent-carte bleue européenne” : conformément à ce que prévoit l’article L.421-11 du Ceseda, issu de l’article 40 de la loi du 30 avril 2025, l’étranger doit justifier d’une rémunération annuelle brute au moins égale à 1,5 fois le montant du salaire brut moyen annuel de référence fixé par arrêté du ministre en charge de l’immigration (arrêté à paraître) (article R.421-21 A du code des étrangers) ;
► Si l’étranger diplômé au niveau master justifie être déjà titulaire d’un titre de séjour portant la mention “talent-salarié qualifié” “après vérifications de ses qualifications professionnelles élevées pertinentes”, il n’est pas tenu de présenter à nouveau les documents attestant qu’il possède ces qualifications (article R.421-21 A du code des étrangers).
- carte “talent-profession médicale et de la pharmacie” : l’étranger doit justifier d’une rémunération annuelle brute dont le montant est au moins égal au deuxième échelon de la grille des émoluments des praticiens associés fixé, conformément aux dispositions du 1° de l’article R.6152-912 du code de la santé publique, par arrêté (article R.421-25-1 du code des étrangers). Ce montant est actuellement fixé à 41 386,48 euros (arrêté du 8 juillet 2022, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 7 mars 2025) ;
- carte “talent-porteur de projet” aux étrangers diplômés niveau master ou pouvant attester d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable et qui justifient d’un projet économique réel et sérieux et créent une entreprise en France (article L.421-16, 1° du code des étrangers) : l’étranger doit justifier de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille au moins égales au salaire minimum de croissance brut annuel à temps plein (21 621,60 euros en 2025). En outre, il doit justifier d’un financement du projet d’entreprise au moins égal à 30 000 euros (articles R.421-33-1 et R.421-33-2 du code des étrangers) ;
- carte “talent-porteur de projet” délivré pour un projet économique innovant (article L.421-16, 2° du code des étrangers) : l’étranger doit justifier de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de famille au moins égales au salaire minimum de croissance brut annuel à temps plein (article R.421-34-2 du code des étrangers).
Le seuil de rémunération est également rétabli pour les cartes “talent” accordées aux mandataires sociaux (article R.421-37 du code des étrangers), aux artistes interprètes ou auteurs d’une œuvre littéraire ou artistique (article R. 421-37-2 du code des étrangers), ou en raison d’une renommée nationale ou internationale (article R. 421-37-4 du code des étrangers).
Professions réglementées
Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent”, “talent-salarié qualifié”, “talent-carte bleue européenne”, “talent-profession médicale et de la pharmacie”, “talent-chercheur”, “talent-chercheur-programme de mobilité” ou “talent-porteur de projet” pour l’exercice d’une profession réglementée, il est tenu de justifier qu’il satisfait aux conditions légales et règlementaires d’exercice de l’activité considérée (article R.421-15-1 du code des étrangers).
Carte de séjour temporaire “recherche d’emploi ou création d’entreprise”
Lorsque l’étranger qui demande à bénéficier d’une carte “recherche d’emploi ou création d’entreprise” a été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle “étudiant”, il doit justifier avoir obtenu, au cours des douze derniers mois, un diplôme français conférant, a minima, le grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (article R.422-14 du code des étrangers).
Il est souligné dans l’objet du décret que cette disposition rétablit au niveau règlementaire une condition de délivrance de la carte de séjour temporaire « recherche d’emploi ou création d’entreprise » déclassée en arrêté à l’occasion de la recodification.
► Depuis la recodification, cette exigence avait disparu et n’était mentionnée qu’à l’annexe 10 du Ceseda, rubrique 26. La cour administrative d’appel de Lyon avait toutefois jugé que le ministre de l’intérieur n’était pas compétent pour fixer cette condition non prévue par les dispositions législatives ou règlementaires du Ceseda (CAA Lyon, 6 avr. 2023, n° 23LY00870).
Carte de séjour temporaire “entrepreneur – profession libérale”
Préalablement au dépôt de sa demande de délivrance de la carte de séjour portant la mention “entrepreneur-profession libérale”, l’étranger doit désormais solliciter un avis sur la viabilité économique de l’activité non salariée auprès du service en charge de la main-d’œuvre étrangère compétent pour le département dans lequel il souhaite réaliser cette activité (article R.421-9 du code des étrangers).
Remarque : cette condition n’était jusqu’alors prévue que pour la création d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale et non libérale.
Etranger titulaire d’une convention de séjour de recherche
La carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant” est délivrée à l’étranger qui a signé, afin de se former à la recherche et par la recherche, la convention de séjour de recherche prévue à l’article L. 434-1 du code de la recherche, dont le financement n’atteint pas un certain seuil fixé à l’article R.421-27-1 (article R.422-15 du code des étrangers).
Ce seuil est celui qui permet d’obtenir la délivrance d’une carte “talent chercheur” (article L.421-14 du code des étrangers). La convention d’accueil peut être conclue par l’étranger qui a signé la convention de séjour de recherche prévue à l’article L.434-1 du code de la recherche et qui bénéficie d’un financement au moins équivalent à la rémunération minimale, hors prise en compte des charges sociales afférentes, fixée par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche portant rémunération des doctorants (article R.421-27-1 du code des étrangers).
► Il est précisé dans l’objet du décret que ces dispositions réintroduisent celles de l’article 12, III de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020, qui avaient été abrogées par l’entrée en vigueur, le 1er mai 2021, de l’ordonnance de recodification du Ceseda.
Disposition procédurale visant l’ensemble des titres de séjour en cas de pièces et informations manquantes
Pour l’ensemble des demandes de titres de séjour, le décret du 13 juin 2025 ajoute à l’article R.431-11 du Ceseda (qui prévoit déjà que l’étranger doit présenter à l’appui de sa demande de titre de séjour les pièces justificatives dont la liste est fixée par l’annexe 10 du code), qu’en cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable.
Véronique Baudet-Caille
De la lutte contre les stéréotypes à l’amélioration des conditions de travail, un guide pratique pour favoriser l’emploi des seniors
30/06/2025
Réalisé par le ministère du travail, en partenariat avec l’Association nationale des directeurs de ressources humaines (ANDRH) et l’association “Les entreprises qui s’engagent”, ce guide, mis à jour le 25 juin, a pour objectif d’accompagner les DRH dans la mise en place de leur politique RH intergénérationnelle. Précisons qu’il comprend peu d’informations au sujet du CSE, mais sa lecture pourra être utile néanmoins aux représentants du personnel.
Le document de 88 pages est organisé en cinq étapes clés du parcours professionnel des salariés de 50 ans et plus :
- la lutte contre les stéréotypes liés à l’âge ;
- le recrutement et l’intégration ;
- l’accompagnement des parcours ;
- le maintien dans l’emploi et l’amélioration des conditions de travail ;
- la fin de carrière vers la retraite.
Chaque partie fournit aux employeurs des pistes d’action directement mobilisables : mesures concrètes, dispositifs existants, outils pratiques, témoignages et retours d’expériences.
On y retrouve pêle-mêle les problématiques liées à l’usure professionnelle, à la désinsertion, à la transition activité retraite, au mécénat de fin de carrières ou encore un focus sur la prestation de conseil en ressources humaines (PCRH).
Le guide comprend les témoignages de L’Oréal, de Lidl, de Schneider Electric France ou encore de Transdev et de NGE.
À noter : ce guide sera régulièrement mis à jour, notamment pour intégrer les évolutions législatives. Le projet de loi transposant l’accord national interprofessionnel sur les salariés expérimentés de novembre dernier est en cours d’examen à l’Assemblée nationale. Y figurent, par exemple, de nouveaux dispositifs comme le contrat de valorisation de l’expérience. Un CDI réservé aux salariés de plus de 60 ans au chômage qui permet à l’employeur de mettre fin au contrat dès que le salarié atteint l’âge et les trimestres requis pour une retraite à taux plein.
Un demandeur d’emploi de plus de 50 ans reste 600 jours au chômage en moyenne, soit deux fois plus qu’une personne de moins de 50 ans.
Source : actuel CSE
DROITS DU SALARIÉ PROTÉGÉ
L’utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel
30/06/2025

À l’issue de ses heures de délégation, le représentant du personnel doit bénéficier du temps habituel de repos quotidien dans les mêmes proportions que s’il s’était trouvé sur son poste de travail.
Les heures de délégation, c’est du temps de travail effectif ! Le représentant du personnel ne doit donc subir aucune perte de salaire, et ne doit être privé d’aucun avantage légal ou conventionnel, sous prétexte qu’il était en délégation, et non à son poste de travail.
Dans cette affaire, l’employeur estimait que le temps de repos quotidien de 16 heures prévu par l’accord RTT de l’entreprise au profit des travailleurs postés ne s’imposait “qu’entre deux postes de travail”. Il n’avait donc à accorder ce temps de repos au représentant du personnel à l’issue de ses heures de délégation.
À tort décident les juges dans un arrêt du 4 juin 2025.
Le temps de délégation est un temps de travail
Comme le rappelle la Cour de cassation, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale. Il en résulte que l’utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical.
Ainsi, dès lors que le salarié était en travail posté et bénéficiait habituellement du repos quotidien de 16 heures, il avait bien droit à ce temps de repos “à l’issue de l’utilisation de ses heures de délégation, jusqu’à sa reprise de poste”.
► Remarque : lorsque la convention collective prévoit au bénéfice des salariés travaillant 8 heures consécutives de jour ou de nuit une pause rémunérée de 30 minutes, que le représentant du personnel a droit à sa demi-heure de pause rémunérée dès lors qu’il a effectué 8 heures consécutives de délégation ou de travail (Cass. soc., 26 juin 2001, n° 98-46.387).
Frédéric Aouate
Ce qui change au 1er juillet 2025 en droit du travail et de la protection sociale
01/07/2025
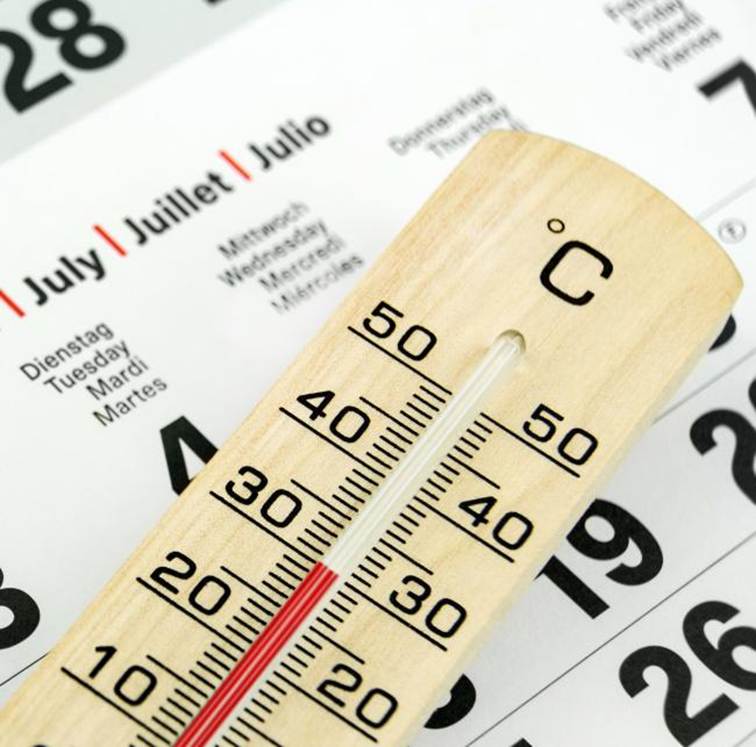
Plusieurs changements sont à noter ce 1er juillet 2025 en matière d’apprentissage, arrêts-maladie, avis d’inaptitude, obligation de sécurité en cas de canicule, revalorisation des allocations chômage et versement mobilité. Nous vous présentons, sous la forme d’un tableau, une synthèse de ces mesures.
| Thème | Contenu de la mesure | Textes de référence et articles |
| Apprentissage, mesures sur le financement | Contribution obligatoire de l’employeur au financement de l’apprentissage de 750 € par contrat (recouvrée par les CFA, les centres de formation des apprentis) : ce qui minore la participation de l’Opco (opérateur de compétences) Proratisation du financement au jour près : fin du principe “tout mois commencé = mois dû” 10 % du financement total est désormais versé après réalisation effective de la formation (pour éviter les trop-perçus en cas de rupture anticipée du contrat) Remarque : au 1er novembre 2025 (ou date antérieure fixée par arrêté, minoration de 20 % de la prise en charge par l’Opco en cas de formation en distanciel (D. n° 2025-586, 27 juin 2025 : JO, 29 juin) | Décret n° 2025-585, 27 juin 2025 : JO, 29 juin Loi de finances n° 2025-127, 14 févr. 2025 : JO, 15 févr |
| Formulaire papier des arrêts maladie | Tout arrêt de travail débutant ou prolongé à compter du 1er juillet 2025, s’il est établi sous format papier, doit être prescrit au moyen d’un formulaire homologué sur papier sécurisé, fourni par la Cpam (caisse primaire d’assurance maladie). Ce n’était que facultatif depuis septembre 2024. En conséquence, les arrêts de travail scannés, photocopiés, imprimés depuis un logiciel de prescription seront rejetés par la Cpam, après une période de tolérance de 2 mois, soit à compter du 1er septembre 2025 | Décret n° 2025-587, 27 juin 2025 : JO, 29 juin Actu Ameli, 22 avr. 2025 Communiqué Amelin 27 juin 2025 |
| Formulaires des avis d'(in)aptitude | À l’issue des visites médicales auprès du service de prévention et de santé au travail effectuées à compter du 1er juillet 2025, seront délivrés de nouveaux avis d'(in)aptitude et d’attestation de suivi. À noter, que le nouveau modèle de l’avis d’inaptitude précise que, lorsque l’un des deux cas de dispense légale de reclassement est coché, qu’il s’agit “d’un cas exceptionnel privant le salarié de son droit à reclassement par l’employeur et actant son licenciement sans consultation du CSE sur les propositions de reclassement” | Arrêté du 3 mars 2025 : JO, 14 mars 2025 |
| Saisie sur salaire | Ce sont désormais les commissaires de justice qui mettent en œuvre les demandes de saisie de salaires initiées à compter du 1er juillet 2025. Pour les saisies en cours au 1er juillet, elles ne doivent plus être versées au greffe du tribunal ; la procédure de saisie est suspendue. L’employeur doit verser l’intégralité de la rémunération jusqu’à ce que le commissaire de justice, après avoir contacté le créancier, remette un nouvel acte de saisie sur salaire. | Loi n°2023-1059, 20 nov. 2023 Décret n° 2025-125, 13 févr. 2025 |
| Obligation de sécurité en cas de canicule | L’employeur doit mettre en place, dès le 2 juillet 2025, de nouvelles mesures de prévention pour les salariés exposés aux risques de chaleur intense (aménagement des lieux de travail, recours à des ventilateurs ou autres, accès facilité à l’eau fraîche, intégration du risque dans le Duerp, le document unique d’évaluation des risques professionnels) | Décret n° 2025-482, 27 mai 2025 : JO, 1er juin Arrêté 27 mai : JO, 1er juin |
| Versement mobilité | Les taux et les périmètres du versement mobilité sont modifiés au 1er juillet 2025 | Lettre circ., URSSAF, n° 2025-0000001, 27 mai 2025 |
| Allocations chômage | Les allocations chômage sont revalorisées de 0,5 % au 1er juillet | Communiqué Unedic du 25 juin 2025 |
Nathalie Lebreton
Arrêts de travail : l’utilisation d’un formulaire sécurisé devient obligatoire
01/07/2025
Un décret du 28 juin 2025 entérine l’obligation de recourir à un formulaire Cerfa sécurisé à compter du 1er septembre 2025, compte tenu d’une tolérance de 2 mois accordée par l’administration. L’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié.
Il prévoit désormais que lorsque l’arrêt de travail n’est pas prescrit ou prolongé de manière dématérialisée, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance-maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, un avis d’interruption de travail ou de prolongation d’interruption, indiquant, d’après les prescriptions du professionnel de santé, la durée probable de l’incapacité de travail.
Cet avis est établi par le professionnel de santé au moyen d’un formulaire qui répond à des spécifications techniques qui en permettent l’authentification.
L’assuré doit faire parvenir l’avis à la CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie) en envoyant l’original du formulaire signé que lui remet le professionnel de santé.
Source : actuel CSE
L’avenant qui adapte la convention CSP à la convention d’assurance chômage de 2024 est agréé
01/07/2025
Un arrêté du 27 juin 2025 agrée l’avenant n° 10 du 20 mars 2025 à la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui vise à apporter les adaptations nécessaires, afin de mettre en cohérence la réglementation générale issue de la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage et la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle.
Source : actuel CSE
Davantage de protection pour tous les salariés engagés dans un parcours de PMA ou d’adoption
02/07/2025

La loi visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental contre les discriminations a été publiée hier au Journal officiel. Elle prévoit une protection pour tous les salariés engagés dans un parcours de PMA ou d’adoption et leur octroie des autorisations d’absence.
La loi du 30 juin 2025 visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail a été publiée hier au Journal officiel. Elle étend la protection contre les discriminations dont bénéficiaient déjà les femmes engagées dans un parcours de procréation médicalement assistée (PMA) à tous les salariés engagés dans un projet parental dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation ou d’une adoption et renforce cette protection. Elle étend en outre le périmètre des personnes pouvant bénéficier d’autorisations d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux ou administratifs nécessaires à la poursuite d’un projet parental.
► Rappelons que ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis au titre de l’ancienneté dans l’entreprise (article L.1225-16 du code du travail).
Tout salarié engagé dans un projet parental bénéfice d’une protection contre les discriminations
Actuellement, les salariées bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation conformément à l’article L.2141-2 du code de la santé publique bénéficient de la protection prévue aux articles L.1225-1, L.1225-2 et L.1225-3 du code du travail accordée aux femmes enceintes (article L.1225-3-1 du code du travail).
Il en résulte que :
- il est interdit à l’employeur de prendre en considération le fait qu’une femme bénéficie d’une assistance médicale à la procréation pour refuser de l’embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d’une période d’essai ou pour prononcer une mutation d’emploi, sauf affectation temporaire si son état de santé médicalement constaté l’exige, en cas de travail de nuit ou d’exposition à des risques particuliers. Il lui est donc interdit de rechercher ou faire rechercher toutes informations sur ce sujet ;
- la femme candidate à un emploi ou salariée peut ne pas révéler qu’elle bénéficie d’une telle assistance, sauf lorsqu’elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives à sa protection ;
- en cas de litige relatif aux deux premiers points et lorsqu’un doute subsiste, le doute profite à la salariée.
La loi modifie l’article L.1225-3-1 du code du travail afin d’étendre cette protection, jusqu’alors réservée aux seules salariées, à tous les salariés, femmes ou hommes, engagés dans un projet parental dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation ainsi qu’à tous ceux engagés dans une procédure d’adoption.
La loi rend, en outre, applicable à ces mêmes salariés la protection contre les discriminations prévue à l’article L.1142-1 du code du travail relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes.
Ainsi, il est désormais interdit de :
- faire référence dans une offre d’emploi au parcours de PMA ou d’adoption, cette interdiction étant applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ;
- refuser d’embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d’un salarié en considération de son engagement dans un projet parental dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation ou d’une adoption ;
- prendre, en considération de ce même engagement, toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
L’article L.1225-3-1 du code du travail est complété en ce sens.
► On relèvera que l’article 1 de la loi a profondément évolué par rapport à sa rédaction initiale. Il prévoyait en effet initialement de modifier l’article L.1132-1 du code du travail relatif au principe de non-discrimination et l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit européen dans le domaine de la lutte contre les discriminations pour y ajouter la mention explicite du “projet parental” comme motif interdit de discrimination. Toutefois, ce texte a été amendé au stade de l’examen en commission à l’Assemblée nationale. Il ressort en effet de l’exposé sommaire de l’amendement que les auditions conduites par la rapporteure, de même que les contributions qui lui ont été adressées, ont permis de souligner l’importance de renforcer la protection de toutes les personnes engagées dans un projet parental, dans le cadre professionnel, mais sans nécessairement créer un nouveau critère de discrimination tel que proposé dans l’écriture initiale de la proposition de loi. En effet, l’article L.1132-1 du code du travail protège les salariés contre les discriminations au travail, notamment pour des motifs liés au sexe, à l’orientation sexuelle, à l’identité du genre, à la situation de famille, à la grossesse ou à l’état de santé. En outre, préciser les motifs de discrimination tend à restreindre le champ d’application, et peut entraîner des interprétations a contrario, finalement défavorables aux requérants.
Des autorisations d’absence pour les actes médicaux nécessaires ou les entretiens obligatoires
L’article L.1225-16 du code du travail prévoit actuellement que :
- la salariée bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation peut s’absenter pour les actes médicaux nécessaires ;
- le conjoint salarié de la femme bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle a également doit à une autorisation d’absence pour se rendre à trois de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale au maximum.
L’article 2 de la loi étend le périmètre des salariés susceptibles de bénéficier de ces autorisations d’absences. Ainsi, les autorisations d’absence pour les actes médicaux nécessaires dans le cadre du parcours de PMA sont étendues à tous les salariés, femmes ou hommes. Celles allouées jusqu’à présent au conjoint de la femme bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation le sont au conjoint de l’homme bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation.
► L’article 2 de la loi a été introduit par un amendement au stade de l’examen en commission à l’Assemblée nationale. Celui-ci proposait, selon son exposé sommaire, de dégenrer les alinéas 2 et 3 de l’article L.1225-16 du code du travail relatifs aux autorisations d’absence dans le cadre d’une PMA afin de permettre aux hommes d’en bénéficier lorsqu’ils doivent faire l’objet d’examens médicaux, d’interventions ou de traitement en lien avec l’assistance médicale à la procréation, et à leur compagne de les accompagner le cas échéant. En effet, le droit actuel traite les hommes comme de simples accompagnants de leur compagne au cours du processus de PMA. Or, dans la mesure où 30 % des infertilités sont d’origine masculine, ils peuvent être amenés à recevoir des traitements médicaux, et donc à s’absenter de leur travail en dehors des examens auxquels ils peuvent accompagner leur conjoint(e).
Enfin, l’article L.1225-16 du code du travail est complété d’un nouvel alinéa prévoyant que les salariés engagés dans une procédure d’adoption bénéficient d’autorisations d’absence pour se présenter aux entretiens obligatoires nécessaires à l’obtention de l’agrément prévu à l’article L.225-2 du code de l’action sociale et des familles. Un décret déterminera le nombre de ces autorisations.
Valérie Dubois
Vote des salariés mis à disposition : la communication du nom des entreprises extérieures ne suffit pas
03/07/2025

L’employeur doit fournir aux syndicats les éléments nécessaires au contrôle des effectifs et de l’électorat. S’agissant des travailleurs mis à sa disposition, il ne peut pas se contenter de transmettre la liste des entreprises extérieures.
Les salariés mis à disposition par une entreprise sous-traitante ou prestataire de service doivent être pris en compte dans l’effectif de l’entreprise utilisatrice s’ils sont présents dans ses locaux au jour du décompte et y travaillent depuis au moins un an (article L. 1111-2 du code du travail).
Ils peuvent y voter pour l’élection du comité social et économique (CSE) s’ils y sont présents depuis 12 mois continus. Ils ne peuvent en revanche se porter candidat et être élus (art. L. 2314-23).
Tant pour le calcul de l’effectif que pour l’établissement des listes électorales, il est normal que les organisations syndicales chargées de négocier le protocole préélectoral (PAP) disposent d’informations suffisamment précises sur les travailleurs mis à disposition. Elles doivent notamment savoir dans quelle entreprise ils souhaitent voter. L’entreprise qui les détache ou l’entreprise qui les accueille ?
La fourniture d’éléments précis
Comme le rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 18 juin 2025 (voir déjà Cass. soc., 26 mai 2010, n° 09-60.400), l’employeur ne peut pas se contenter d’interroger les entreprises extérieures mettant des salariés à sa disposition des salariés. Pour la négociation du protocole d’accord préélectoral, il doit “fournir aux organisations syndicales les éléments dont il dispose ou dont il peut demander judiciairement la production par ces entreprises”.
► Remarque : le refus de l’employeur de mettre à disposition des syndicats les informations nécessaires à la négociation du protocole d’accord préélectoral (PAP) constitue un manquement à son obligation de négociation loyale et, donc, une cause de nullité du PAP et des élections (Cass. soc., 9 oct. 2019, n° 19-10.780).
Les noms des salariés remplacés par le nom de l’entreprise !
Or, dans cette affaire, un syndicat faisait valoir “qu’à la place du nom de 93 salariés mis à disposition, l’employeur avait mentionné 93 fois le nom d’entreprises”. Il était également reproché à l’entreprise utilisatrice d’avoir omis dans l’effectif des centaines d’agents de différentes sociétés “apparaissant sur la liste des prestataires sans aucune trace de leurs salariés dans le décompte”. Non seulement “le total de l’effectif en était faussé” et “ces salariés n’avaient, de plus, pas pu exprimer un choix de vote”.
Le tribunal judiciaire ne pouvait donc pas valider le protocole préélectoral sans rechercher “si tous les salariés mis à disposition et remplissant les conditions légales pour exercer une option avaient été mis en mesure de l’exercer”.
Frédéric Aouate
Droit du salarié de se taire pendant l’entretien préalable : “une telle décision est de nature à bouleverser les pratiques”
03/07/2025

La Cour de cassation vient de transmette au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le droit à se taire du salarié lors de son entretien préalable à un licenciement disciplinaire. Sébastien Millet, avocat associé au sein du cabinet Ellipse Avocats, répond aux questions que suscite cette QPC.
Le salarié pourra-t-il bientôt faire valoir son droit au silence lors de l’entretien préalable de licenciement disciplinaire ? Par une décision du 20 juin 2025, la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative au droit disciplinaire. Il est demandé aux Sages de trancher ces deux questions :
- “Les dispositions de l’article L.1332-2 du code du travail, en ce qu’elles ne prévoient pas la notification aux salariés faisant l’objet d’une sanction disciplinaire, de leur droit de se taire durant leur entretien, portent-elles atteinte aux droits garantis par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ?” ;
- “Les dispositions combinées des articles L.1232-3 et L.1332-2 du code du travail, en ce qu’elles ne prévoient pas la notification aux salariés faisant l’objet d’une procédure de licenciement disciplinaire, de leur droit de se taire durant leur entretien préalable, portent-elles atteinte aux droits garantis par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ?”.
Le Conseil constitutionnel dispose de trois mois pour y répondre et une réponse positive bouleverserait notre droit du travail et les pratiques actuelles. Sébastien Millet, avocat associé au sein du cabinet Ellipse Avocats, analyse de manière prospective la portée de cette QPC. Interview.
L’émergence du droit de se taire pour le salarié vous surprend-elle ?
Non, car le droit de se taire est omniprésent que ce soit en droit pénal, mais aussi en droit administratif par exemple dès lors qu’une sanction est susceptible d’être prononcée. Très récemment le Conseil d’État a acté ce droit au silence pour les agents publics. Le droit au silence n’est pas purement jurisprudentiel ; il y a un ancrage constitutionnel avec l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC). Il n’y a dès lors pas de raison que ça ne puisse pas s’appliquer en droit du travail dès lors que ce principe s’applique à toute sanction présentant le caractère d’une punition, et ce dans un contexte jurisprudentiel de forte évolution autour de la protection des droits fondamentaux.
| Dans sa décision du 4 octobre 2024, le Conseil constitutionnel a ainsi indiqué : “Aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : “Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que le professionnel faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire”. |
Le Conseil constitutionnel pourrait très bien émettre une réserve d’interprétation sur les articles L.1232-3 et L.1332-2 du code du travail. Si leur rédaction n’est pas contraire aux principes de droit du travail, ces dispositions pourraient ne trouver application que sous réserve du respect du droit au silence. Il semble difficile d’imaginer que la position du Conseil constitutionnel puisse être “circulez il n’y a rien à voir”. Ce serait vraiment très surprenant.
Quel impact aurait la consécration d’un droit à se taire en droit du travail ?
Une telle décision est de nature à bouleverser les pratiques aussi bien procédurales que rédactionnelles, tout particulièrement en matière de licenciement disciplinaire, même si la question pourrait se poser pour des sanctions moindres dès lors qu’elles sont soumises à des garanties de procédure.
Le but de l’entretien préalable de licenciement est de permettre au salarié de fournir des explications et de faire valoir ses droits ; il a toujours intérêt à venir s’expliquer afin soit d’éviter une sanction, soit d’obtenir une sanction moindre. Toutefois, dans certains cas, le salarié peut préférer garder le silence. C’est notamment le cas si les faits sont de nature à donner lieu à des poursuites pénales où le droit à ne pas s’auto-incriminer prend toute son importance Il peut décider de réserver ses explications pour le juge comme en matière pénale. Ce peut être aussi un droit au silence partiel ; le salarié peut réserver ses réponses seulement sur certaines questions. A partir du moment où le silence est considéré comme un droit du salarié, l’employeur ne pourra pas en faire état comme un grief dans la motivation du licenciement. Ce qui se profile alors est la nullité de la rupture puisque le droit au silence est un droit fondamental du salarié.
Peut-on craindre des contentieux dans la foulée de la décision du Conseil constitutionnel ?
Ce qui se profile est la nullité de la sanction, donc de la rupture, puisque le droit au silence est un droit fondamental du salarié. En cas de contentieux, la nullité du licenciement sera invoquée dans l’hypothèse où l’employeur n’aura pas notifié au salarié le droit de se taire et que le salarié aura fait une déclaration qui sera retenu contre lui comme un élément majeur à charge pour justifier son licenciement. Si le salarié avait su qu’il pouvait garder le silence il se serait abstenu et n’aurait peut-être pas été licencié.
On peut se demander si tous les licenciements intervenus avant que la Cour de cassation ne se prononce seront concernés. Le Conseil constitutionnel pourrait-il décider de l’effet rétroactif de sa décision ? Ce serait très problématique pour les entreprises en termes de sécurité juridique.
La nullité serait-elle la sanction dans tous les cas ?
A la lecture de la jurisprudence du Conseil d’Etat, il y a une distinction à faire selon que la non-information sur le droit au de se taire a eu une incidence déterminante sur la motivation de la sanction ou non. Si la conséquence est mineure, ce serait plutôt qualifié comme un vice de forme.
Florence Mehrez
Rejet de la motion de censure : François Bayrou reste Premier ministre
03/07/2025
Déposée par les socialistes à la suite de l’échec des discussions des partenaires sociaux sur les retraites, la motion de censure visant à renverser le gouvernement de François Bayrou n’a pas été votée mardi 1er juillet par l’Assemblée. Seulement 189 députés (PS, LFI, GDR, Ecologistes) ont voté pour la motion de censure, alors qu’il aurait fallu 289 voix favorables pour renverser le gouvernement.
Les socialistes reprochaient au Premier ministre de n’avoir pas tenu les engagements pris en janvier, lorsqu’il s’était engagé, dans un courrier adressé aux groupes parlementaires, à lancer une concertation sur les retraites “sans totem ni tabou, pas même l’âge légal d’ouverture des droits”, mais avec la condition “unique et fondamentale, celle de l’équilibre financier”, un engagement qui lui avait permis d’échapper à une motion de censure, celle-ci n’ayant pas été votée par le PS.
Après l’échec des discussions du “conclave”, François Bayrou a annoncé vouloir reprendre certains éléments de consensus dans le futur projet de budget 2026 de la Sécurité sociale, tout en invitant les partenaires sociaux à continuer leurs discussions pour trouver un accord sur la pénibilité. Une perspective acceptée par le Medef mais rejetée par les organisations syndicales, qui ont demandé au Premier ministre de trancher.
François Bayrou semble avoir gagné un répit pour rester à Matignon, du moins jusqu’aux discussions à l’automne sur le projet de budget 2026. Ces discussions s’annoncent périlleuses au regard de l’ampleur des économies souhaitées par l’exécutif (autour de 40 milliards d’euros) dans un contexte de ralentissement économique, mais aussi au regard de la menace de censure que fait planer le Rassemblement national.
Ajoutons que le président de la République retrouve à partir du 8 juillet le pouvoir de dissoudre l’Assemblée nationale, un an après la dissolution qui a entraîné une absence de majorité absolue chez les députés et donc une instabilité politique. Cette année a été marquée par le refus d’Emmanuel Macron de désigner un Premier ministre issu du Nouveau Front populaire, Michel Barnier succédant à Gabriel Attal comme Premier ministre, avant d’être lui-même remplacé par François Bayrou, une motion de censure ayant renversé Michel Barnier.
Source : actuel CSE
Le droit de retrait peut s’exercer de manière anticipée
03/07/2025
Un ingénieur commercial est en arrêt de travail pour maladie du 14 au 28 février 2018 puis jusqu’au 28 novembre 2018. Il reprend son poste le 29 novembre et a, le 21 décembre, fait valoir son droit de retrait à partir du 2 janvier 2019. Il est licencié pour faute grave le 5 février 2019. Il demande en justice la nullité du licenciement et sa réintégration dans son poste, sous astreinte.
Son droit de retrait était fondé sur la modification de la structure de sa rémunération variable susceptible, selon lui, de détériorer profondément son état de santé.
La Cour de cassation estime légitime l’utilisation de son droit de retrait par le salarié contrairement à la cour d’appel qui avait estimé que le caractère d’imminence du danger faisait défaut, le salarié ayant anticipé son droit de retrait qui prenait alors effet de façon différée.
La Cour de cassation reproche aux juges du fond “de n’avoir pas recherché si le salarié avait un motif raisonnable de penser le 21 décembre 2018, que la situation de travail, à la date à laquelle il devait reprendre son poste, le 2 janvier 2019, à l’issue de la période de ses congés, présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, indépendamment de l’existence d’un tel danger, justifiant l’exercice du droit de retrait”.
L’arrêt est donc cassé.
Source : actuel CSE
[Veille JO] Les textes parus cette semaine : chômage, droits des salariés, formation, protection sociale, santé sécurité, Sécurité sociale, travailleurs étrangers
04/07/2025
Voici un récapitulatif des textes parus au Journal officiel (JO) du vendredi 27 juin au jeudi 2 juillet inclus, avec les liens renvoyant aux articles que nous avons pu faire sur ces sujets.
► Nous ne traitons pas ici les textes liés aux conventions collectives, car nous vous proposons tous les mois un baromètre des branches sur ces nouveautés.
Assurance chômage
- Un arrêté du 27 juin 2025 porte agrément de l’avenant n° 10 du 20 mars 2025 à la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle
Droits des salariés
- Un décret du 28 juin 2025 précise les modalités de transmission des avis d’arrêt de travail (lire notre brève)
Fonction publique
- Un arrêté du 27 juin 2024 pris pour l’application dans les ministères économiques et financiers de l’article 95 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 fixe le contingent annuel d’autorisation d’absence des membres des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
Formation
- Un décret du 27 juin 2025 introduit une minoration de la prise en charge des actions de formation par apprentissage dispensées en partie à distance (lire notre article)
Justice
- Un arrêté du 25 février 2025 fixe le nombre de chambres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
Nominations
- Un arrêté du 19 juin 2025 porte nomination à la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières
- Un arrêté du 16 juin 2025 porte nomination au conseil d’administration de France compétences
- Un arrêté du 30 juin 2025 porte nomination des membres du comité d’histoire des administrations chargées du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
- Deux décret du 1er juillet 2025 chargent deux députés d’une mission temporaire sur les enjeux émergents du numérique
Protection sociale
- Un arrêté du 19 juin 2025 acte le versement des fonds propres des régimes spéciaux de retraite du personnel de la SNCF et de la RATP à la Caisse nationale d’assurance vieillesse
- Un arrêté du 1er juillet 2024 modifie l’arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970
Santé sécurité
- Un arrêté du 3 juin 2025 modifie l’arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, aux conditions de compétences du personnel et d’accréditation des organismes procédant à ces analyses
Sécurité sociale
- Un décret du 28 juin 2025 modifie les règles de composition du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et à diverses mesures de gouvernance transversales aux organismes de sécurité sociale
- Un décret du 28 juin 2025 précise l’application de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale concernant la protection complémentaire en matière de santé
- Un arrêté du 26 juin 2025 porte application aux allocataires des caisses de mutualité sociale agricole des dispositions du décret n° 2025-185 du 26 février 2025 portant généralisation des déclarations préremplies de ressources pour l’attribution du revenu de solidarité active et de la prime d’activité
Travailleurs étrangers
- Un arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise le régime des titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice
Source : actuel CSE
CPF : coup de pouce de la région Grand-Est pour les demandeurs d’emploi de plus de 55 ans
04/07/2025
La région Grand-Est et la Caisse des dépôts se mobilisent pour l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi de plus de 55 ans. Afin de favoriser leur retour à l’emploi, les deux acteurs ont signé une convention d‘abondement au compte personnel de formation (CPF), selon un communiqué diffusé fin juin.
L’abondement de la région s’élève à 90 % du reste à charge et complète le montant des droits inscrits sur le compte du titulaire, dans la limite de 4 500 euros par dossier de formation et dans le respect d’une enveloppe budgétaire annuelle de 500 000 euros.
Source : actuel CSE
Le Sénat adopte la proposition de loi sur le travail le 1er mai
04/07/2025
Jeudi 3 juillet, le Sénat a adopté en séance publique la proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains secteurs de travailler le 1er mai, déposée par deux sénateurs de l’Union centriste. Pour mémoire, le texte modifie l’actuel article L. 3133-6 du code du travail et ouvre le travail le 1er mai aux établissements et services “dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public”.
Deux amendements ont modifié le texte initial :
- le n° 17 rect. ajoute que “seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler. Le salarié qui refuse de travailler le 1er mai ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le 1er mai pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement” ;
- le n° 19 précise le périmètre des activités de fleuristes autorisées en exigeant qu’ils exercent “à titre principal, une activité de vente de fleurs naturelles”.
Rappelons que cette proposition de loi a fait l’objet d’une vive contestation syndicale lors de la traditionnelle manifestation du 1er mai 2025 : les représentants syndicaux Marylise Léon (CFDT) Sophie Binet (CGT), Frédéric Souillot (FO) et Muriel Guilbert (Solidaires) demandent que le 1er mai reste sanctuarisé.
Hier soir, la CGT a publié un communiqué dans lequel elle fustige “le vol du 1er mai”, “une première brèche qui remet en cause la précieuse exceptionnalité” du seul jour férié et chômé de l’année.
Source : actuel CSE




