Les pistes de la mission parlementaire pour enrayer la dénatalité
16/02/2026
La mission d’information parlementaire consacrée à la chute de la natalité en France publie aujourd’hui son rapport piloté par le député Horizons, Jérémie Patrier‑Leitus. Le document fixe un objectif “unique et clair” : permettre aux Français qui souhaitent avoir des enfants de concrétiser ce projet. Pour y parvenir, les auteurs avancent un ensemble de mesures dont plusieurs concernent le monde du travail.
Parmi les propositions phares figure la création d’un “congé parental unifié” d’un an, indemnisé proportionnellement au salaire.
La mission souhaite également faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Elle préconise la création d’un droit opposable au temps partiel pour les parents et grands-parents d’enfants de moins de trois ans, des autorisations d’absence lors de moments clés de la scolarité, à raison de quatre demi-journées par an ainsi que l’obligation pour les pères de prendre le congé de paternité pour une période de 15 jours contre sept actuellement.
Le texte encourage aussi le déblocage anticipé de l’épargne salariale (participation et intéressement) dès la naissance du premier enfant, ainsi que la possibilité pour les employeurs de verser une prime de naissance exonérée de cotisations et d’impôt, dans la limite de 5 000 euros.
Source : actuel CSE
La modification de la méthode de calcul de la rémunération variable requiert l’accord du salarié
17/02/2026
Dans un arrêt du 7 janvier 2026, la Cour de cassation a considéré que l’ajout de nouveaux comptes commerciaux à l’assiette de calcul de la rémunération variable prévue au contrat de travail constitue une modification de ce dernier.
L’ajout de comptes nouveaux comptes commerciaux à l’assiette de calcul d’un bonus contractuel constitue-t-il une modification du contrat de travail du salarié nécessitant son accord ? La Cour de cassation est venue rappeler sa jurisprudence sur la modification de la rémunération dans un arrêt du 7 janvier 2026.
En l’espèce, dans une société de fabrication d’accessoires de maroquinerie, un salarié est promu aux fonctions de directeur commercial grands comptes export. Il est licencié et saisit le conseil de prud’hommes pour contester ce licenciement et demander des rappels de salaires au titre de la rémunération variable. Le salarié soutient que l’employeur a modifié cette dernière sans son accord, en intégrant de nouveaux comptes commerciaux à l’assiette de calcul du bonus qui lui est dû.
En effet, le contrat de travail du salarié stipulait que la marge commerciale nette servant d’assiette au calcul de la rémunération variable serait calculée selon une méthode détaillée en annexe. Il était prévu que ce calcul s’opère sur la base de 31 comptes commerciaux de classe 6 ou 7. Or en dernier lieu, l’employeur procédait au calcul de cette marge commerciale sur la base de 43 comptes des mêmes classes, ce qui avait entraîné une modification du bonus perçu par le salarié.
La cour d’appel déboute l’intéressé, au motif que cela ne constitue pas une modification du contrat. Le salarié se pourvoit en cassation. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel, considérant que l’intégration de ces nouveaux comptes constitue au contraire une modification du contrat de travail.
Les comptes ajoutés à l’assiette de calcul n’étaient pas simplement la déclinaison de comptes existants
La cour d’appel, pour débouter le salarié, avait estimé qu’il ne ressortait pas des termes de l’annexe que les parties avaient entendu figer les comptes intégrés à chacun des postes de calcul de la marge commerciale nette. Elle avait jugé que la présentation détaillée des comptes dans cette annexe ne constituait qu’un exemple donné par l’employeur de la rémunération qui aurait pu être versée à l’époque, en se fondant sur la base de l’activité passée.
Les juges du fond estimaient donc que l’employeur pouvait intégrer de nouveaux comptes pour tenir compte des nécessités de son analyse comptable et de l’évolution de ses modes de production. Cela ne constituait pas, selon la cour, une modification du contrat de travail à condition que la méthode de calcul stipulée au contrat reste inchangée.
Elle en avait conclu qu’une partie des nouveaux comptes pris en considération ne constituaient que la déclinaison de comptes déjà existants, et que la création de nouvelles rubriques ne faisait que tirer les conséquences comptables de la relance par l’employeur de la fabrication de parapluies en France. La méthode de calcul était toujours la même, selon la cour d’appel.
La première question qui se posait était donc de savoir s’il y avait bien eu une modification de ladite méthode.
La Cour de cassation ne rejoint pas l’analyse de la cour d’appel ; elle casse et annule l’arrêt. Elle considère en effet que l’employeur avait ajouté des comptes supplémentaires à la liste servant de base à la détermination de la marge commerciale nette, qui n’étaient pas simplement la déclinaison des comptes existants. La méthode de calcul avait donc subi une modification.
L’ajout de nouveaux comptes à l’assiette de calcul constituait une modification du contrat de travail
Lorsque les objectifs dont dépendent les primes et bonus sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier sans l’accord du salarié dès lors qu’ils sont réalisables, et ont été portés à la connaissance de ce dernier. Il ne s’agit alors que d’une simple modification des conditions de travail (arrêt du 2 mars 2011).
En l’espèce, la cour d’appel considérait que la mention des comptes servant de base au calcul de la rémunération variable en annexe du contrat avait une simple valeur informative, et n’appartenait pas au socle contractuel. Selon elle, sa modification ne nécessitait donc pas l’accord du salarié.
À l’inverse, la Cour de cassation relève que cet ajout de nouveaux comptes a eu une incidence sur la rémunération variable qui dépendait de cette marge. Elle juge pour cette raison qu’il s’agit d’une modification du contrat de travail.
Cette solution n’est pas nouvelle. La Cour de cassation considère depuis longtemps que l’employeur doit obtenir l’accord du salarié s’il veut modifier un aspect de la relation de travail qui relève en principe de son pouvoir de direction, mais peut avoir un impact sur le montant de la rémunération. Elle a par exemple pu considérer que constituaient une modification du contrat de travail :
- la modification d’une zone de prospection d’un commercial ayant un impact sur la rémunération (arrêt du 10 avril 2013) ;
- la baisse des commissions dues au salarié trouvant son origine dans la redistribution par l’employeur des portefeuilles des délégués commerciaux et qui avait une incidence sur la part variable de leur rémunération (arrêt du 9 avril 2015) ;
- la réorganisation des secteurs de prospection entraînant une réduction de celui de la salariée, et susceptible d’avoir une répercussion sur sa rémunération (arrêt du 19 mars 2025).
Claudiane Jaffre
Des précisions sur la nouvelle prime d’activité d’avril prochain
17/02/2026
Le ministère du travail a publié hier un dossier de presse précisant les changements de la nouvelle prime d’activité, prévus par les textes budgétaires, qui entreront en application en avril 2026.
Près de 3 millions de ménages, promet le ministre du travail, recevront un gain moyen supplémentaire de 50€ par mois avec la nouvelle prime d’activité.
Il s’agira surtout de personnes seules sans enfant (56 % des bénéficiaires), de femmes (57 %), de familles monoparentales (22 %), et de personnes de moins de 25 ans (16 %) et de 25 à 29 ans (16 %). Ce montant s’ajoutera donc au forfait mensuel égal à 633,21 € depuis le 1er avril 2025 (pour une personne seule sans enfant), un forfait logement s’y ajoutant parfois (75,99 € pour une personne seule, jusqu’à 188,06 € pour trois personnes et plus).
Cette prime, financée par l’Etat, est versée par les caisses d’allocations familiales (CAF) et la MSA pour le régime agricole. Son montant est calculé automatiquement, il dépend des ressources du bénéficiaire et de l’ensemble des membres du foyer, des prestations sociales perçues et de la situation du logement.
Dans sa communication, le ministère cite plusieurs exemples :
- un célibataire gagnant 1,15 Smic et dont la prime d’activité passera de 158 € à 212 € après la réforme (+ 54 €);
- un couple avec deux enfants mais un seul salaire (1,15 Smic) passera de 514 € à 56 8€ (+ 54 €) ;
- une famille monoparentale (1,5 Smic) dont la prime passera de zéro à 61€ (+ 61 €) ;
- un couple avec 2 enfants gagnant 1,5 Smic dont la prime passera de 115 € à 169 € (+ 54 €).
Rappelons que les organisations syndicales ont critiqué cette décision dans la mesure où, si elle favorise le pouvoir d’achat des ménages, elle semble aussi dissuader les entreprises d’augmenter les salaires.
Source : actuel CSE
Un questions-réponses sur l’entretien de parcours professionnel
17/02/2026
Le ministère a mis à jour, le 13 février, un questions-réponses sur l’entretien de parcours professionnel, qui remplace depuis la loi seniors du 24 octobre 2025 l’entretien professionnel.
Pour rappel, cet entretien se déroule désormais tous les quatre ans (au lieu de deux ans). L’état des lieux récapitulatif a lieu, quant à lui, tous les huit ans (et non plus six ans). En outre, l’entretien professionnel doit être proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue de certaines absences.
Enfin, deux entretiens obligatoires doivent être tenus à des moments clés de la vie professionnelle : dans les deux mois après la visite médicale de mi- carrière (45 ans) et dans les deux ans qui précèdent les 60 ans du salarié.
Source : actuel CSE
Travailleurs indépendants : l’Inspection du travail lance une vaste campagne contre les abus
17/02/2026
La Direction générale du travail (DGT) engage une campagne nationale de lutte contre le recours abusif aux travailleurs indépendants. Déployée sur l’ensemble du territoire par les Unités régionales d’appui et de contrôle du travail illégal (URACTI) au sein des Dreets, cette opération vise à faire évoluer les pratiques des entreprises et à prévenir les situations de travail dissimulé.
La campagne se déroulera en trois temps :
- Une phase d’information et de sensibilisation. Lancée en janvier au niveau national, cette première étape est relayée localement depuis février. Elle a pour objectif d’alerter les acteurs économiques sur les risques juridiques liés à la mauvaise qualification des relations de travail et d’encourager les démarches de régularisation ;
- Une phase de contrôle ciblé. De mars à août 2026, l’Inspection du travail mènera des contrôles auprès d’entreprises identifiées comme à risque. Les secteurs de l’événementiel, du commerce – grande distribution comme commerce de détail – et de l’hôtellerie‑café‑restauration seront particulièrement visés. Les Dreets pourront toutefois adapter leurs priorités en fonction des réalités régionales ;
- Une phase d’évaluation. À l’issue de la campagne, un bilan sera partagé avec les parties prenantes afin de mesurer l’impact des actions menées, notamment en matière de régularisations et de changements de pratiques.
Une page dédiée est accessible sur le site du ministère du travail.
Le ministère rappelle que le recours abusif au statut d’indépendant concerne les situations où une entreprise fait appel à un prestataire alors que les conditions d’exécution du travail relèvent en réalité d’un contrat salarié.
Source : actuel CSE
Thomas Coutrot : “Il faut confier l’animation des espaces de dialogue professionnel à des élus du personnel”
18/02/2026
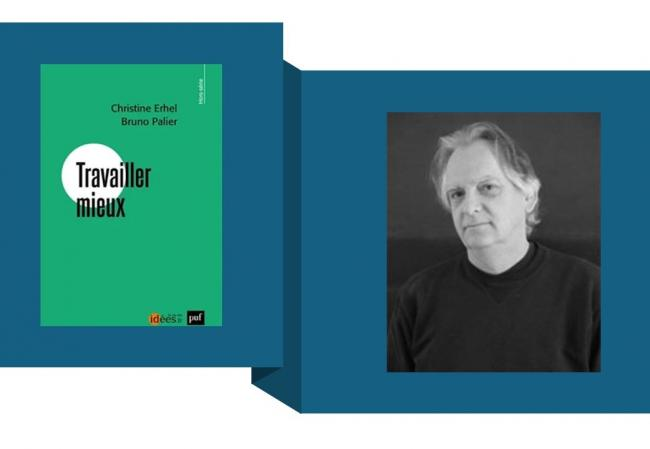
Économiste et statisticien, Thomas Coutrot signe avec Coralie Perez un article intitulé “Instituer le mot à dire sur son travail” dans le dernier ouvrage coordonné par Bruno Palier, “Travailler mieux”. Nous lui avons soumis le référentiel sur le dialogue professionnel du psychologue du travail Yves Clot, remis aux partenaires sociaux lors des premiers ateliers de la conférence sociale “Travail Emploi Retraites”. Le chercheur associé à l’institut de recherche syndical (Ires) y décèle plusieurs lacunes, en particulier les inconvénients d’une présence hiérarchique et la bonne volonté des employeurs qui risque de laisser l’expression des salariés lettre morte. Interview.
Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou a ouvert une conférence Travail emploi retraites, lors de laquelle un document d’Yves Clot sur le dialogue professionnel a été remis aux organisations syndicales et patronales. Que pensez-vous de cette double démarche ?
Ces questions présentent un enjeu considérable, enfin pris en compte au plus haut niveau. Qu’elles arrivent sur le devant de la scène est très positif, il n’y a aucun doute. En revanche, l’exercice présente beaucoup de limites, à commencer par l’absence de volonté de discuter du côté patronal, pour qui le travail reste du ressort des dirigeants des entreprises.
Dans ce document, Yves Clot recommande que le CSE soit saisi des problèmes de sécurité, conditions de travail, qualité du travail soulevés dans ces espaces de dialogue professionnel. Cela vous semble-t-il suffisant pour articuler dialogue professionnel et dialogue social ?
Non ce n’est pas suffisant, j’ai un point de débat avec Yves Clot à ce sujet. Certes, je suis tout à fait d’accord avec son diagnostic : il faut absolument mettre le travail réel à l’ordre du jour des débats, permettre aux salariés de prendre la parole sur leur travail et réfléchir ensemble à la manière de mieux travailler.
Penser qu’un système reposant sur la bonne volonté des employeurs puisse prospérer relève de la naïveté.
Mais penser qu’un système reposant sur la bonne volonté des employeurs puisse prospérer relève selon moi de la naïveté. C’est toute la limite du référentiel d’Yves Clot remis lors de la conférence sociale : il reste soumis à la bonne volonté de la direction. En 2013, le patronat a signé l’accord sur la qualité de vie au travail, on voit la régression qui a suivi : le patronat ne veut même plus discuter du sujet. Il est donc illusoire de poser la question du dialogue professionnel avec cette condition, il faudrait une initiative politique beaucoup plus forte.
La CFDT et la CGT sont favorables à ce dialogue professionnel direct, mais FO craint que cela ouvre la voie à un contournement des syndicats. Comment concevoir un dialogue professionnel remédiant à ce risque ?
Force Ouvrière soulève là un vrai problème : celui que l’employeur acceptant d’ouvrir des espaces de discussion en profite pour affaiblir les syndicats et la représentation du personnel. Il ne suffit donc pas de développer un dialogue professionnel à côté du dialogue social, même si les élus pourraient discuter des points soulevés par les salariés comme le propose Yves Clot. Je pense au contraire qu’il faut confier l’animation des espaces de dialogue professionnel à des élus du personnel pour la raison que soulève FO : éviter un contournement des syndicats et des instances.
Le document propose que le manager “de 1e ligne” soit animateur référent et qu’il puisse ne pas appartenir à un syndicat. Ne faudrait-il pas au contraire rendre cette appartenance systématique ?
Le point 3.2 du référentiel présente cette proposition étrange selon laquelle les collectifs de dialogue professionnel sont animés par “un professionnel reconnu par l’équipe pour sa connaissance du travail, le manager de première lige quand c’est le cas, ou un membre de l’équipe désigné par le collectif”. Il me semble curieux de demander au collectif de désigner qui va animer les discussions en fonction de la qualité du manager. Cela met les équipes dans une situation impossible : les salariés devraient-ils voter pour savoir si le manager est reconnu pour sa connaissance du travail ?
Il serait plus simple de prévoir que le manager n’est pas présent
Il serait plus simple de prévoir que le manager n’est pas présent et que les débats sont animés par un représentant de proximité, membre de l’équipe ou pas car il n’aurait alors ni présupposé ni parti pris. Il faut surtout que ce soit quelqu’un de confiance, élu pour son indépendance vis-à-vis de la direction et sa capacité à animer les discussions de manière neutre. C’est pourquoi je pense qu’il faut lier la fonction d’animateur aux élections des représentants du personnel. Quand je propose le délégué au travail réel, je le conçois comme élu au même titre que les anciens délégués du personnel, et donc sur liste syndicale.
Justement, Camille Dupuy, dans son étude pour l’Ires, alerte pourtant bien sur l’importance d’un dialogue professionnel animé sans les managers. Pourquoi cette idée peine-t-elle à s’imposer ?
La plupart des tentatives d’espaces consultatifs des salariés montrent que la houlette hiérarchique entrave la parole des salariés dans les groupes de discussion. Ils ont au contraire besoin d’une parole libre. De plus, les travaux de psychologie du travail exposent que les “trouvailles” des salariés dans leur travail réel ne sont pas toujours conscientes, ce sont souvent des réflexes incorporés. Pour mettre en débat le travail réel, il faut donc une parole libre qui ne peut pas s’exprimer en présence du manager. Mais les partisans de la présence hiérarchique avancent qu’il faut les associer aux discussions car ils auront à mettre en œuvre les propositions résultant des débats, et qu’ils ont donc leur mot à dire. Ils me semblent légitimes à participer dans un second temps, après que l’élu aura porté les propositions du collectif mais pas avant.
Pourquoi la présence des managers reste-t-elle un point de blocage des travaux sur l’expression des salariés ?
Ceux qui la défendent prétendent que les syndicats et les élus sont éloignés du travail réel, que leurs missions tiennent aux salaires, aux conditions de travail mais pas à l’organisation du travail qui soit leur rester inaccessible. Mais à mon avis, ce sont les managers qui sont déconnectés du travail réel.
Le patronat ne veut pas abandonner la moindre bribe de pouvoir sur l’organisation du travail
Par ailleurs, une formation adéquate des équipes syndicales leur permettrait d’acquérir les connaissances nécessaires. Il faut prévoir des formations dédiées, certains en disposent déjà, il faudrait les généraliser. Le véritable enjeu derrière, c’est le partage du pouvoir : le patronat ne veut pas abandonner la moindre bribe de pouvoir sur l’organisation du travail et Yves Clot me semble avoir implicitement accepté cette exigence.
Vous proposez dans votre article un délégué au travail réel. Pourquoi ne pas former les élus et revenir aux délégués du personnel et au CHSCT ?
Il ne s’agirait pas de rajouter un délégué au travail réel mais de l’instaurer à la place de l’ancien délégué du personnel (DP). Ce dernier avait pour vocation de porter les réclamations individuelles, qui dans la plupart des cas soulèvent des questions d’organisation du travail, à savoir la définition des tâches, leur attribution, leur évaluation. Les DP n’étaient pas habilités ni formés à les diagnostiquer, leurs attributions étaient trop limitées par rapport aux exigences de la situation. Instaurer un délégué au travail réel permettrait de tirer les leçons de ces limitations. Ce délégué permettrait de mieux articuler le travail des élus de proximité et du CHSCT qui les rassemblerait. L’idée que seule la direction aurait les compétences sur l’organisation du travail n’est plus soutenable quand on voit la recrudescence de l’absentéisme, les risques psychosociaux, les difficultés de recrutement. Ces signaux sont au rouge à cause de rapports de travail verticaux et autoritaires.
Yves Clot évoque une “instance tripartite” incluant la direction, les représentants syndicaux quand ils existent et le garant, le pilote global du dialogue professionnel. Que pensez-vous de cette instance parallèle au CSE ?
C’est en effet problématique, on risque de voir des instances parallèles à la représentation du personnel concurrencer et marginaliser l’activité des élus. Au contraire, si on veut rendre les représentants vigoureux, il faut les enraciner dans le travail réel. Sinon, le résultat automatique sera de déposséder encore plus les élus du travail réel pour déléguer ces sujets aux managers ou à d’autres représentants. On risque donc d’avoir un CSE déconnecté du terrain et des questions du travail.
Vous évoquez la nécessité que les salariés soient écoutés et consultés, mais pas leur participation au conseil d’administration de l’entreprise. Pourquoi ?
Parce que ce terrain est déjà bien balisé par des propositions syndicales et politiques. Je suis bien évidemment pour des représentants des salariés aux conseils d’administration, mais à condition qu’ils aient des racines bien implantées dans le travail réel. Sinon, ils n’auront pas d’influence, pas de puissance, ils seront déconnectés. Il faut au contraire qu’ils soient équipés par les institutions qui viennent du terrain.
Vous revenez sur le manque de motivation des employeurs à mettre en place le dialogue professionnel. Pourquoi cette méfiance et comment y remédier ?
C’est un enjeu de lutte sociale, une question de rapport de force. Les employeurs acceptent rarement de bon gré des représentants du personnel au conseil d’administration. Ils ne voulaient pas non plus du salaire minimum, ni des congés payés.
Il ne faut pas attendre du patronat qu’il accepte de bon gré l’expression des salariés
Ces droits se sont traduits grâce à des avancées par des luttes traduites ensuite dans des lois, il n’en va pas différemment aujourd’hui. Il ne faut pas attendre du patronat qu’il accepte de bon gré l’expression des salariés… J’ajoute qu’il faudrait mettre davantage en avant comment l’activité de l’entreprise impacte l’environnement, et ce à partir du travail réel des salariés, de leurs pratiques effectives. Les enjeux écologiques justifient l’importance de ces espaces de délibération des salariés.
Le dialogue professionnel ne risque-t-il pas de favoriser l’expression de salariés déjà armés à l’expression, en laissant de côté les autres ?
C’est d’autant plus vrai dans des groupes de parole animés par la hiérarchie. Mais le problème peut aussi se poser avec un animateur représentant du personnel. L’aisance à l’oral et le capital culturel facilitent l’expression et induisent le risque que certains monopolisent la parole. D’où l’importance de la formation des élus à la mise en confiance et à l’animation afin que les salariés se sentent le droit à la parole. On pourrait aussi imaginer des réunions préparatoires avec ceux qui sont le plus exclus de la prise de parole : les intérimaires, les femmes, les minorités étrangères, les précaires. Même si la réussite n’est pas totalement atteignable, c’est une condition politique au succès des groupes de discussion.
Les freins à l’engagement syndical sont connus, en particulier la crainte des représailles patronales. Comment résoudre ce problème qui risque aussi de se poser à l’égard du délégué au travail réel et des salariés qui s’expriment ?
Je conçois les délégués au travail réel comme protégés juridiquement comme les élus de CSE et les délégués syndicaux. En revanche, le référent animateur d’Yves Clot ne bénéficie d’aucune protection. Les enquêtes syndicales (notamment de la CGT) montrent que le développement de projets autour du travail réel a renforcé les équipes syndicales qui ont recruté de nouveaux adhérents.
Les ordonnances de 2017 ont affaibli le lien entre les syndicats et leur base
Moins isolés et moins coupés des équipes, ils sont plus difficiles à discriminer grâce à leurs racines profondes dans les collectifs de travail. Les ordonnances de 2017 ont affaibli le lien entre les syndicats et leur base puisqu’on a supprimé les délégués du personnel et que les représentants de proximité ne sont presque jamais mis en place. Il faut au contraire revigorer ce lien et l’influence des élus du personnel.
Le gouvernement ne prévoit pas de réformer le CSE. Il s’appuie sur les études selon lesquelles les salariés ont une “bonne image” de la nouvelle instance. Qu’en pensez-vous ?
Si on s’appuie sur des sondages, c’est qu’on a peu d’arguments à opposer. Le comité d’évaluation des ordonnances Travail a bien montré les problèmes : déconnexion des élus du terrain, traitement superficiel des questions de santé et d’organisation du travail. La réaction du gouvernement n’est donc pas sérieuse.
Qu’attendez-vous de cette conférence sociale finalement ?
Rien de concret ! Pour une raison simple : le gouvernement ne veut pas imposer quoi que ce soit au Medef. En revanche, cette conférence crée un espace de controverse public où l’on peut mener un débat de nécessité vitale. De ce point de vue, cela n’est pas totalement inutile. Par ailleurs, on voit bien que le développement de ce sujet de dialogue professionnel malgré l’opposition acharnée du Medef découle de la puissance de la mobilisation de 2023 contre la réforme des retraites. Il reste un traumatisme dans le corps social sur le passage en force de cette réforme.
Marie-Aude Grimont
Un suppléant peut-il reporter des heures de délégation données par un titulaire ?
18/02/2026

Un abonné a voulu savoir si un suppléant a le droit reporter sur le mois suivant les heures de délégation qui lui ont été données par un titulaire et qu’il n’a pas encore utilisées. Notre réponse.
La problématique est intéressante… mais inédite : voilà en effet une question à laquelle le code du travail ne répond hélas pas, comme c’était d’ailleurs déjà le cas au sujet du délai de prévenance. Pas la peine non plus d’aller chercher dans la jurisprudence. A notre connaissance, la question n’a jamais été soumise à un juge.
Nous allons donc tenter de trouver des éléments de réponses en repartant de ce que nous dit le code du travail sur les heures de délégation.
Les règles posées par le code du travail
D’abord, à la base, il y a l’article L. 2315-7. Il prévoit que “l’employeur laisse le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions à chacun des membres titulaires constituant la délégation du personnel du comité social et économique”. Le nombre d’heures ne nous intéresse pas.
Ensuite, nous avons l’article R. 2315-5 qui dispose, mot pour mot, que “le temps prévu à l’article L. 2315-7 peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois” et que “cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie”.
Comment les interpréter ?
Si on fait attention à la rédaction de cet article R. 2315-5, on constate d’abord que la possibilité de reporter les heures de délégation ne concerne que “le temps prévu à l’article L. 2315-7”. A savoir, le temps que l’employeur est tenu d’accorder aux élus titulaires du CSE.
Ensuite, il nous est bien dit que le report ne peut conduire l’élu à disposer dans le mois de plus d’une fois et demi “le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie”. A savoir, le crédit d’heures dont bénéficient les élus titulaires du CSE.
Si on s’en tient à une interprétation littérale des articles du code du travail, on peut a priori estimer ce mécanisme de report des heures de délégation est exclusivement réservé aux titulaires du CSE. Un suppléant ne devrait pas pouvoir en faire usage.
► Attention, la réponse que nous apportons ici n’est que le fruit de notre interprétation des dispositions légales, elle n’a aucune valeur juridique. Tant que nous n’aurons pas une jurisprudence émanant de la Cour de cassation, il sera impossible de savoir, avec certitude, si un suppléant a ou non le droit de reporter des heures de délégation.
Frédéric Aouate
Le défaut d’entretien professionnel n’ouvre pas droit à lui seul à l’abondement au CPF
18/02/2026

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’abondement correctif au compte personnel de formation (CPF) n’est dû que s’il est constaté lors de l’état des lieux récapitulatif que le salarié n’a bénéficié, pendant la période considérée, ni de tous les entretiens professionnels prévus par la loi, ni d’au moins une formation non obligatoire.
La chambre sociale de la Cour de cassation se prononce, pour la première fois à notre connaissance, sur les conditions d’application de l’abondement au CPF dû par l’employeur en cas de non-respect de certaines règles relatives à l’entretien professionnel.
L’entretien professionnel a pour objet d’examiner de manière périodique les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, avec un état des lieux à intervalle plus espacé. Lors de l’entretien d’état des lieux, il est vérifié que le salarié a bénéficié de tous les entretiens prévus par la loi pendant la période considérée, et suivi au moins une action de formation, acquis des éléments de certification par la formation ou une validation des acquis de l’expérience et progressé sur le plan salarial ou professionnel, conformément aux articles L.6315-1 et L.6323-13 du code du travail.
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, si le salarié n’a pas bénéficié de tous les entretiens prévus et d’au moins une formation non obligatoire (autre que celles mentionnées à l’article L.6321-2 du code du travail), son CPF est alimenté par l’employeur d’un abondement correctif de 3000 euros, qui n’entre pas dans le calcul du crédit annuel et du plafond du CPF.
► Rappelons que le contenu de l’entretien professionnel, renommé entretien de parcours professionnel, sa périodicité et celle de l’état des lieux récapitulatif ont été remaniés par la loi du 23 octobre 2025. Pour le point qui nous intéresse, au moment des faits objet du litige, l’entretien professionnel devait être organisé tous les deux ans, et l’état des lieux tous les six ans. Depuis le 26 octobre 2025, la loi prévoit que l’entretien de parcours professionnel doit être organisé dans l’année suivant l’embauche puis tous les quatre ans, avec un état de lieux tous les huit ans, en vertu de l’article L.6315-1. L’enseignement du présent arrêt, rendu pour l’application des règles antérieures à cette loi, nous parait transposable aux règles actuellement en vigueur.
Pas d’abondement au CPF du salarié qui a bénéficié d’une formation
Dans la présente affaire, un salarié qui n’avait pas bénéficié tous les deux ans d’un entretien professionnel dans les six ans précédant l’entretien d’état des lieux, réclamait en justice l’abondement correctif sur son CPF.
La cour d’appel, dont le raisonnement est approuvé par la Cour de cassation, a constaté qu’au cours de la période de six ans considérée, le salarié avait suivi une formation non obligatoire, de sorte que les deux conditions cumulatives pour prétendre au bénéfice d’un abondement de son CPF n’étaient pas satisfaites, et donc le salarié ne pouvait pas y prétendre.
Une limitation des cas de déclenchement de l’abondement correctif
Les juges font une lecture restrictive des conditions de déclenchement de l’abondement correctif. Il faut que soient constatées deux carences cumulatives : l’absence non seulement d’au moins un des entretiens auxquels le salarié a droit au cours de la période considérée, mais aussi d’au moins une formation non obligatoire. Ainsi, le fait que le salarié n’a pas bénéficié de tous les entretiens auxquels il avait droit, ne suffit pas pour lui faire bénéficier de l’abondement correctif.
► À notre avis, le choix de cette interprétation, qui limite considérablement le risque financier de l’employeur en cas de non-respect des règles relatives à l’entretien de parcours professionnel, n’allait peut-être pas de soi. L’article L.2323-13 du code du travail aurait tout aussi bien être lu comme imposant deux obligations cumulatives à la charge de l’employeur, dont le manquement à l’une d’elles pouvait déclencher l’abondement.
Aliya Benkhalifa
Emploi des travailleurs handicapés : un décret précise la gestion du reliquat des accords agréés
18/02/2026
Un décret du 13 février 2026, pris en application de l’article L. 5212‑17 du code du travail, vient clarifier plusieurs points clés relatifs aux accords agréés en matière d’emploi des travailleurs handicapés. Le texte détaille notamment les modalités de calcul et de notification du reliquat de fin d’accord, prévu à l’article L. 5212‑8, et encadré par l’autorité administrative.
Le décret précise également les conditions de dépôt du bilan récapitulatif des accords agréés et accorde aux employeurs un délai de déclaration allongé. Il organise par ailleurs la procédure de recouvrement par les organismes de sécurité sociale en cas de défaut de déclaration ou de versement des contributions dues.
Enfin, le texte encadre la procédure applicable lors d’un renouvellement d’agrément, en particulier les règles de report total ou partiel du reliquat d’un accord arrivé à son terme.
Source : actuel CSE
L’Index de l’égalité doit être publié au plus tard le 1er mars 2026
18/02/2026
Toutes les entreprises et UES (unités économiques et sociales) d’au moins 50 salariés doivent calculer et publier leur Index de l’égalité, au plus tard le 1er mars 2026, au titre de l’année 2025, en vertu des articles L. 1143-8 et D. 1142-4 du code du travail.
Cette publication se fait sur le site Internet de l’entreprise, lorsqu’il en existe un, de manière visible et lisible. Il doit également être communiqué au CSE et transmis à l’inspection du travail via une plateforme dédiée.
L’Index prend la forme d’une note de 100 déterminée à partir d’une série de cinq indicateurs (seulement quatre d’entre eux pour les entreprises de 50 à 250 salariés inclus) :
- écart de rémunération ;
- écarts de taux d’augmentations individuelles ;
- écarts de taux de promotions ;
- augmentations au retour du congé maternité ;
- nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations.
Depuis 2022, l’employeur doit également publier :
- des objectifs de progression en cas d’index inférieur à 85 points ;
- des mesures de correction et de rattrapage en cas de note inférieure à 75 points.
En l’absence de publication de ces informations, l’employeur s’expose à une pénalité de 1 % de la masse salariale annuelle.
En plus de cet index de l’égalité, les entreprises d’au moins 1000 salariés pour le troisième exercice consécutif doivent également publier les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes. Les modalités et délais de publication sont les mêmes que pour l’Index égalité.
Ils restent disponibles sur le site internet de l’entreprise au moins jusqu’à la publication, l’année suivante, des écarts de représentation de l’année en cours.
Source : actuel CSE
Frais professionnels : les changements intégrés par le Boss
19/02/2026

Dans une mise à jour du 4 février 2026, le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) met à jour les montants des frais professionnels pour l’année 2026 et intègre l’essentiel des modifications apportées aux frais professionnels par l’arrêté du 4 septembre 2025.
Certaines professions pouvaient bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique (DFS). Cette “DFS” permettait de réduire l’assiette des cotisations sociales en appliquant un pourcentage représentatif de leurs frais professionnels. Cette DFS va progressivement disparaître. La décision, qui avait été actée par l’arrêté du 4 septembre 2025 relatif aux frais professionnels qui a abrogé l’arrêté du 20 décembre 2002, est désormais intégrée au Boss (Bulletin officiel de la sécurité sociale) dans sa mise à jour du 4 février 2026.
Ainsi, le Boss confirme que les modalités de la suppression progressive de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour certains métiers (VRP, construction, propreté) sont inchangées. Pour tous les métiers qui ne sont pas concernés par cette suppression spécifique, il n’y aura progressivement plus de déduction forfaitaire spécifique (DFS) à compter du 1er janvier 2032.
► Rappelons que les professions concernées par la DFS sont listées à l’article 5 de l’annexe IV du CGI.
Les dispositions du Boss sont opposables depuis le 1er janvier 2026.
La suppression progressive de la DFS pour certains métiers est inchangée
La suppression progressive de la DFS pour certains secteurs prévue par l’administration est inchangée par l’arrêté du 4 septembre 2025. La suppression de la DFS pour ces secteurs s’effectue selon un calendrier repris à l’identique.
Rappelons que les secteurs et les métiers concernés par cette suppression sont :
- la propreté (fin de la DFS à compter du 1er janvier 2029) ;
- la construction (fin de la DFS à compter du 1er janvier 2032) ;
- le transport routier de marchandises (fin de la DFS à compter du 1er janvier 2035) ;
- l’aviation civile (fin de la DFS à compter du 1er janvier 2033) ;
- les journalistes (fin de la DFS à compter du 1er janvier 2038) ;
- les casinos et cercles de jeux (fin de la DFS à compter du 1er janvier 2031) ;
- le spectacle vivant ou enregistré (fin de la DFS à compter du 1er janvier 2032) ;
- et les VRP (fin de la DFS à compter du 1er janvier 2038).
En revanche, l’arrêté ne reprenait pas les dispositions transitoires plus favorables prévues par le Boss pour la sortie de ces dispositifs (DFS admise même en l’absence de frais, remboursements de frais professionnels cumulables avec la DFS et consentement des salariés pouvant couvrir l’ensemble de la période sous certaines conditions). On pouvait donc s’interroger sur leur pérennité.
Dans sa mise à jour du 4 février 2026, le Boss lève toute ambiguïté. Ces mesures plus favorables perdurent pour l’ensemble de ces secteurs (Boss-FP-2310 et suivants).
De même, le Boss confirme les taux de DFS personnalisés applicables à ces professions (Boss-FP-2120 et 2300).
Modalités de suppression progressive de la DFS pour les autres métiers
L’article 9, III de l’arrêté du 4 septembre 2025 prévoit un autre calendrier de suppression progressive pour les professions bénéficiant de la DFS autres que celles listées ci-dessus.
Le Boss intègre cette suppression progressive et confirme le calendrier fixé par l’arrêté du 4 septembre 2025 (Boss-FP-2120). Elle débute à compter du 1er janvier 2026 pour s’achever le 31 décembre 2031. Il n’y aura donc plus de DFS pour ces secteurs à compter du 1er janvier 2032.
Il rappelle que les taux de DFS sont réduits au 1er janvier de chaque année d’une valeur égale à 15 % du taux applicable en 2025. Les pourcentages résultant de ce calcul sont arrondis à l’unité la plus proche (une fraction de 0,5 est comptée pour 1).
Le Boss indique que le taux de déduction forfaitaire de l’année est déterminé selon la formule suivante (TI correspond au taux de DFS applicable en 2025) : Taux de l’année = TI – ((TI x 0,15) x nombre d’années écoulées depuis le 1er janvier 2025).
► Le Boss n’indique pas qu’il s’agit du nombre d’années écoulées depuis le 1er janvier 2025, mais depuis le 1er janvier 2026. Cette référence au 1er janvier 2026 est selon nous une coquille. Celle-ci est confirmée par l’exemple donné par la Boss en cas de taux de DFS de 30 % en 2025. L’administration précise qu’à compter du 1er janvier 2027 le taux de DFS dans ce cas est de 21 %.
Ainsi, en appliquant la formule et en reprenant l’exemple du Boss : si le taux de la DFS est de 30 % en 2025, il sera de : 26 % à compter du 1er janvier 2026, 21 % à compter du 1er janvier 2027, 17 % à compter du 1er janvier 2028, 12 % à compter du 1er janvier 2029, 8 % à compter du 1er janvier 2030, 3 % à compter du 1er janvier 2031 et il n’y aura plus de DFS à compter du 1er janvier 2032.
Par ailleurs, notons que les dispositions plus favorables prévues par le Boss pour la suppression de la DFS des secteurs listés ci-avant (journalistes, VRP, propreté…) ne s’appliquent pas dans le cadre de la disparition de la DFS pour l’ensemble des professions. Il n’est donc pas possible d’appliquer la DFS en l’absence de frais, la DFS ne se cumule pas avec les remboursements de frais professionnels et le consentement des salariés à la DFS pour l’ensemble de la période sous certaines conditions ne s’applique pas.
Consentement du salarié à la DFS
Les modalités de recueil du consentement du salarié sont détaillées par l’article 9 de l’arrêté du 4 septembre 2025, alinéas 2 et 3.
Sans changement, l’employeur peut opter pour la DFS lorsqu’une convention ou un accord collectif l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise, les DP ou le CSE ont donné leur accord. Ce droit d’option peut être révisé chaque année (Boss-FP-2180).
À défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option.
L’arrêté du 4 septembre 2025 prévoit que ce n’est qu’à défaut de mention dans le contrat de travail ou dans un avenant, que l’employeur informe et recueille le consentement du salarié annuellement par tout moyen. Cette précision, qui figurait déjà dans l’arrêté du 20 décembre 2002, n’avait pas été reprise par le Boss. Elle n’y figure toujours pas dans sa mise à jour du 4 février. En attendant une éventuelle modification du Boss à ce sujet, peut-être vaut-il mieux continuer à recueillir le consentement annuel du salarié même en cas de mention dans le contrat de travail ou dans un avenant.
Par ailleurs, le Boss ajoute que l’employeur met en œuvre une procédure consistant à informer chaque salarié concerné, par tout moyen donnant date certaine à cette consultation, de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits aux assurances sociales (Boss-FP-2190). Cette procédure n’est pas prévue par l’arrêté du 4 septembre 2025.
Sans changement également, lorsque le salarié ne répond pas à la demande de l’employeur, son silence vaut accord. En revanche, l’arrêté du 4 septembre 2025 précise que ce principe s’applique lorsque le salarié ne répond pas “dans un délai raisonnable”. Cet ajout n’est pas intégré au Boss (Boss-FP-2190).
Exceptions au principe de non-cumul de la DFS avec l’exonération de frais professionnels
En principe, lorsque l’employeur applique la DFS, il intègre dans l’assiette des cotisations les remboursements de frais réels, les allocations forfaitaires et les prises en charge directes de frais par l’employeur, préalablement à l’application de la DFS (Boss-FP-2240).
Une liste limitative d’exceptions est prévue par l’arrêté du 4 septembre 2025 dans une annexe 2.
En conséquence, le Boss met à jour la liste de ces exceptions et supprime “les allocations et indemnités versées au titre d’avantages résultant de certaines contraintes professionnelles” (Boss-FP-2250).
Les ajouts de l’arrêté figuraient déjà dans le BOSS et sont toujours présents (Boss-FP-2250 à 2280) : les frais de transport exposés à l’occasion de la mise à disposition par l’employeur d’un véhicule de transport en commun à destination des salariés pour les conduire sur le lieu de travail et les voyages de début et fin de chantier ainsi que les voyages de détente prévus par la convention collective du BTP.
Mobilité professionnelle : suppression du critère de distance kilométrique
Les frais engagés par le salarié dans le cadre d’une mobilité professionnelle sont considérés comme des frais professionnels dès lors que le salarié change de lieu de résidence en raison d’un changement de poste de travail dans un autre lieu de travail.
L’article 8 de l’arrêté du 4 septembre 2025 précise que le salarié est présumé placé dans cette situation lorsque le trajet de l’ancien lieu de résidence à celui du nouvel emploi ne peut être parcouru en moins d’1 h 30. En revanche, l’arrêté n’indique plus, comme c’était le cas dans l’arrêté du 20 décembre 2002, que “la distance séparant l’ancien logement du nouveau lieu de travail est au moins de 50 kilomètres”.
Le Boss supprime donc également cette référence à la distance de 50 kilomètres, seul le temps de trajet d’au moins 1 h 30 (aller ou retour) est conservé (Boss-FP-1530).
Le Boss ajoute que cette condition constitue une présomption simple, compte tenu en particulier de l’empêchement pour le salarié de regagner son domicile en fin de journée.
Il précise également que la durée d’1 h 30 correspond à la durée minimale de trajet en deçà de laquelle le trajet ne peut être réalisé par aucun moyen de transport habituellement utilisé par le salarié (voiture, cyclomoteur, vélomoteur, scooter, motocyclette, transports en commun, vélo).
Frais engagés par le salarié en situation de télétravail
Lorsque le salarié est en situation de télétravail régie par le code du travail, la prise en charge par l’employeur des frais engagés par le salarié est exclue de l’assiette des cotisations, à la condition qu’ils soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles qu’il supporte.
Le Boss précise les modalités d’évaluation des frais générés par le télétravail, en les classant en trois catégories (Boss-FP-1790) :
- frais fixes et variables liés à la mise à disposition d’un local privé pour un usage professionnel ;
- frais liés à l’adaptation d’un local spécifique ;
- frais de matériel informatique, de connexion et de fournitures diverses.
L’acquisition du mobilier et du matériel informatique est ajoutée à la catégorie des frais liés à l’adaptation d’un local spécifique.
Indemnités forfaitaires de grand déplacement
Les indemnités forfaitaires destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas, de logement et de petit-déjeuner exposées par le salarié en déplacement professionnel sont réputées utilisées conformément à leur objet et exonérées de cotisations : lorsque l’employeur justifie que le salarié ne peut pas regagner sa résidence (et que de ce fait, il engage des frais de double résidence) et lorsqu’elles ne dépassent pas certaines limites qui sont fixées par l’arrêté du 4 septembre 2025.
Ces limites d’exonération s’appliquaient jusqu’à l’arrêté du 4 septembre 2025 jusqu’à la fin de la 6e année du déplacement (arrêté du 20 décembre 2002, article 5).
L’arrêté du 4 septembre 2025 (article 5, II) précise que la durée pendant laquelle les limites d’exonération des indemnités forfaitaires de grand déplacement s’appliquent est désormais limitée à cinq ans. Il ajoute que l’employeur ne peut bénéficier de la déduction pour les périodes de déplacement au-delà de 60 mois.
Cette limitation des indemnités forfaitaires de grand déplacement à cinq ans n’est pas reprise par le Boss qui précise que ces limites d’exonération s’appliquent pendant six ans (BOSS-FP-1300). Ce maintien n’est pas surprenant car l’administration nous avait précisé que cette limite de cinq ans était une erreur. Reste que l’on attend toujours l’arrêté modificatif qui corrigerait cette coquille.
Eléonore Barriot
Transparence salariale : les entreprises loin du compte à l’approche de 2026
19/02/2026
Selon une étude mondiale publiée le 17 février par le cabinet Mercer et menée auprès de 1 600 entreprises multinationales dans 60 pays, seules 36 % d’entre elles se disent prêtes à répondre aux nouvelles exigences en matière de transparence salariale. En Europe, le constat est encore plus préoccupant : à peine 9 % des organisations interrogées disposent d’une stratégie pleinement opérationnelle.
La France ne fait pas figure d’exception. Seules 36 % des entreprises françaises estiment être en mesure de se conformer aux obligations à venir, signe d’une préparation encore incomplète.
L’intégration des avantages sociaux dans les dispositifs de transparence reste, elle aussi, très hétérogène. Seules 14 % des entreprises les incluent déjà dans leur reporting. Un peu plus d’un tiers (36 %) prévoient de le faire, tandis que 30 % continuent de les traiter séparément et 20 % n’envisagent pas de les intégrer.
Pour Mercer, la transparence salariale devient pourtant un enjeu majeur de réputation et de confiance. Mais l’étude montre que la démarche reste encore trop cantonnée aux services RH. Si 79 % des stratégies sont pilotées par la direction des ressources humaines, seules 35 % associent les dirigeants. Par ailleurs, 38 % des entreprises misent sur la formation des managers, et seulement 13 % intègrent des enquêtes auprès des salariés.
Source : actuel CSE
La dégradation prévisible du secteur d’activité peut justifier le licenciement économique d’un salarié protégé
20/02/2026

La dégradation prévisible du secteur d’activité – ici une société d’édition travaillant pour les auto-écoles – peut constituer une menace pour la compétitivité justifiant le licenciement économique d’un salarié protégé.
En cas de licenciement économique d’un salarié protégé, l’autorité administrative saisie doit s’assurer de la réalité de la cause économique du licenciement. Lorsque le motif économique invoqué est la sauvegarde de la compétitivité (C. trav., art. L. 1233-3, 3°), il n’y a pas forcément (déjà) de difficultés économiques mesurables.
Le rôle de l’inspecteur du travail est de rechercher si la réalité de la menace pour la compétitivité de l’entreprise justifie le licenciement envisagé. Quelle est donc la nature de cette menace sur la compétitivité pouvant justifier le licenciement du salarié protégé ? C’est sur cette question que l’arrêt du Conseil d’État du 11 février 2026, mentionné aux tables du recueil Lebon, apporte des précisions.
Refus d’une modification du contrat de travail dans le cadre d’une réorganisation
Dans cette affaire, deux sociétés d’édition et de distribution de matériel pédagogique d’éducation routière et de formation à la conduite fusionnent. Depuis quelques années, l’évolution technologique et réglementaire de ce secteur (ouverture des examens aux candidats libres, arrivées de plateformes numériques d’apprentissage) a entraîné la baisse d’activité de leurs principaux clients, les auto-écoles.
Après cette fusion, une réorganisation commerciale est engagée, notamment en redécoupant les secteurs des VRP. Cette modification de leur contrat de travail a été refusée, notamment, par 2 salariés protégés. L’autorisation de licenciement pour motif économique a alors été demandée et accordée.
► Remarque : en effet, le refus d’une modification de son contrat de travail par un salarié protégé ne constitue pas en soi une cause de licenciement (CE, 3 juill. 2013, n° 348099). L’employeur doit alors préciser les raisons l’ayant conduit à proposer la modification refusée. Lorsque ce motif n’est pas inhérent à la personne du salarié, il s’agit d’un licenciement pour motif économique (Cass. soc., 3 déc. 2025, n° 24-17.377). L’autorité administrative doit alors apprécier le bien-fondé du motif à l’origine de la proposition faite au salarié et refusée par celui-ci. Le motif de la demande doit être examiné selon la grille d’analyse correspondant au terrain juridique retenu par l’employeur (Guide DGT des salariés protégés, 20 sept. 2019, fiche 11 a, 3.1 et 4.2.1). Ainsi, il appartient à l’administration de vérifier, non que la modification du contrat de travail est strictement nécessaire au motif économique, mais qu’elle est justifiée par le motif économique allégué (CE, 15 nov. 2022, n° 449317), dans cette affaire, la sauvegarde de la compétitivité. Ces points ne font l’objet d’aucune difficulté dans cette affaire. Mais le salarié n’est pas d’accord. Et la cour administrative d’appel annule les autorisations, considérant que le motif économique n’est pas constitué. Pour elle, la baisse indicateurs économiques et les mutations du secteur de l’édition pédagogique et l’enseignement de la conduite, constatées par l’autorité administrative dans son dossier de demande d’autorisation de licenciement, ne permettent pas d’identifier une dégradation prévisible de la situation concurrentielle relative de la société. Ce marché étant un oligopole, rien n’indiquait la perte de parts de marché face au seul concurrent restant après la fusion (CAA Nantes, 18 juin 2024, n° 23NT01269).
Comme le précise le Rapporteur public, “toute la question réside donc dans l’acception qu’il convient de donner à la notion de compétitivité”.
La menace sur la compétitivité n’est pas limitée à la perte de parts de marché
Il s’agit de déterminer si la menace sur la compétitivité peut résulter seulement de perte de parts de marché, ou si elle doit s’entendre plus largement, lorsque le marché se transforme et se réduit.
Le Conseil d’État commence par rappeler qu’en cas de demande d’autorisation de licenciement pour motif économique, il appartient à l’autorité administrative de rechercher si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié.
Puis il précise que lorsque le motif économique allégué est la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, doit être établie “la réalité de la menace pour la compétitivité de l’entreprise”, laquelle s’apprécie au niveau du secteur d’activité dont relève l’entreprise appartenant à un groupe.
Enfin, et c’est la nouveauté de cet arrêt, le Conseil d’État explique que cette menace peut notamment résulter :
- tant de la dégradation prévisible de la position concurrentielle de l’entreprise au sein dudit secteur d’activité ;
- que de la dégradation prévisible de ce même secteur d’activité.
► Remarque : en effet, “la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité”, introduite dans le code du travail en 2016, codifiant la jurisprudence judiciaire et administrative, doit avoir pour objectif, afin de constituer un motif de licenciement économique valable, de permettre aux entreprises d’anticiper des difficultés économiques prévisibles, afin d’éviter un nombre plus important de licenciement économiques à défaut. Il faut, bien sûr, que ces menaces soient caractérisées, “avec un certain degré de certitude et de gravité”, comme le souligne le Rapporteur. Mais peu importe, ajoute-t-il, que la baisse d’activité prévisible résulte d’une perte de parts de marché sur un marché stable, ou d’une position stable sur un marché en récession.
Le Conseil d’État avait déjà adopté une solution allant dans le même sens, sans être aussi explicite, en 2020. En effet, le motif économique avait été reconnu comme établi dans le cadre d’une forte et régulière rétractation du marché constituant dans ce contexte une menace sérieuse pesant sur la compétitivité du groupe au niveau de son secteur d’activité de nature à justifier la réorganisation, et ce alors même qu’il n’y avait qu’une très faible baisse des parts de marché (CE, 9 oct. 2020, n° 428431). Ici, comme le souligne le Rapporteur, le facteur central est donc bien la rétractation du marché et non la baisse effective des parts de marché.
► Remarque : d’autre part, le Rapporteur explique que cette appréciation se rapproche de celle de la Cour de cassation concernant le licenciement économique de salariés “ordinaires” dans le cadre d’une réorganisation pour sauvegarde de la compétitivité. La tendance jurisprudentielle se satisfaisant, pour caractériser la menace pour la compétitivité, d’une évolution défavorable du marché dont les conséquences se font ressentir sur les indicateurs économiques de l’entreprise (Cass. soc., 27 mars 2012, n° 11-14.223 ; Cass. soc., 5 juin 2012, n° 11-21.110). Rappelons, à cet égard, que constitue un motif économique la réorganisation décidée pour prévenir des difficultés à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences pour l’emploi, sans être subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement (Cass. soc., 11 janv. 2006, n° 04- 46.201 ; Cass. soc., 27 janv. 2009, n° 07-41.738). A noter, en revanche, que n’est pas un motif économique valable la réorganisation pour réaliser plus de profits (Cass. soc., 29 mai 2001, n° 99- 41.930), améliorer les marges qui sont déjà positives (Cass. soc., 13 sept. 2006, n° 05-41.665) ou optimiser la rentabilité (Cass. soc., 17 déc. 2014, n° 13-22.635).
Or la cour administrative d’appel a refusé de prendre en compte cette dégradation prévisible du secteur d’activité, et a donc jugé qu’il n’existait pas de menace sur la compétitivité de l’entreprise en raison de l’absence de dégradation prévisible de la position concurrentielle de l’entreprise sur son secteur d’activité.
Pour le Conseil d’État, il s’agit d’une erreur de droit, il fallait vérifier les deux. L’arrêt est donc annulé et l’affaire est renvoyée devant la même cour administrative d’appel, laquelle devra vérifier la dégradation prévisible de ce secteur d’activité. Si celle-ci est reconnue, le licenciement et son autorisation pourront être validés.
Séverine Baudouin
[Veille JO] Les textes parus cette semaine : emploi, nominations, Outre-mer, protection sociale
20/02/2026
Voici un récapitulatif des textes parus au Journal officiel (JO) du vendredi 13 février au jeudi 19 février inclus, avec les liens renvoyant aux articles que nous avons pu faire sur ces sujets.
► Nous ne traitons pas ici les textes liés aux conventions collectives, car nous vous proposons tous les mois un baromètre des branches sur ces nouveautés.
Pour les derniers arrêtés de représentativité dans les branches, voir notre infographie régulièrement mise à jour.
Emploi
- Un arrêté du 12 février 2026 fixe le montant de la participation de l’État au financement de la contribution au développement de l’emploi pour le premier semestre de l’année 2026
Fonction publique
- Un arrêté du 17 février 2026 porte application de l’article 44 du décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l’État en matière de congés
- Un décret du 16 février 2026 modifie les modalités de représentation du personnel de la Caisse nationale de l’assurance maladie au sein de son conseil
Nominations
- Un arrêté du 13 février 2026 porte nomination au cabinet de la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative (Sophie Portier)
- Un arrêté du 12 février 2026 porte nomination au cabinet de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées (Axel Joly)
- Un arrêté du 9 février 2026 porte nomination d’une directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité (Christelle Henriol)
Outre-mer
- Un arrêté du 19 janvier 2026 porte approbation de la délibération du Comité national pour l’emploi concernant le référentiel relatif aux critères d’orientation des demandeurs d’emploi en Guyane et à La Réunion
Protection sociale
- Un arrêté du 17 février 2026 modifie l’arrêté du 9 février 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux
- Un arrêté du 5 février 2026 fixe pour 2026 le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie versée à la Plateforme des données de santé
Source : actuel CSE
Loi de finances : la taxe prud’homale et l’exclusion du permis du CPF sont jugées constitutionnelles
20/02/2026
Saisi de plusieurs recours contre la loi de finances 2026, le Conseil constitutionnel a rendu hier soir sa décision.
► Un groupe de députés estimaient que l’article 128, qui instaure une taxe de 50€ pour toute action devant les prud’hommes ou les tribunaux judiciaires, ne tenait compte ni des facultés contributives des justiciables, ni de la vulnérabilité de certains d’entre eux, cette disposition méconnaissant le droit à un recours juridictionnel effectif et les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.
À l’inverse, les Sages jugent cet article conforme à la Constitution. La disposition, estiment les juges, “ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction”. Par ailleurs, peut-on lire dans la décision, “au égard au montant de la contribution et aux conditions dans lesquelles elle est due, ces dispositions n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Les griefs tirés de la méconnaissance de ces principes doivent donc être écartés”.
► Un autre point contesté par les députés était l’article 203 qui réserve aux seuls demandeurs d’emploi et aux salariés bénéficiant d’un co-financement d’un tiers la possibilité d’utiliser leur compte personnel de formation (CPF) pour financer la préparation de ce permis de conduire.
Les Sages valident là-aussi cet article. En réservant aux demandeurs d’emploi et à certains salariés l’utilisation du CPF pour financer leur permis, le législateur, dit le Conseil constitutionnel, a poursuivi “un objectif d’intérêt général”. D’autre part, l’absence de permis pour ces catégories est considéré par les juges comme “un obstacle à l’accès à l’emploi” qui justifie donc un droit particulier. “Le législateur a donc traité différemment des personnes placées dans des situations différentes. Cette différence de traitement est en outre en rapport direct avec l’objet de la loi. Dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et d’égal accès à la formation professionnelle doivent être écartés”.
► Le Conseil déclare en revanche contraires à la Constitution d’autres dispositions dans plusieurs articles sur la plus-value (art. 59), la fiscalité sectorielle (art. 69), les douanes et les collectivités (art. 99), les changements de noms concernant les échanges de renseignements en matière fiscale (art. 124), la redevance (art. 160), une dérogation à la règle du secret professionnel en matière fiscale au profit du Centre national du cinéma et de l’image animée (art. 170), le loyer de solidarité (art. 180), le mode de ratification du budget par les collectivités (art. 200).
► La loi de finances 2026 a donc été publiée dès ce vendredi 20 février au Journal officiel.
Source : actuel CSE
Le marché cadre ralentit, mais certains métiers accélèrent
20/02/2026
Alors que le marché de l’emploi cadre marque le pas, plusieurs professions continuent de progresser. Selon l’édition 2026 de l’étude “Métiers cadres porteurs” que l’Association pour l’emploi des cadres (Apec) a publié hier, les métiers “poids lourds” (dépassant le seuil de 4 500 offres publiées en 2025) restent dominés par les comptables (17 800 offres en 2025), devant les développeurs (12 690) et les chargés d’affaires (10 470).
Du côté des métiers “Formule 1” (dont l’évolution par rapport à 2024 est la plus élevée), les responsables d’agence emploi enregistrent la plus forte hausse d’offres entre 2024 et 2025 (+36 %). Les métiers de la santé suivent de près, avec des progressions marquées pour les médecins coordinateurs (+35 %), médecins de prévention (+27 %) et infirmiers (+17 %).
Les métiers des études, de la recherche et des travaux confirment leur dynamisme, notamment dans la construction et l’aménagement du territoire : les offres pour les directeurs des travaux progressent de 11 % et celles pour les économistes de la construction de 6 %. Enfin, la montée en puissance des besoins en analyse de données se traduit par une hausse de 10 % des offres pour les data engineers, entre 2024 et 2025.
Source : actuel CSE
JOP 2030 : le Conseil constitutionnel saisi sur les dérogations au repos dominical
20/02/2026
Plus d’une soixantaine de députés des groupes La France insoumise ainsi qu’Écologiste et social ont saisi, le 13 février, le Conseil constitutionnel au sujet des dispositions relatives au repos dominical prévues dans le projet de loi d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030. Le texte a été définitivement adopté le 3 février par l’Assemblée nationale et le 5 février par le Sénat.
Au cœur de la contestation figure l’article 30, qui autorise les préfets à accorder des dérogations au repos dominical dans les communes accueillant des sites de compétition, mais aussi dans les communes limitrophes ou situées à proximité. Cette possibilité serait ouverte du 1er janvier au 31 mars 2030, alors même que les Jeux ne dureront qu’une quinzaine de jours.
Les députés dénoncent une “atteinte au droit de repos et à la protection de la santé”, estimant que le champ d’application du dispositif est “très large”. Ils pointent notamment l’extension des dérogations à un périmètre motivé par “l’affluence exceptionnelle attendue des touristes et des travailleurs”, ainsi qu’à un vaste ensemble de commerces, les “établissements de vente au détail mettant à disposition des biens ou des services”.
Autre grief : l’absence de garanties concernant le volontariat des salariés. Si le texte prévoit que le travail dominical repose sur la base du volontariat, “aucun mécanisme n’est prévu pour garantir ce critère et empêcher toute sanction en cas de refus”, soulignent les parlementaires.
Pour les deux groupes politiques, ces dispositions portent “une atteinte disproportionnée au principe du repos dominical et aux libertés fondamentales des travailleurs”.
Source : actuel CSE

