Deux arrêtés de représentativité dans l’enseignement privé et agricole
30/06/2025
Deux arrêtés de représentativité de branche ont paru, vendredi 27 juin, au journal officiel, suite à l’annulation, par la cour d’appel de Paris le 2 avril 2025, des deux arrêtés de représentativité précédents.
► Dans la convention collective nationale de l’enseignement privé à but non lucratif (IDCC n° 3218), sont représentatives :
- la CFDT, avec un poids de 43,80 % ;
- la CFTC, avec 31,89 % ;
- le SPELC (syndicat professionnel de l’enseignement libre catholique) avec 24,31 %.
►- Dans la convention collective nationale des établissements d’enseignement et organismes de formation aux métiers du territoire (EOFMT) (IDCC n° 7520), sont représentatives :
- la CFDT avec 69,43 % ;
- la CFTC avec 16,57 % ;
- le SPELC (syndicat professionnel de l’enseignement libre catholique) avec 14 %.
► Rappel : suite au dernier cycle d’élections professionnelles permettant la mesure d’audience des organisations syndicales, de nouveaux arrêtés de représentativité de branche vont être pris de juin à décembre 2025.
Source : actuel CSE
Sidérurgie : les syndicats face au désengagement de l’État
02/07/2025

Marylise Léon, Sophie Binet face à Emmanuel Macron, Valentin Rodriguez, Xavier Le Coq
Alors que les syndicats alertent sur la situation de la sidérurgie, l’Etat français semble aux abonnés absents. Face aux attentes considérables, la puissance publique ne donne que peu d’engagements. Emmanuel Macron accepte tout juste le sauvetage de certains sites. Et si tous les syndicats ne défendent pas la nationalisation des entreprises en danger, les effets des plans sociaux risquent de mettre en danger des filières stratégiques. Revue du débat.
“Je ne vais pas nationaliser ArcelorMittal parce que ce serait dépenser des milliards d’euros. Nous allons sauver et Dunkerque et Fos, (…) en ayant une politique européenne qui protège notre acier. (…) La réponse, ça n’est pas nationaliser mais avoir des garanties de développement”.
Telle fut la réponse du Président de la République à Sophie Binet, qui lui demandait quand nationaliserait-il ArcelorMittal, lors du débat organisé sur la chaîne TF1 le 13 mai 2025. Une fin de non-recevoir envoyée à la secrétaire générale de la CGT.
Le deuxième syndicat français défend une participation beaucoup plus importante de l’État dans les entreprises françaises, dans le but d’en défendre les emplois mais aussi les intérêts stratégiques du pays alors que la concurrence de la Chine sur un acier produit à bas coût ne cesse de fragiliser le secteur, y compris au niveau européen.
Pour autant, la CGT prêche seule cette solution, qui n’est défendue ni par la CFDT ni à Force Ouvrière. Mais pour en comprendre les enjeux, revenons d’abord sur un peu d’histoire industrielle.
De l’État stratège à l’État simple opérateur
En 1936, sous l’égide du gouvernement Front Populaire de Léon Blum, la France nationalise plusieurs secteurs, en particulier les entreprises de l’armement. La loi du 11 août sur la nationalisation de la fabrication des matériels de guerre, abrogée en 2004, vise aussi bien les armes à feu, les munitions, les matériels de transport et les protections contre les gaz de combat.
Peu de temps après, le décret-loi du 31 août 1937 portant réorganisation du régime des chemins de fer approuve la convention entre le ministre des Travaux publics, la plupart des compagnies privées et administrations de chemin de fer et crée ainsi la société nationale des chemins de fer français. La convention entrera en vigueur au 1er janvier 1938, le capital de la SNCF revenant à 50 % pour l’État.
À la même période, l’État affermit son contrôle sur la Banque de France et nationalise le secteur de la construction aérienne. Il faudra attendre 1945 pour assister à une seconde vague d’engagement de l’État sur Renault, les Charbonnages de France, les houillères des bassins du Nord et du Pas-de-Calais, la Banque de France ainsi que des compagnies d’assurance, de gaz et d’électricité.
Enfin, une dernière vague surgit en 1981 sous la présidence de François Mitterrand : le plan Mauroy nationalise de nombreuses banques (Crédit Lyonnais, Crédit du Nord, Crédit commercial de France…), des entreprises sidérurgiques (Sacilor et Usinor, ancêtre d’Arcelor) et de hautes technologies (Thomson, Saint-Gobain, Péchiney, Rhône-Poulenc).
Sous son second septennat, après la vague de privatisations du gouvernement Chirac de 1986, François Mitterrand adopte la politique du “ni-ni” : ni nationalisation ni privatisation. Les trois entreprises Rhône-Poulenc, Usinor-Sacilor et Péchiney sont privatisées entre 1993 et 1995, avant que le désengagement de l’État ne devienne la règle sous la présidence de Jacques Chirac. En 2017, Emmanuel Macron nationalise la société de construction navale STX France avec 100 % du capital appartenant à l’État. Rappelons aussi la loi du 11 avril 2024 qui acte la détention à 100 % du capital d’EDF.
Pour autant, si l’on s’en tient aux chiffres de l’Insee, l’État semble bien avoir pris un tournant néolibéral actant son désengagement, à rebours de ce qu’attendent les syndicats : fin 2015, la puissance publique contrôlait majoritairement 1 625 sociétés, couvrant 800 000 salariés. En 2022, le nombre de sociétés atteignait 1 888 mais le nombre de salariés se limitait à 572 000. Comme le montrent les courbes de l’Insee, le nombre de sociétés augmente, alors que le nombre de salariés baisse.
2025, le cas ArcelorMittal revient
Groupe européen ayant son siège au Luxembourg, Arcelor naît de la fusion en 2002 de trois sidérurgistes : le Français Usinor, l’Espagnol Arecalia et le Luxembourgeois Arbed. Employant jusqu’à 98 000 personnes dans 60 pays avec un chiffre d’affaires de 26 milliards d’euros en 2003, le groupe fermera pourtant le site de Florange.
Le géant européen de l’acier attire la convoitise de l’Indien Mittal qui annonce une opération publique d’achat (OPA) hostile en 2006. La suite de l’histoire contient de nombreuses promesses politiques non tenues : celle de Nicolas Sarkozy de sauver Gandrange en 2008. L’État n’intervient finalement pas et après l’engagement de la direction à limiter la casse sociale, le site fermera en 2009. La CFDT de l’époque qualifiera le dossier de “mensonge d’État”.
La promesse de François Hollande en 2016, de sauver les hauts-fourneaux de Florange mis à l’arrêt en 2011, donc avant le début de son quinquennat. S’il refuse de nationaliser en suivant Arnaud Montebourg, le chef socialiste de l’État dira toujours avoir “respecté ses promesses” en considérant qu’après tout, les 650 salariés auront été reclassés.
L’histoire ne devait pas s’arrêter là. 23 avril 2025 : ArcelorMittal annonce supprimer 600 postes en France dont 295 à Dunkerque, 194 dans ce qu’il reste de Florange, 97 à Basse-Indre et une cinquantaine sur les cinq autres sites. Le 13 mai, les représentants des organisations syndicales CGT (majoritaire), FO, CFDT, CFE-CGC entament la négociation du plan de sauvegarde de l’emploi avant que le soir-même, Sophie Binet interpelle le président de la République avec la réponse que l’on sait.
La CGT prêche seule pour la nationalisation
Lors d’une table ronde organisée par l’Association des journalistes de l’information sociale le 27 juin dernier, Sophie Binet a développé sa vision du rôle de l’État dans les entreprises : “On constate aujourd’hui que l’État stratège a disparu et qu’il n’existe pas de politique ni de vraie stratégie industrielle et environnementale, il y a zéro stratégie”.
La secrétaire générale de la CGT défend donc la coordination du sauvetage des emplois avec la préservation de l’environnement. Elle voudrait également que l’État qui s’engage dans un secteur d’activité protège également toute la filière en amont (les producteurs de matière première) et en aval (les sous-traitants).
Sur Arcelor, elle avance que “toutes les craintes de la CGT se confirment, Mittal renonce également à investir en Allemagne, il prépare son désengagement du continent européen”. Sophie Binet en appelle donc aux États européens afin de construire “une politique coordonnée conduisant à créer un Airbus de l’acier”, en référence à la compagnie aérienne qui rivalise avec efficacité à Boeing, sa concurrente américaine.
La CGT du site de Dunkerque a également produit une proposition de nationalisation documentée par deux économistes, Tristan Auvray et Thomas Dallery. Ils évaluent le coût de l’opération entre 500 millions et 1 milliard d’euros pour l’État français et proposent par exemple que l’activité soit soutenue par la commande publique en lieu et place des aides financières sans contrepartie. Par comparaison, la nationalisation de STX pour sauver les chantiers navals de Saint-Nazaire des griffes d’un repreneur italien problématique n’aurait coûté que 80 millions d’euros à l’État.
Nationaliser Dunkerque ou Florange “n’a pas de sens”
Pour autant, la responsable de la CGT n’est pas suivie par les deux autres grandes organisations syndicales. A la CFDT, Marylise Léon tire elle aussi la sonnette d’alarme sur la disparition programmée du secteur : “L’engagement de l’État, sa prise de responsabilité, assumer des participations dans les entreprises, c’est important. Je pense qu’on a besoin de ce type de politique nationale pour pouvoir influer et que l’État joue son rôle”, a-t-elle plaidé.
Si elle partage la vision de la CGT sur la protection des filières et la coordination de politiques industrielles et environnementales, la CFDT ne voit pas la nationalisation comme une solution. Selon Jean-Marc Vécrin, coordinateur syndical, “le groupe Arcelor a son siège au Luxembourg et tous les brevets lui appartiennent. On travaille en filière, donc nationaliser un site comme Dunkerque ou Florange, ça n’a pas de sens, ou alors on nationalise l’ensemble, on est quand même 15 000 salariés, ça me paraît très compliqué”. Un seul point fait l’unanimité syndicale : la conditionnalité des aides publiques.
“La nationalisation ne garantit pas de prix compétitif”
À Force Ouvrière, on ne porte pas non plus la nationalisation. Pour le secrétaire général de la fédération FO Métaux, Valentin Rodriguez, “la nationalisation ne garantit pas de vendre l’acier à un prix compétitif. Elle ne garantit pas non plus le maintien des emplois”. Rappelant que la production d’acier constitue l’acte de naissance de la première communauté européenne (la CECA, Communauté européenne du charbon et de l’acier en 1951), il soutient la décarbonation des aciéries sous condition “d’un soutien massif mais conditionné aux investissements, une production intelligente de notre marché intérieur et une tarification énergétique adaptée”. Il défend “un protectionnisme intelligent et des politiques qui protègent, non qui affaiblissent”. Valentin Rodriguez revendique enfin “un moratoire temporaire sur certaines normes environnementales le temps de rassembler syndicats, industriels, experts et Etat pour construire une trajectoire crédible”.
À la CFE-CGC, on voit la nationalisation comme “une très mauvaise idée”. Selon Xavier Le Coq, coordinateur chez ArcelorMittal, “le Groupe est trop intégré pour qu’une nationalisation des seuls sites français soit pertinente ou efficace”. Il défend en revanche une prise de participation des États européens concernés par la production d’acier au sein d’ArcelorMittal : “Cela permettrait des projets communs (la décarbonation par exemple) et cohérents avec la vision à moyen terme de l’UE. Plusieurs pays pourraient, ensemble, revendiquer un poste d’administrateur du Groupe, l’instance où sont prises les décisions stratégiques”.
En attendant le développement de stratégies industrielles en France et en Europe, le débat resurgit aujourd’hui devant le Sénat : les représentants syndicaux sont conviés à une audition sur leur vision de l’économie française. Mais pour l’instant, Emmanuel Macron n’a pas précisé quand les sites de Fos et Dunkerque seraient sauvés ni par quel moyen. Au ministère de l’industrie, Marc Ferracci s’était engagé à réunir les syndicats chaque mois voire chaque semaine afin de constituer une cellule de crise. Nous avons interrogé les syndicalistes concernés : cette réunion ne s’est tenue qu’une seule fois.
| Les bonnes intentions du plan européen pour l’acier |
| Le 19 mars 2025, la Commission européenne a présenté les axes de son plan pour l’acier. Il prévoit l’investissement de 150 millions d’euros issus du Fonds de recherche pour le charbon et l’acier et une “vente aux enchères pilote” d’1 milliard d’euros pour soutenir la décarbonation. Le reste du plan ressemble à un catalogue de bonnes intentions avec peu de traductions concrètes et sans délai de réalisation : – Réduire les coûts de l’énergie pour les industries à forte consommation d’énergie grâce à des accords d’achat d’électricité ; – Accélérer l’accès aux infrastructures énergétiques ; – Renforcer la sauvegarde actuelle de l’acier pour tenir compte des dernières évolutions du marché, etc… (lire la fiche d’information). Un plan qui a le mérite d’exister mais dont on peut s’interroger sur les capacités à faire face aux surproductions chinoises mises sur le marché à très bas coût. De plus, selon le rapport “Perspectives de l’acier” de l’OCDE pour 2025, la concurrence est faussée car les aides chinoises en pourcentage du chiffre d’affaires sont dix fois supérieures à celles des pays de l’OCDE. Enfin, la décarbonation mettra les producteurs face à un défi de taille : les fours électriques ne disposent que de la moitié des capacités de tonnage de production d’acier comparés à leurs grands frères thermiques… |
Marie-Aude Grimont
Décret grandes chaleurs : Solidaires réclame que des températures maximales pour le travail soient fixées
02/07/2025
Pour Solidaires, le décret du 27 mai sur la prévention des effets des épisodes de grande chaleur sur la santé des travailleurs, un texte entré en vigueur le 1er juillet, présente de “sérieuses limites”.
Le décret, déplore l’union syndicale, ne fixe pas de températures maximales de travail.
“Il existe pourtant bien des températures maximales au-delà desquelles, quelle que soit la situation, l’organisme humain doit se préserver et donc arrêter de travailler, estime Solidaires. L’INRS, l’institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, considère qu’au-delà de 30 °C pour une activité sédentaire et 28 °C pour une activité légère, la chaleur peut constituer un risque pour les salariés. Aux alentours de 40 °C, le risque d’hyperthermie peut devenir un risque mortel, et bien en deçà de cette température, l’exposition prolongée à la chaleur est un facteur de risque établi . Il devient donc essentiel de définir des températures maximales au-delà desquelles le travail doit s’arrêter. Rappelons que le premier principe de prévention est d’éviter les risques… et donc de soustraire les travailleurs aux chaleurs intenses !”
Quant à la mise en demeure prévue par le décret (l’inspection du travail peut mettre en demeure l’employeur de se conformer à la réglementation), Solidaires regrette que le délai donné à l’employeur pour agir soit de 8 jours : “Outre le fait que les épisodes de canicule durent rarement autant de temps, qu’en est-il des conditions de travail en attendant ?”
Source : actuel CSE
Pour l’Ugict-CGT, le management est aussi une affaire syndicale
03/07/2025

M. Flécher, L. Le Gros, H. Bergeron, P. Godineau, J. de Carlos, M. Verret, P. Conjard, F. Laloie, A. Dervieux, W. Lis
L’organisation par la CGT d’une journée de débat à Sciences Po Paris autour de la question du management avait de quoi surprendre… un peu moins quand on précise qu’il s’agissait de l’Ugict, le syndicat des cadres et techniciens de la CGT, et que les débats ont permis d’aborder la question de la qualité du travail. Compte-rendu.
Au cœur du quartier bourgeois de Saint Germain en plein Paris, l’Ugict-CGT avait investi les locaux de Sciences Po, le jeudi 26 juin, pour proposer à ses adhérents une journée de débats et de réflexions autour du management, en écho au contenu de son dernier journal trimestriel (1).
“Voir la CGT ici, dans les murs de Sciences Po, n’étonnera que ceux qui n’ont de nous qu’une image d’Epinal. Tous les autres savent que notre projet est de transformer le travail avec les cadres, les ingénieurs et les techniciens afin de permettre à tous de bien travailler”, a prévenu Sylvie Durand, secrétaire nationale Ugict-CGT en introduisant la journée.
Les cadres doivent animer des équipes sur la base d’objectifs parfois inatteignables vus les moyens
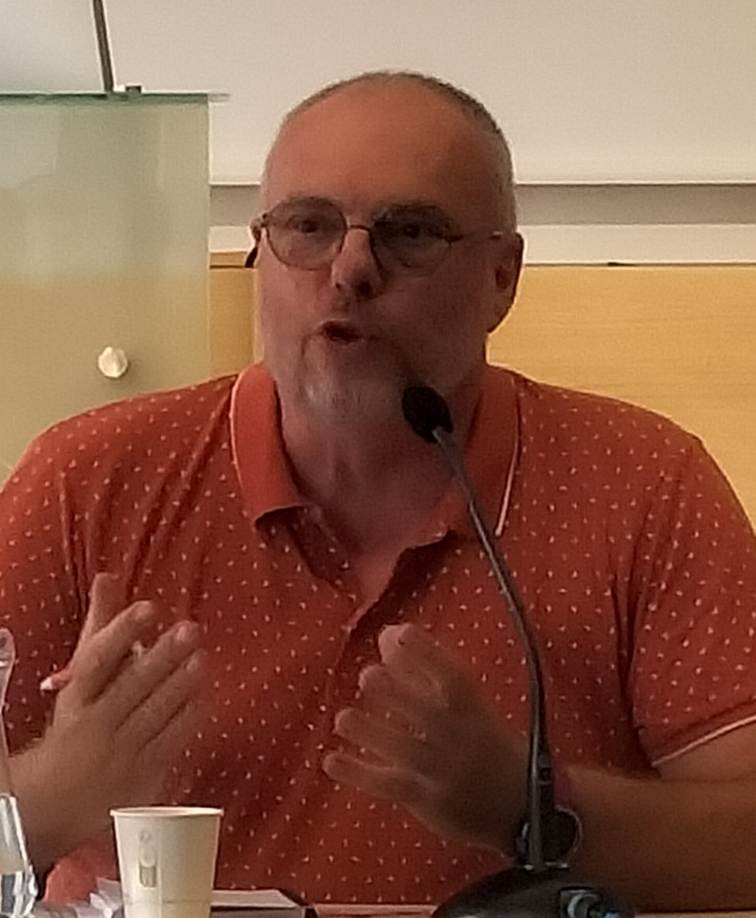
Comme l’a souligné Alain Dervieux, ex-manager chez Thales et co-pilote du pôle cadres à l’Ugict, les cadres sont pris entre le marteau et l’enclume. Pris entre les salariés dont il faut organiser le travail, et un top management “fixant des objectifs de rentabilité parfois intenables compte-tenu de moyens insuffisants”. La CGT, soutient Alain Dervieux, doit donc s’intéresser à ces populations de cadres et de techniciens pour promouvoir “un autre management, un management plus humain et moins toxique, qui respecte l’humain pour pérenniser l’homme comme l’activité”.
Le travail est malade de la financiarisation du capitalisme
Aux yeux de Sylvie Durand, nous en sommes loin : le travail, accuse-t-elle, est malade de la financiarisation du capitalisme. Malade d’un “wall street management qui entend rompre le lien entre les managers et les professionnels qu’ils managent”.
Ce faisant, non seulement les managers perdent tout pouvoir pour agir sur l’organisation du travail, soutient Sylvie Durand, mais ils paient aussi de leur santé (risques psychosociaux, burn out, suicides) “la maltraitance qu’ils subissent du fait d’un top-management” complètement coupé des réalités des activités et des métiers. Une maltraitance qui vient aussi, parfois, des salariés eux-mêmes “et des syndicalistes qui ne comprennent pas qu’il ne sert à rien de stigmatiser des cadres mais qu’il faut leur donner des espaces afin de construire un management alternatif”.
“On ne se rebelle pas contre l’organisation”
Voir un syndicat prendre à bras le corps une telle thématique a réjoui Henri Bergeron, sociologue au CNRS et doyen de l’École d’affaires publiques de Sciences Po : “À Sciences Po, nous formons aux métiers, mais nous donnons aussi aux étudiants des outils pour décrypter les organisations, pour savoir lire un organigramme, comprendre ce qui se joue, les personnes clés” (2).
À la commission d’évaluation des formations et diplômes de gestion, nous réagissons en cas de baisse du taux de boursiers ou lorsque les salaires des jeunes diplômées sont inférieurs à celui des diplômés

Des outils critiques trop souvent absents des formations des grandes écoles (3). William Lis, un ingénieur mandaté par la CGT à la Commission d’évaluation des formations et diplômes de gestion (CEFDG), veille à ce que cela change : “Nous portons dans cette commission une volonté d’ouverture avec un minimum de 25 % de boursiers dans les formations visées par l’État. Si ce taux baisse, nous réagissons. Nous veillons aussi à ce que les jeunes femmes aient le même salaire à la sortie que les jeunes hommes”.
Et le syndicaliste de raconter cet exemple révélateur : “Une école prestigieuse voulait nous faire avaliser un projet de MBA présentant un cursus de 70 heures par semaine, 70 heures par semaine d’échanges pédagogique en face à face. J’ai dit que si l’on commençait ainsi, il ne faudrait pas ensuite s’étonner de rendre les jeunes cadres de plus en plus vulnérables aux addictions. Heureusement, la commission m’a suivi et nous n’avons pas validé ce MBA”.
Les incessantes “transfo”
Les débats ont logiquement abordé les transformations incessantes des organisations, dans le privé comme le public.
Des changements conduits avec force cabinets de conseils, et “beaucoup de communication”, selon les mots d’Henri Bergeron.
Quand un dirigeant pense qu’il y a un problème de compétence, il lance une formation avec du coaching, comme si cela pouvait transformer du jour au lendemain des managers autoritaires en managers participatifs

Pour lancer un programme de transformation, a poursuivi le chercheur du CNRS, les dirigeants se focalisent sur deux points en ignorant la question centrale du pouvoir : “En cas de sous performance, ils pensent qu’elle est due à un mauvais process et une mauvaise organisation. Donc ils changent les règles et l’organisation. S’ils jugent qu’il y a un problème de compétences, ils lancent des vagues de coaching et de formation des cadres, comme s’il existait des formations capables de faire passer des personnes d’un statut de manager autoritaire à un statut de manager réussissant à tout faire faire sans contrainte”.
Un constat partagé par Patrick Conjard, directeur de l’Agence régionale pour l’amélioration des conditions de travail (Aract) Auvergne-Rhône-Alpes : “Il ne suffit pas de dire « si on a de bons managers, on n’aura pas de risques psychosociaux » et de former les cadres pour que tout s’arrange. Il y a un modèle d’organisation qui entraîne un « management empêché »”.
Jamais nous ne sommes associés aux décisions, en amont
Ces décisions qui tombent d’en haut laissent bien des cadres sceptiques, témoin la réaction de cette femme présente dans la salle : “Dans mon équipe, on nous demande de nous exprimer pour savoir comment on pourrait appliquer ce qui a été décidé, mais jamais nous ne sommes associés en amont à la décision”. Et William Lis d’ironiser : “Quand vous avez vendu un projet à votre équipe et qu’à peine deux ans plus tard, on vous dit que c’était nul et que le nouveau plan de transfo est beaucoup mieux, comment dire ?!”
À propos des réorganisations, l’ancien manager de Thalès Alain Dervieux a donné ce conseil malicieux aux militants de l’Ugict : “Gardez les organigrammes qui vous sont présentés en CSE, vous verrez que les solutions proposées au fil des années sont parfois très différentes !”
Il existe pourtant une forme de consensus, y compris à l’échelle européenne, sur ce qu’est, ou ce que serait, un bon management. C’est l’idée d’un management non autoritaire, qui parvient à faire faire quelque chose à quelqu’un sans recourir à l’argument d’autorité. “A partir du moment où le manager se sert de l’argument de subordination et d’autorité, il risque d’être ensuite en difficulté. Piquer une gueulante un jour vous expose ensuite à la résistance passive de vos équipes”, constate Henri Bergeron.
“La santé des salariés est améliorée quand vous les faites vraiment participer”
Cette idée d’un bon management, Frédéric Laloue, inspecteur des affaires sociales, l’a creusée dans le rapport qu’il a co-écrit pour l’Igas (4).
Pourquoi l’inspection générale des affaires sociales s’est-elle intéressée à cette question a priori loin de son domaine ? “Dans les pratiques des entreprises, il y a des choses ayant un impact positif ou négatif sur la santé et donc sur nos politiques publiques de santé, d’emploi, d’insertion”, explique-t-il. D’où l’idée de voir comment caractériser, à l’échelon européen, ce que serait un bon management afin d’en faire bénéficier, en quelque sorte, toute la société.
Et là, surprise : “Nous pensions nous retrouver face à des attentes différentes sur ce que doit être le management. Mais nous avons eu une forme de consensus sur ce qu’est un management efficace : c’est celui qui permet un bon degré d’autonomie, nous ont dit tant des représentants du monde du travail que ceux des sciences de gestion. Quand vous demandez la participation des salariés dans la définition et l’organisation de leur tâche, leur santé est améliorée. Si en revanche vous le leur demandez mais qu’il n’en sort rien, c’est encore pire pour leur santé”, constate l’inspecteur.
En France, plus qu’ailleurs en Europe, les managers n’ont pas confiance dans les salariés, et réciproquement

Cela suppose donc une participation directe et indirecte, via les représentants du personnel, mais aussi une reconnaissance de la possibilité d’expérimenter, des échelons hiérarchiques pas trop nombreux et un reporting limité.
Or la France, malgré “une panoplie assez fournie” d’outils légaux (qualité de vie et des conditions de travail, droit d’expression, etc.), remplit trop peu ces critères : le niveau d’autonomie et de reconnaissance y est moins élevé que la moyenne européenne, “et cela entraîne des relations de confiance dégradées entre salariés et hiérarchie”.
En France, les salariés parlent peu du travail au travail
Faute d’un dialogue professionnel et social, moins présent en France qu’en Allemagne, en Suède ou en Italie selon Frédéric Laloue, la défiance est réciproque : le management n’a pas confiance dans les salariés et vice-versa.
Un vrai cercle vicieux, d’autant que “l’injonction à faire du participatif ne se décrète pas”, comme l’a remarqué Patrick Conjard. Et le directeur de l’Aract d’Auvergne-Rhône-Alpes d’observer que 40 % des salariés parlent rarement du travail dans leur univers de travail : “Animer une discussion sur le travail n’est pas si facile pour un manager, les modèles d’organisation ne prévoient pour cela ni temps ni espace”.
L’obéissance vue comme une loyauté non négociable
Pourquoi ce modèle participatif n’émerge-t-il pas en France ? “Parce que chez nous l’obéissance est exigée de façon inconditionnelle. Les managers intériorisent tout un tas de mécanismes, dont celui qui assimile tout désaccord exprimé à un manque de loyauté. Dans le public, les cadres ne sont pas du tout formés à l’animation d’équipes, mais à la gestion de contraintes budgétaires de plus en plus fortes”, répond Jésus de Carlos, membre du bureau de l’Ugict.
“Pourquoi le droit d’expression prévu par les lois Auroux n’est-il pas appliqué ? Parce que les salariés n’ont pas confiance pour s’exprimer, ils n’ont pas la garantie que cela ne se retournera pas contre eux. Même les dispositifs mis en place par les entreprises pour le droit d’alerte n’inspirent pas confiance, surtout quand les salariés apprennent, par exemple, que le déontologue fait partie du comité exécutif”, abonde Agathe Le Berder, secrétaire générale adjointe de l’Ugict-CGT.
Pourquoi les salariés ne sont pas écoutés ? Parce que ce n’est pas l’intérêt des multinationales ! Aux Etats-Unis, les propos des salariés sur les réseaux sociaux sont scrutés de près par les employeurs…

“Pourquoi ça ne marche pas ? Mais parce que ce n’est pas l’intérêt des multinationales”, renchérit Marc Verret. Pour “coaliser une majorité silencieuse”, ce manager audit a monté un syndicat CGT chez EY (ex-Ernst & Yougn) “en compilant un à un des contacts LinkedIn puisque nous ne pouvons pas nous adresser aux salariés par le mail professionnel”.
Pour lui, c’est seulement un rapport de forces qui peut bousculer l’ordre établi et dépasser le rôle purement consultatif du CSE : “Il nous repenser le cadre français. Prévoir davantage d’expressions libres et directes pour les salariés, mais aussi davantage d’administrateurs salariés dans les conseils d’administration”.
Précisons que Marc Verret se bat “pour que l’entreprise respecte la limite européenne de 48 heures de travail hebdomadaire”, une limite qu’un accord d’entreprise a supprimée.
La multiplication des “after”
Qu’il a semblé loin, très loin de ces aspirations syndicales, le monde décrit par la jeune chercheuse Marion Flécher, maîtresse de conférences à Paris-Nantes et associée au Centre études emploi et travail (CEET).
La sociologue, qui s’est immergée dans le monde des start-up, a fort bien décrit comment ces organisations poussent leurs équipes au surinvestissement. Non pas par la contrainte, mais par une forme de contrôle social aux allures festives : ce sont les “afterworks” très nombreux, ces temps de partage festifs après le travail. Il faut y être, ce qui devient plus difficile pour les femmes quand l’enfant paraît, alors que les hommes continuent eux de pouvoir se libérer…
Dans les start up, les salariés sont conduits au surinvestissement non par la contrainte, mais par une forme de contrôle social, à l’occasion d’échanges festifs comme les afterworks

Un univers souvent “macroniste et anti-syndicats, où tout se règle en one to one”, y compris les ruptures de contrat, et où il faut “faire kiffer” les salariés. Et chez des jeunes diplômés parfois déçus de leurs premiers pas ennuyeux dans une grosse boite, souvent ça marche, du moins au début. “Quand vous êtes autonomes, vous êtes flattés par la confiance qu’on vous donne et vous avez tendance à vous surinvestir, d’autant qu’il y a des primes à la clé”, décrit la chercheuse.
Les afterworks sont désormais aussi pratiqués par les grands groupes, qui cherchent à retenir les jeunes
Il est frappant de voir que ces modèles sont aujourd’hui imités par les grandes entreprises, qui cherchent à séduire et à retenir les jeunes cadres. Un consultant de Secafi en a témoigné : “Avant, les moments de convivialité se faisaient sur le temps de travail, ça rassemblait tout le monde au même endroit. Avec ces afterworks à l’extérieur, on voit des dérapages, avec harcèlement et risques psychosociaux, au point que cela suscite des expertises. Il y a un des salariés qui se réfugient dans un télétravail à outrance pour se protéger de ça. Attention aussi aux boucles des réseaux, qui peuvent provoquer des phénomènes d’exclusion, les uns jouant contre les autres”.
Au final, elle résume tout, cette anecdote livrée par Philippe Godineau, un militant CGT de l’UD CGT du Rhône venu monter une liste syndicale dans une filiale d’EDF organisée en mode start-up : “Quand je suis arrivé pour signer le protocole d’accord préélectoral, j’ai discuté avec les équipes. Je leur demandais : “C’est quoi votre métier ?” On ne me répondait pas « ingénieur », comme ailleurs à EDF. Non, on m’a dit : « Mon métier ? Mais c’est mon projet ! » Tiens, tiens, ça ne vous rappelle rien ?
(1) “Manager au XIXe siècle, missions impossibles ?”, Revue Options, voir ici
(2) Pour les positions syndicales sur l’encadrement et le management, voir aussi la CFE-CGC qui a un statut catégoriel. Outre l’Ugict pour la CGT, des syndicats cadres existent aussi dans les autres confédérations, comme à la CFDT cadres, FO cadres, CFTC Cadres.
(3) Invitée à s’exprimer en préambule d’une table ronde, Attaa Ben Elafdil, présidente de l’association Mouvement T, a expliqué son action visant à inciter les grandes écoles à préparer leurs étudiants aux conditions réelles du travail en entreprise, et notamment aux questions de “harcèlement et de management toxique”, des “sujets dont on n’entend pas souvent parler durant nos études”.
(4) Voir aussi les préconisations de l’Igas sur le CSE
► L’Ugict-CGT, dont l’ancienne secrétaire générale, Sophie Binet a été élue en 2023 à la tête de la CGT, tiendra son congrès 2025 à Metz, du 18 au 21 novembre 2025.
| Changer de modèle, changer de vie : pas si simple ! |
| Témoignage d’Alain Dervieux, de l’Ugict-CGT, sur un accord passé chez Thalès : “Nous avions négocié un quota de 50 % de femmes dans les promotions professionnelles chaque année. C’était une bonne chose car cela a permis à des femmes de progresser. Mais ce que nous n’avions pas prévu, c’est la frustration et jalousie éprouvée par certains hommes, ni non plus les difficultés éprouvées par certaines femmes arrivées trop vite à un poste où tout le monde les attendait au tournant”. Dans la fonction publique, au niveau ministériel, Jésus de Carlos dit avoir vu arriver “des femmes trentenaires célibataires et sans enfant qui reproduisaient les mêmes schémas managériaux que les hommes, ce qui montre que nous sommes d’abord face à un problème d’organisation”. Confrontée aux travaux de la sociologie sur le monde du travail dans les start-ups, la DRH d’une ex-start-up (la société Brevo) a pris ses distances avec l’idée de mettre l’accent “avec outrance” sur le plaisir et le bonheur au travail : “Je ne suis pas trop à l’aise là-dessus car les jeunes arrivant des écoles peuvent avoir une “descente” en étant confrontés à la réalité. Non, tout n’est pas génial, ni exceptionnel”. Non, tout n’est pas génial, il faut redescendre ! Et Laure Rudelle-Arnaud d’ajouter : “Moi qui viens d’un groupe “classique”, je reste étonnée de voir que les salariés ne sont au CSE que pour le côté festif. Comme DRH, j’aimerais pouvoir m’appuyer sur des représentants du personnel plus structurés”. Quant aux reconversions de cadres partis refaire leur vie à la campagne dans un travail artisanal, la sociologue Ludivine Le Gros (Centre d’études de l’emploi et du travail du Cnam) a montré qu’il s’agissait, sinon d’un cliché, en tout cas d’une image réductrice. Les reconversions prennent du temps, et parfois les cadres changent seulement de secteur. La reconversion devient une mobilité comme une autre “Dans les récits de presse, on a l’impression que ces bifurcations de vie se font du jour au lendemain. Or ces reconversions prennent du temps et sont liées à des problèmes de conditions de travail, à des conflits hiérarchiques. Il faut nuancer l’idée de rupture. On minimise souvent le fait que les cadres se reconvertissent souvent comme… cadres, mais dans un autre secteur. (..) Cette injonction à l’autonomie et à la flexibilité, à être entrepreneur de leur propre carrière, les cadres l’ont si bien intégrée que la reconversion devient une mobilité comme une autre”. |
Bernard Domergue
Travail le 1er mai : les syndicats appellent les sénateurs à rejeter la proposition de loi
03/07/2025
La proposition de loi visant à étendre les possibilités de travail le 1er mai devrait être débattue aujourd’hui au Sénat.
Ce texte entend modifier l’article L.3133-6 du code du travail qui jusqu’à présent limitait le travail le 1er mai aux salariés des “établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail”. La proposition de loi entend ouvrir cette possibilité aux entreprises “dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, mentionnés à l’article L. 3132-12“. Autrement dit, le régime du 1er mai serait aligné sur les dérogations possibles au repos dominical (art. L.3132-12 du code du travail, avec repos hebdomadaire par roulement).
Dans un communiqué commun, les syndicats CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, Solidaires et FSU appellent les sénateurs à “s’opposer à cette proposition de loi”.
Le texte constitue pour ces syndicats “une première brèche remettant en cause la précieuse exceptionnalité du 1er mai, seul jour chômé et payé de l’année” : “Nous savons qu’à chaque fois qu’un principe est remis en cause, la dérogation s’étend progressivement à toutes et tous. Quant au « volontariat » mis en avant pour rassurer, il n’existe pas réellement du fait du lien de subordination inhérent au contrat de travail, d’autant plus dans les TPE. Les employeurs obligent ainsi les salariés à travailler le dimanche sous peine de licenciement, ou de non-recrutement pour les nouveaux salariés ; il en sera de même avec le 1er mai”.
Source : actuel CSE



