Quand simplification rime avec dérégulation environnementale
28/04/2025
Dans un rapport publié en mars, France nature environnement (FNE) souligne qu’en quinze ans, les réformes de “simplification” se sont traduites par une régression généralisée du droit de l’environnement et la complexification de celui-ci.
France nature environnement (FNE) dresse un bilan de quinze ans de simplification et de dérégulation, en se basant sur les retours de terrain de ses associations membre et des chiffres inédits obtenus auprès du gouvernement. De la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit jusqu’au projet de loi de simplification de la vie économique, le rapport dresse un constat préoccupant pour la prévention des atteintes à l’environnement et à la santé.
FNE montre que sous couvert de simplification, c’est bien un large mouvement de régulation qui s’est opéré avec de surcroît une complexification du droit, du fait de la multiplication des exceptions aux principes.
Une simplification en trompe l’œil
De nombreux chantiers de “simplification” ont été lancés ces dernières années par les gouvernements successifs, et d’autres sont régulièrement annoncés. La proposition semble des plus consensuelles : des règles plus simples sont normalement mieux comprises et appliquées. Et à chaque fois, il est assuré que la réforme se fera “à niveau de protection environnementale constant”.
Pourtant, souligne FNE, force est de constater qu’au fil du temps ces réformes se traduisent par une régression continue du droit de l’environnement. “Simplification” est devenu un euphémisme poli pour “dérégulation” et “régression du droit de l’environnement”, souligne FNE. Sans jamais par ailleurs que le résultat de ces réformes en matière de simplification et de gain de compétitivité réel n’ait jamais été évalué. Dans plusieurs domaines, les différentes régressions créent au contraire un droit complexifié et illisible.
Exemples de dix régressions majeures
- Diminution du nombre de projets soumis à évaluation environnementale
Exemple 1 : création du régime d’enregistrement pour les ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) avec dispense possible d’évaluation environnementale et basculement d’activités du régime d’autorisation à celui de l’enregistrement : 44 modifications de la nomenclature sont intervenues entre 2009 et 2024.
Exemple 2 : exonération d’évaluation environnementale pour certains types de projets : énergies renouvelables, raccordement à un projet industriel qualifié de projet d’intérêt national majeur…
Exemple 3 : création d’une procédure d’examen au “cas par cas” : évaluation environnementale à la discrétion de l’autorité administrative en fonction de l’impact du projet (seulement 12 % des projets sont soumis à une telle évaluation). De nombreux projets ont été retirés de l’évaluation environnementale systématique dont la plupart des ICPE et des IOTA (projets d’installations, d’ouvrages, de travaux et d’activités ayant des impacts ou présentent des dangers pour le milieu aquatique et la ressource en eau).
Exemple 4 : création d’une clause filet pour l’évaluation environnementale complexe et non appliquée (1 seule application en 2022).
- Régression de l’enquête publique
Exemple 1 : passage de 9 483 enquêtes publiques en 2013 à 3 885 en 2023. La régression s’explique par le fait que l’absence de soumission d’un projet à évaluation environnementale entraîne mécaniquement sa non-soumission à enquête publique.
Exemple 2 : la dématérialisation de l’enquête publique a entraîné une perte de qualité. Les nouvelles technologies peuvent enrichir les méthodes de participation du public, mais ne peuvent pas remplacer des dispositifs tels que l’enquête publique.
Exemple 3 : une consultation du public pour l’autorisation environnementale complexifiant le droit en créant une nouvelle procédure spécifique : consultation du public par voie électronique avec maintien d’une commission d’enquête et de réunion en présentiel.
- Concertation amont
Exemple 1 : les réformes ne permettent pas suffisamment la participation amont (débat public, concertation préalable), portant sur l’opportunité du projet : fixation de seuils financiers déconnectés de l’impact environnemental du projet, dispositif appliqué quelquefois incorrectement.
Exemple 2 : les dispositifs de concertation en amont ont été revus à la baisse avec des dispenses pour certains projets (ex : certains projets industriels ne dépassant pas un seuil financier) ou même une suppression (projet de loi de simplification) avec une réduction des délais permettant de solliciter une concertation préalable.
Exemple 3 : la confusion avec les processus de concertation aval. FNE souligne l’exonération croissante de projets soumis à enquête publique quand une concertation amont a été organisée, bien que les deux processus aient des objectifs différents : recueil de l’avis du public sur l’opportunité du projet pour la concertation amont et recueil de l’avis du public sur les modalités de mise en œuvre du projet pour l’enquête publique.
- Politique du passage en force
Exemple 1 : la volonté de « passer en mode projet », s’est traduite par une priorité donnée à la réalisation des projets, au détriment de toute autre considération, y compris sur l’objectif d’aménager le territoire de façon cohérente, adaptée aux impératifs écologiques et alignée avec les souhaits de ses habitants. Une véritable jungle dérogatoire a vu le jour (OIN, PIG, PIL, PIEM, PINM, PENE, ZAD…). De plus, pour ces projets, la procédure de participation du public est réduite tandis que celle d’adaptation des documents d’urbanisme et de planification (via une déclaration de projet) est accélérée. Dans la plupart de ces dispositifs, au lieu de demander aux projets industriels de s’insérer dans le projet de territoire élaboré collectivement, on modifie ce dernier pour laisser les porteurs de projets décider des règles qui s’appliquent à leurs projets.
Exemple 2 : le contournement de l’instruction des projets par l’administration est permis grâce à une nouvelle règle depuis 2015 consistant que le silence de l’administration vaut accord, sauf exception, l’accord tacite devenant la règle. En matière environnementale, la mise en œuvre de ce principe peut poser des problèmes : cela implique que des projets peuvent être autorisés sans que l’administration ait vérifié leurs impacts sur l’environnement et la santé humaine, faute de temps. De plus, une multitude d’exceptions s’appliquant, une décision tacite n’est pas forcément source de simplicité pour son bénéficiaire (absence de prescriptions à respecter).
Exemple 3 : on note une réduction des marges d’appréciation et d’action des juges avec des procédures, quelquefois obligatoires, de régularisation des dossiers au stade de l’instruction ou du contentieux. Cette pratique amène à favoriser des projets qui n’ont pas été initialement pensés en conformité avec le droit de l’environnement. Le fait que le projet soit déjà mis en œuvre incite la justice à ne pas demander son annulation même quand il est illégal, encourageant les passages en force.
Exemple 4 : depuis 2015, les bâtiments construits sur la base de permis de construire illégaux ne peuvent plus être détruits devant le juge judiciaire sauf s’ils se situent dans certaines zones protégées. Cela favorise là encore le passage en force (mieux vaut construire directement, sans demander l’autorisation qui aurait peut-être été assortie de contraintes, de toute manière le bâtiment une fois construit ne sera pas détruit.
- Dessaisissement des instances de concertation
Exemple 1 : l’avis du CODERST (Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques) dans le cadre des procédures applicables aux ICPE a été rendu facultatif pour les ICPE et les IOTA depuis 2017, le préfet pouvant donc ne pas le consulter. En 2020, ce caractère optionnel est généralisé à l’ensemble des ICPE. de fait entre 2017 et 2024, le nombre de consultation du CODERST a chuté de 80 %.
Exemple 2 : depuis 2019, les avis de l’agence régionale de santé deviennent facultatifs tandis que ceux de l’ONF (Office national des forêts) sont supprimés. Les commissions de suivi de site ICPE sont dorénavant dans la main du préfet. Enfin, le projet de loi de simplification prévoit la suppression de nombreux organismes consultatifs : conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, Conseil national de la montagne, initiative française pour les récifs coralliens.
- Les présomptions pour faciliter la destruction d’espèces protégées
Exemple 1 : plusieurs réglementations ont prévu une présomption de l’une des conditions permettant de bénéficier de la dérogation faune flore à savoir la raison impérative d’intérêt public majeur : énergies renouvelables, réacteur nucléaire, projet d’intérêt national majeur, projets d’industries vertes, opérations sous DUP (déclaration d’utilité publique). Ces dérogations, qui devraient dépendre non de la nature du projet mais de son contexte environnemental et socio-économique, sont probablement non conformes au droit de l’UE et créent de l’insécurité juridique.
Exemple 2 : deux projets de loi en cours risquent d’allonger notablement la liste des projets bénéficiant de la présomption aux ouvrages de stockage d’eau agricole ou encore à de nombreux autres projets ou infrastructures. Ces exemptions multiples reviendraient à priver le dispositif de toute efficacité, et aboutiraient de nouveau à beaucoup d’insécurité juridique vis-à-vis du droit européen.
- Le droit de déroger aux normes
Exemple : la possibilité du préfet de déroger à certaines normes environnementales (exemption de l’application d’une réglementation) peut se traduire par des incidences environnementales importantes et à une véritable insécurité juridiques pouvant aboutir à un contentieux. Ce mécanisme est toutefois peu utilisé : depuis 2020, sur les 543 arrêtés pris, seuls 12,2 % ont concerné le droit de l’environnement.
- Les contrôles et les sanctions en régression
Exemple 1 : les contrôles sont de plus en plus rares, que ce soit en matière d’ICPE (division par deux des contrôles en 15 ans).
Exemple 2 : les sanctions administratives demeurent peu dissuasives à l’exception des astreintes, tandis que le prononcé de sanctions judiciaires reste rare avec des alternatives aux poursuites. En outre les peines prononcées à l’égard des exploitants agricoles sont peu prononcées et sont rarement sévères.
- Les attaques contre le droit d’accès à la justice
Exemple 1 : l’accès à la justice est régulièrement réduit au prétexte de lutter contre les recours abusifs et d’assurer la « sécurisation juridique des projets ». Le but réel est de diminuer les recours à la justice en général, notamment ceux des associations de protection de l’environnement. Il ne s’agit plus alors de protéger des acteurs économiques contre des abus, mais bien de faire passer des intérêts économiques devant l’intérêt général porté par ces associations.
Exemple 2 : la diminution des délais de recours pour les tiers (dont les associations) qui disposent de moins de temps pour s’organiser et agir. FNE souligne ainsi le glissement progressif des délais de recours des tiers en matière d’ICPE, sans limite de durée à l’origine à un délai ramené in fine à seulement deux mois. Les mêmes contractions de délais ou restrictions se constatent en droit de l’urbanisme.
Exemple 3 : la suppression des degrés de juridictions par les réformes a conduit à supprimer la juridiction d’appel conduisant soit à supprimer le 1er degré de juridictions (tribunaux administratifs), soit le second (cours administrative d’appel). Cette suppression qui a trouvé à s’appliquer en matière d’urbanisme, d’éolienne terrestre, de production d’énergie renouvelable en mer, de stockage d’eau ou d’élevage, conduit à édulcorer l’examen du dossier par des juges successifs, à faire reporter la charge de l’examen au fond du dossier par le Conseil d’État qui n’est pas un juge d’appel et au final de contribuer à l’embouteillage de la justice.
Exemple 4 : la diminution de la possibilité du référé-suspension porte atteinte au droit de recours et permet indirectement le passage en force des projets. Ainsi, la nouvelle procédure d’autorisation environnementale ne permet plus au commissaire enquêteur de donner un avis favorable ou non susceptible de donner lieu à un référé suspension pour avis défavorable de ce commissaire. Idem pour les projets agricoles ou l’exercice du référé suspension est rendu plus difficile.
Exemple 5 : des obstacles ont recours se multiplient avec des modalités de publicité moindre, des conditions durcies sur l’intérêt à agir, la nécessité pour les associations d’être agréées, des obligations de notification du recours et la généralisation de la cristallisation des moyens.
- Les freins à la répression pénale
Exemple 1 : alors que le contentieux de l’environnement est insignifiant – oscillant entre 0,5 et 1 % des affaires traitées – du fait notamment d’un taux élevé de classement sans suite ou d’abandon des poursuites, les nécessaires progrès du droit pénal sont bloqués par un lobbying efficace. Ainsi, les deux délits de mise en danger de l’environnement en cas de mise en danger grave et durable de l’environnement et un délit intentionnel dit « d’écocide » sont actuellement inopérants car soumis à des conditions trop restrictives.
Exemple 2 : la dépénalisation des atteintes aux espèces protégées par la loi sur la souveraineté agricole incite à ne pas se préoccuper de la destruction d’espèces puisqu’elles ne seront plus sanctionnables pénalement, sauf en démontrant l’intention de détruire ou une négligence grave.
Des réformes de simplification aux conséquences multiples
Les législations de simplification se sont soldées par des effets négatifs assez nombreux au final.
- Absence d’efficacité des réformes
Aucun bilan n’ayant été tiré de ces réformes, rien ne permet d’affirmer qu’elles ont contribué à leurs objectifs annoncés de réduction des délais et de renforcement de la compétitivité.
À l’inverse, comme le soulignent plusieurs rapports et avis, rien ne démontre que le droit de l’environnement soit à l’origine d’une perte de compétitivité de l’industrie française.
- Perte de lisibilité et complexité accrue du droit
Sous prétexte de simplifier, la multiplication de nouveaux dispositifs dérogatoires a abouti à une situation bien plus complexe. Il peut en effet être compliqué aujourd’hui de définir les réglementations applicables à un projet. Cela est dû aux différentes dérogations et exceptions adoptées au fil du temps sous prétexte de simplifier la vie des entreprises.
De plus, ces réformes peuvent même être contreproductives, car l’instabilité juridique tend à rallonger les délais en raison du nécessaire temps d’appropriation par les différents acteurs et l’administration.
- Insécurité juridique
Ces multiples réformes ont paradoxalement accru le risque de contentieux, avec tout ce que cela implique en termes d’argent perdu et de temps supplémentaire pour les porteurs de projets, qui ne seront pas gagnants.
En effet, l’illisibilité du droit génère un risque important d’erreur dans son application, donc autant de recours possibles.
- Les conséquences environnementales et le risque accru d’accidents industriels
Bien que les gouvernements successifs assurent que la simplification se fera à niveau de protection constant pour l’environnement, les chiffres de l’accidentologie et de l’incidentologie des ICPE démontrent qu’au contraire, l’effet de ces réformes a été d’accroître le nombre d’accidents (moins de 800 en 2012 à 1 100 en 2021).
- Une exclusion croissante du public, menant à une perte de confiance
Le fait de raboter les procédures environnementales aboutit in fine à un risque accru de conflits supplémentaires sur le terrain et à un risque de contentieux plus chronophage et coûteux financièrement pouvant de surcroît aboutir à l’annulation complète du projet.
- Des coûts déplacés vers les finances publiques et la société
Les coûts de l’inaction sont plus élevés que les coûts des mesures d’atténuation et d’adaptation. Ces coûts sont supportés par la société. Le blocage de réglementations ambitieuses contribue directement à une inaction coûteuse pour les finances publiques (en matière de dérèglement climatique, le coût de l’inaction est estimé entre 5 et 20 % du PIB mondial).
Un processus de long terme nuisible pour l’environnement
FNE considère que les différentes réformes de “simplification” constituent en réalité un processus de long terme nuisible pour l’environnement et pour la démocratie, sans plus-value avérée pour l’activité économique et l’emploi. Il s’agit d’une formulation trompeuse pour couvrir une dynamique de dérégulation, qui se fait au détriment de l’intérêt général.
Antoine Gatet, président de FNE estime ainsi que “le discours de la simplification est un mirage. Derrière lui et sous couvert de pragmatisme par nature incontestable, se réalise en fait la volonté persistante de détricoter les règles de protection de l’environnement et les espaces démocratiques de la participation à la décision publique ou de l’accès à la justice”.
Loin d’être novateur, le discours de “simplification” est, au contraire, une antienne périmée. De nombreux acteurs économiques reconnaissent qu’aujourd’hui, la priorité est à la stabilisation du droit.
Antoine Gatet souligne ainsi que “la priorité doit être à la stabilisation du droit, et non à son affaiblissement ; à l’amélioration démocratique des décisions publiques, et non à la fermeture des espaces de dialogue démocratique et des tribunaux ; à la reconnaissance de l’engagement citoyen dans les associations, les syndicats, l’ensemble des espaces de la société civile organisée, plutôt que de réprimer les engagements non-violents et désintéressés pour la défense d’un monde vivable”.
France nature environnement appelle donc à un changement de cap : plutôt que de continuer à démanteler les cadres législatifs et réglementaires de la démocratie environnementale, il est urgent de les renforcer et de garantir leur application effective.
L’ONG sera-t-elle entendue ?
Olivier Cizel
600 postes seraient supprimés chez ArcelorMittal
28/04/2025
Le géant mondial de l’acier, ArcelorMittal, a annoncé un plan de suppression de 600 postes dans ses sites de Dunkerque et Mardyck (Nord), Florange (Moselle), Basse-Indre (Loire-Atlantique), Mouzon (Ardennes), Desvres (Pas-de-Calais) et Montataire (Oise). L’annonce a été faire à l’issue d’un CSE dont les représentants ont précisé qu’un processus de consultation commencerait la semaine prochaine. Ils ignorent par ailleurs si ce plan inclura des départs forcés ou des reclassements internes et dans quelles proportions. Ils se préparent à des débrayages notamment dans les sites du Nord de la France.
Pour l’heure, la direction d’Arcelor fait valoir la crise de la production de l’acier qui la contraint à supprimer ces postes afin de rester compétitive. Les syndicats, eux, dénoncent une volonté de délocaliser la production dans des pays à bas coûts.
Le ministre de l’Industrie a réagi en assurant que “L’État soutient nos industries pour leur faire gagner de la compétitivité notamment en décarbonant leurs processus. L’État soutient Arcelor s’il investit dans la décarbonation : nous avons dégagé au titre du programme France 2030 850 millions d’euros de soutien à un projet d’investissement de 1,8 milliards qui se concrétisera nous l’espérons dans les prochains mois et permettra de pérenniser l’emploi. Nous agissons aussi au niveau européen, la Commission a retenu l’une de nos propositions visant à limiter les importations d’acier chinois. Dans le contexte de durcissement des droits de douane américains, nous avons besoin d’aller plus loin. Nous allons accompagner et nous serons extrêmement vigilants à ce qu’aucun site ne ferme en France”.
En réaction à ces annonces, la fédération CGT de la métallurgie dénonce une “casse sociale” et rappelle que le groupe “reste extrêmement rentable, avec des profits record réalisés depuis plusieurs années”. Arcelor aurait versé 11,7 milliards de dollars en dividendes à ses actionnaires en 2021 selon la même fédération. Un versement qu’elle interprète comme lié à “la stratégie de remontée de cash” qu’applique le géant indien de l’acier.
La CGT métallurgie dénonce également que “chaque année, des centaines de milliards d’euros d’aides publiques sont injectés dans les entreprises sans aucune garantie sur l’emploi, les salaires ou l’impact environnemental”. Elle appelle donc le gouvernement “à mettre en place une véritable politique industrielle et à prendre des mesures urgentes et nécessaires pour préserver l’emploi et garantir l’avenir de la filière sidérurgie en France”.
Source : actuel CSE
La CFDT Métallurgie de Bretagne alerte sur le PSE de Talendi
28/04/2025
Environ 50 postes seraient visés sur un effectif total de 498 salariés. C’est la teneur du projet de PSE présenté jeudi 24 avril par la direction de Talendi, une association de sous-traitance industrielle qui travaille à l’inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap depuis 1975. Selon la CFDT qui s’y trouve majoritaire (64 %), l’association a connu depuis 2020 une accumulation de crises externes (pandémie, flambée des prix de l’énergie, pénurie de composants, instabilités géopolitiques). Malgré une stratégie de diversification engagée pour réduire la dépendance au secteur automobile, “la baisse brutale de l’activité dans tous les secteurs, couplée à une conjoncture incertaine, a conduit à un déséquilibre d’exploitation durable”.
La CFDT Métallurgie Cœur Bretagne dit “se mobiliser pleinement (…) et s’engager à négocier avec responsabilité les mesures du plan dans l’intérêt des salariés et des usagers”. Les élus du personnel seront définitivement fixés sur le PSE vers mi-mai 2025.
Source : actuel CSE
Le PDG de Vencorex s’explique devant les députés
29/04/2025
La secrétaire générale de la CGT et le président de la CFE-CGC avaient demandé, dans un courrier commun daté du 15 avril, à François Bayrou d’envisager de nationaliser la société Vencorex (Pont-de-Claix, en Isère) après que le tribunal de Lyon ait décidé le 10 avril de céder l’entreprise à une société hongroise (BorsodChem), filiale du groupe chinois Wanhua. Les syndicalistes défendaient notamment l’utilité pour la France de conserver les savoir-faire et les brevets de l’industrie chimique et de sauver les emplois.
Mais pour Éric Béal, le PDG de l’entreprise auditionné hier par la commission d’enquête sur “les freins à la réindustrialisation”, une telle nationalisation ne pouvait être une solution et c’est ce qui a motivé le refus du tribunal : “Nationaliser dans de telles conditions, ce serait financer à fonds perdus”, a-t-il déclaré. Le PDG a expliqué que l’offre coopérative alternative à celle du groupe chinois, cadre dans lequel cette nationalisation était envisagée, n’avait été présentée que très tardivement, sans montage financier prêt, alors que l’entreprise n’avait que quelques semaines de trésorerie pour faire face à la mise en sécurité du site et préparer le plan social. A ce propos, le PDG a précisé que seuls 44 des 470 salariés français seront repris par la société hongroise : “Trente ont été automatiquement transférés et le repreneur a proposé d’en reprendre 24 autres sur la base du volontariat mais il n’y a eu que 14 volontaires”.
Surtout, le PDG a soutenu que c’est l’incapacité de Vencorex depuis des années à améliorer ses coûts de production, dans une plateforme industrielle vieillissante, qui est à l’origine de ces difficultés, face aux nouveaux acteurs du marché venus notamment d’Asie, et qui arrivent à produire beaucoup moins cher mais sans pour autant faire du dumping. Éric Béal a pointé notamment le coût du travail mais surtout le coût de l’énergie, supérieur en Europe et en France à celui pratiqué en Asie ou en Amérique : “Pour Vencorex, en 2023, le coût de l’électricité, c’était 67€ le mégawatt alors qu’on sait qu’au-dessus de 50€ nous sommes en désavantage concurrentiel”.
Source : actuel CSE
[ 3 Q / R ] Pointeuse des heures de délégation, consultation du CSE en cas d’offre publique d’achat, comptes en banque du CSE
30/04/2025
Chaque mois, un juriste de L’Appel Expert examine 3 questions posées par des élus du personnel. Dans cet article, Stéphanie Menegakis-Lacheré répond aux questions suivantes : Un élu peut-il refuser d’utiliser une badgeuse avec option heures de délégation ? En cas d’offre publique d’achat (OPA), à quel moment le CSE de la société à l’origine de l’offre est-il consulté ? Combien de comptes bancaires pour le CSE ?
[3 questions d’élus, 3 réponses d’expert]

Stéphanie Menegakis-Lacheré, juriste pour l’Appel Expert, répond à 3 questions posées par des élus de CSE en avril 2025
Un élu peut-il refuser d’utiliser une badgeuse avec option heures de délégation ?
Non, sauf en cas d’utilisation abusive par l’employeur
Une badgeuse a été mise en place et est utilisée par tous les salariés, élus du personnel inclus. Cette badgeuse présente en effet une option “heures de délégation”. Ces dernières peuvent donc faire l’objet d’un pointage via la badgeuse. Un élu se demande s’il peut refuser de badger en utilisant cette option au motif que cela ferait double emploi avec la pratique des bons de délégation.
Un cas similaire a été traité en justice par une décision de la cour d’appel de Bordeaux du 16 janvier 2004 (n° 01-3824). Dans cette affaire, un représentant du personnel avait fait l’objet d’un avertissement pour avoir refusé de pointer à l’arrivée et au retour de ses heures de délégation, car il ne respectait pas une note de service qui prévoyait ce pointage en plus des bons de délégation.
Dans cette décision, les juges n’indiquent pas que l’utilisation de la badgeuse et des bons de délégation fait double emploi. Le bon de délégation a pour objet de permettre une information a priori alors que la pointeuse permet la computation a posteriori du nombre d’heures de délégation utilisées. Elle n’a pas pour vocation de constituer une autorisation préalable qui serait de nature à porter entrave aux fonctions des représentants du personnel.
Attention, l’employeur ne saurait faire une utilisation abusive de l’information recueillie au moyen du système de pointage. C’est pourquoi en pratique, les modalités de cette information doivent être déterminées en concertation avec les représentants du personnel.
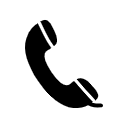
En cas d’offre publique d’achat (OPA), à quel moment le CSE de la société à l’origine de l’offre est-il consulté ?
Dans les 2 jours ouvrables suivant la publication de l’OPA auprès de l’AMF
Selon l’article L.2312.49 du code du travail, l’employeur qui lance une offre publique d’acquisition portant sur le capital d’une entreprise n’est pas tenu de consulter le comité social et économique avant le lancement de l’opération.
Par ailleurs, l’article L.2312-42 du Code du travail précise que l’employeur doit en revanche réunir le CSE dans les 2 jours ouvrables suivant la publication de l’offre publique d’acquisition auprès de l’AMF (Autorité des marchés financiers) en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l’offre et sur ses conséquences en matière d’emploi.
Une OPA est en effet susceptible d’entraîner des changements d’organisation juridique et/ou économique de l’entreprise. A ce moment-là, le CSE devra être consulté en application de l’article L. 2312-8 du code du travail sur les modifications de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise.
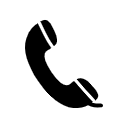
Combien de comptes bancaires pour le CSE ?
En pratique, un pour chaque budget
Aucun texte de loi ne répond à cette question. On peut cependant avancer qu’en pratique, il est sans doute plus sûr d’ouvrir un compte bancaire pour chacun des budgets (celui de fonctionnement et celui des activités sociales et culturelles). Mais ni les textes ni la jurisprudence n’obligent les CSE à n’avoir qu’un seul compte bancaire.
Si tel est pourtant le cas, et qu’un seul compte en banque sert aux opérations financières sur le budget et les ASC une gestion rigoureuse sera alors nécessaire. Une délibération du CSE devra déterminer précisément les modalités d’utilisation du compte bancaire.
Une infographie de Marie-Aude Grimont avec les juristes de l’Appel Expert
ArcelorMittal : “La nationalisation n’est pas à l’ordre du jour” selon Marc Ferracci
30/04/2025
Après l’annonce d’une suppression de 600 emplois en France, le ministre de l’Industrie Marc Ferracci a reçu hier les directions France et Europe d’ArcelorMittal et s’en est expliqué au micro de la radio RTL. “Le but était de comprendre les déterminants des décisions d’Arcelor (…) afin d’activer les bons leviers. La sidérurgie est bousculée par la compétitivité internationale avec la Chine qui se trouve surcapacitaire car massivement subventionnée. La première réponse est donc la protection commerciale avec une restriction des importations d’acier en Europe”, a-t-il indiqué.
Le ministre a également refusé toute possibilité de nationalisation et ramené l’avenir d’Arcelor à la réalisation de ses investissements dans la décarbonation de sa production : “Il faut sécuriser ces investissements. C’est pourquoi l’Etat soutient l’investissement en décarbonation à hauteur de 850 millions d’euros sur le site de Dunkerque. Si on donne de la perspective au fait qu’ArcelorMittal investisse dans ses fours électriques, cela veut dire qu’elle croit en la production d’acier en Europe et en France. C’est la meilleure garantie de maintien des emplois”.
À la CFDT de la métallurgie, on note que “le dispositif APLD était censé protéger les salariés de tout plan social et de la suppression d’emplois. Mais, aujourd’hui, force est de constater que la réalité est tout autre. Après avoir profité au maximum des aides publiques, la Direction d’ArcelorMittal France balaye d’un revers de main tous les aspects sociaux de ce mécanisme”.
La nationalisation est une mesure réclamée par la CGT de Sophie Binet et la fédération CGT de la métallurgie. Cette dernière dénonce “les 11,7 milliards de dollars qui ont été versé aux actionnaires depuis 2021” ainsi que “des centaines de milliards d’euros d’aides publiques injectés dans les entreprises sans aucune garantie sur l’emploi, les salaires ou l’impact environnemental” (communiqué en pièce jointe).
Les suppressions de postes sont également décriées par la fédération FO Métaux de Force Ouvrière qui dénonce la justification de cette restructuration “par un mélange confus de causes conjoncturelles (baisse temporaire de la demande), de causes structurelles (normes environnementales européennes), de contraintes externes (surcapacités mondiales, fiscalité douanière) et de considérations purement financières (cours de Bourse, besoin de cash pour investissement)”.
Pour l’heure, les débrayages et grèves se sont multipliés sur les sites français d’Arcelor à Florange (Moselle), Mouzon (Ardennes), Basse-Indre (Loire-Atlantique), tandis qu’une importante manifestation est prévue le 1er mai à l’usine de Dunkerque (Nord), site français le plus touché avec 250 postes supprimés à lui-seul.
Marc Ferracci a assuré qu’il rencontrerait les élus locaux et les syndicats “dans les prochains jours ou les prochaines semaines”.
Source : actuel CSE




