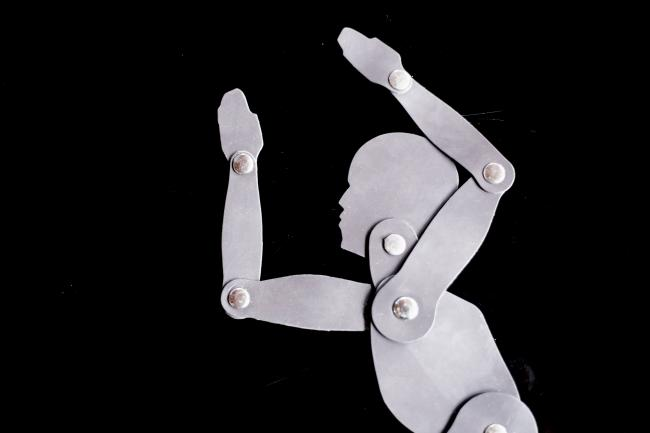TMS : quel rôle pour le CSE ?
01/10/2025
Lors d’un webinaire hier, Anne Benedetto, de Syndex, a signalé aux élus CSE des outils utiles pour documenter la problématique des troubles musculosquelettiques (TMS) dans leur entreprise. Une organisation défaillante peut entraîner des TMS, ceux-ci ne provenant pas seulement de causes physiques, a-t-elle souligné.
Les TMS, les troubles musculosquelettiques, sont des troubles d’origine professionnelle affectant le dos, le cou, les épaules, les membres supérieurs et inférieurs. Tendinites pour les conducteurs de machine se commandant avec pédales, problème de genoux pour les carreleurs, syndrome du canal carpien pour les opératrices de caisse, etc. : on sait que ces affections ne manquent pas en France. Les TMS constituent d’ailleurs la première cause de maladies professionnelles dans notre pays.
Le coût social pour les salariés est énorme, car “si on n’agit pas pour prévenir les causes de ces maladies, on en arrive à une pathologie qui peut entraîner des traitements chirurgicaux et même se solder par une inaptitude professionnelle, un licenciement et un risque de désinsertion professionnelle vu la difficulté à retrouver un emploi”, alerte Anne Benedetto, ergonome chez Syndex, cabinet de conseil et d’expertises au service des représentants du personnel (*). Le problème, ajoute l’experte, est que les souffrances causées par ces TMS finissent souvent par polluer la vie personnelle des salariés, si bien que parfois ils doutent eux-mêmes de l’origine professionnelle de leurs maux.
Le coût pour l’employeur est important également : absentéisme, surcotisations AT-MP, moindre productivité, etc.
“Inciter les salariés à se déclarer”
En tant que représentants du personnel, plaide Anne Benedetto, il faut agir le plus en amont possible.
Son premier conseil est d’inciter les salariés ayant ces symptômes à déclarer une maladie professionnelle, que ce soit auprès de la médecine du travail ou de leur salarié traitant, a fortiori si leurs souffrances ont déjà entrainé un arrêt de travail. “Si vous sollicitez votre médecin traitant, imprimez à l’avance un Cerfa sur la déclaration de maladie professionnelle pour le lui apporter”, conseille l’ergonome.
Bien sûr, les tableaux reconnaissant les maladies professionnelles sont limités et exigeants. Par exemple, le tableau 57 sur “les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” exige, pour la reconnaissance de “la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs”, que le salarié ait effectué des travaux “comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé”.
Si le cas d’un salarié ne correspond pas à ce tableau, ne renoncez pas, encourage toutefois l’experte : “Il y a une commission de recours pour que la Sécurité sociale puisse éventuellement revoir le dossier pour déclarer la maladie professionnelle. L’enjeu est une meilleure prise en charge des soins et de la rééducation”.
Les TMS, ce n’est pas que des gestes répétitifs !
L’autre message important donné par l’ergonome concerne l’appréhension des TMS. Attention, “les TMS ce ne sont pas uniquement la maladie des gestes répétitifs, ils ont une origine psychosociale importante”. Bien sûr, les outils, les équipements (lourds, encombrants, mal adaptés), la mauvaise conception des espaces de travail, les ambiances physiques pénibles (courants d’air, froid, vibrations de machines voisines, etc.) peuvent entraîner des TMS, mais il existe un autre facteur important qui touche à l’organisation et à la prescription du travail.
Autrement dit, “une organisation du travail trop rigide ou au contraire trop floue, ça va peser sur le physique des salariés, tout comme un mode de management défaillant ou trop autoritaire”. Idem si le collectif du travail va mal et connaît des tensions, si les salariés ne sont pas équitablement traités, s’il y a un manque manifeste de formations professionnelles. “Tout cela génère moins de marge de manœuvre au travail, et donc cela rigidifie les conditions psychosociales et biomécaniques du travail”, souligne Anne Benedetto. Autrement dit, le corps se bloque et finit par craquer.
Comment prévenir ?
En tant qu’élus du personnel, que pouvez faire pour prévenir ces TMS ? L’ergonome de Syndex incite les élus CSE à s’emparer de toute la panoplie des outils à leur disposition.
Il y a par exemple la consultation annuelle sur la politique sociale, qui peut aussi s’accompagner d’une expertise. “Le CSE a un droit d’information sur tous les documents concernant la santé et les conditions de travail, tant qu’ils ne sont pas nominatifs : le document unique d’évaluation des risques professionnels qui doit traiter les TMS, le Papripact (Nldr : programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail), le bilan santé, sécurité et conditions de travail, etc. Vous pouvez aussi demander des notices de sécurité et vous devez être destinataire de la fiche d’entreprise du médecin du travail “, rappelle Anne Benedetto.
Analysez l’évolution des données chiffrées sur la santé au travail ces dernières années dans votre entreprise (nombre d’inaptitudes, de postes aménagés, de maladies professionnelles déclarées, etc.).
Faire des visites et des inspections, c’est important
Votre panoplie, c’est aussi les consultations ponctuelles en cas de projet important, c’est aussi votre droit à faire des visites, des inspections, des enquêtes paritaires, afin de voir ce qui se passe réellement au travail, et de poser des éléments factuels pour un diagnostic afin d’inciter l’employeur à réagir.
Apprenez à classer vos observations en plusieurs thématiques, conseille la consultante : les facteurs physiques (gestes répétitifs par ex.), l’environnement de travail (bruit, etc.), l’organisation du travail (horaires, polyvalence, etc.), les facteurs psychosociaux (manque d’autonomie, etc.). Cherchez de la documentation en amont pour avoir le bon cadre avant de faire une visite de terrain. L’ergonome cite par exemple la norme Afnor NF 1005-5 portant sur l’appréciation du risque relatif à la manutention répétitive à fréquence élevée. Problème : l’accès à ces normes est payant, mais ce peut être un investissement pour le CSE qui veut améliorer la prévention et jouer pleinement son rôle, à moins de demander à l’employeur de partager ces documents s’il les possède.
Des outils en ligne à utiliser
L’ergonome de Syndex signale d’autres outils existants en ligne, gratuits ceux-là, vous permettant d’affiner votre diagnostic. Avez-vous constaté un absentéisme ? Des douleurs vous ont-elles été signalées par des salariés ? Etc. : en répondant à “TMS, en quoi mon entreprise est concernée ?”, un tableau excel mis à disposition par l’INRS (institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles) par exemple, vous aurez une première visualisation de la situation dans votre entreprise, un début d’argument pour faire modifier le Papripact.
Autre outil : le tableau de bord TMS de l’INRS : en rentrant vos données, vous aurez une image globale, surtout si vous obtenez de l’employeur, si le climat social est bon, qu’il le remplisse avec vous. Ces données, vous pourrez ensuite les comparer à celles des entreprises de votre secteur d’activité. Comment ? En allant sur le site Ameli (Sécurité sociale) en rentrant votre code APE. “Cela vaut pour les TMS mais plus généralement pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. Si vos chiffres sont plus élevés dans votre entreprise que dans votre secteur en moyenne, c’est un argument pour alerter l’employeur”, précise Anne Benedetto.
Vous pouvez aussi vous référer à des brochures téléchargeables comme celle de l’INRS (ED 6161) proposant une grille de méthode d’analyse des conditions de travail : là encore, il s’agit de recenser des risques avérés afin d’emmener l’employeur à les intégrer dans le document unique et dans le plan de prévention.
Actualiser les risques
Car, bien sûr, l’actualisation des risques et de leur prévention n’est jamais terminée. “Il faut toujours actualiser les risques, construire des indicateurs pertinents, mettre en place des actions de prévention”, prévient l’ergonome. Les pistes à traiter ne manquent certainement pas dans votre entreprise pour réduire le risque TMS : demander aux RH de réguler le temps de travail et d’impulser un “management soutenant”, clarifier les tâches, diminuer les cadences pour qu’elles soient soutenables, réduire les nuisances physiques, investir dans de nouvelles technologies en mobilisant par exemple les fonds publics disponibles via les branches dans le Fipu, le fonds d’investissement et de prévention de l’usure professionnelle, encore trop peu utilisé par les entreprises.
Enfin, bien sûr, le CSE dispose d’un autre moyen d’action : les expertises. Si vous constatez “une épidémie de TMS”, c’est peut être l’occasion de déclencher une expertise pour risque grave, mais il peut être aussi opportun de se faire assister par un expert en cas de projet important…
(*) Ce webinaire est rediffusé surr le site de Syndex, voir ici. Par ailleurs, Syndex organise un autre webinaire le 6 novembre consacré aux risques psychosociaux, inscriptions ici.
Bernard Domergue
L’absentéisme au travail poursuit sa progression
01/10/2025

Les troubles psychologiques s’affirment comme une cause majeure d’absentéisme prolongé.
Selon le baromètre du groupe Apicil, mené en collaboration avec le cabinet conseil JLO, le taux d’absentéisme est passé de 4,27 % en 2023 à 4,41 % en 2024, soit une légère augmentation de 0,14 point en un an. Ces arrêts de travail sont portés par les troubles psychosociaux, en particulier les dépressions et le burn-out, et le micro-absentéisme.
L’absentéisme en entreprise continue sa progression. Selon la quatrième édition de l’Observatoire des arrêts de travail du groupe de protection sociale Apicil, menée en collaboration avec le cabinet de conseil JLO, le taux d’absentéisme a atteint 4,41 % en 2024, contre 4,27 % l’année précédente. Si cette hausse de 0,14 point reste modérée, elle témoigne d’une tendance persistante qui préoccupe les employeurs et les pouvoirs publics.
L’étude, qui s’appuie sur les données de 53 000 entreprises clientes représentant plus d’un million de salariés, dresse un tableau contrasté. Certes, le niveau d’absentéisme demeure inférieur à celui de 2022 (4,61 %), mais la part de salariés ayant connu au moins un arrêt de travail progresse : 26,98 % en 2024, contre 26,32 % un an plus tôt. Ces derniers ont enregistré en moyenne 1,83 arrêt dans l’année, pour une durée moyenne stable de 19,85 jours.
Le micro-absentéisme en forte augmentation
Derrière ces chiffres globaux se cache une évolution préoccupante : l’essor du micro-absentéisme. Les arrêts de moins de trois jours ont bondi de 2,24 points, passant de 19,68 % à 21,92 % entre 2023 et 2024. Parallèlement, les arrêts longs se multiplient : ceux de plus de 90 jours représentent désormais 5,13 % du total, en hausse de 0,24 point.
La maladie ordinaire reste de loin le premier motif d’arrêt, avec plus de neuf absences sur dix (90,94 %). Les accidents du travail arrivent loin derrière (4,55 %), suivis des temps partiels thérapeutiques (3,43 %). Si les maladies professionnelles ne pèsent que 0,20 % des arrêts, elles entraînent en moyenne 121,73 jours d’absence, soit près de trois fois plus qu’un accident du travail ou de trajet.
Santé mentale : un enjeu majeur
Les troubles psychologiques s’affirment comme une cause majeure d’absentéisme prolongé. Ils représentent 40 % des dossiers d’arrêts longs suivis par Apicil, devant les troubles musculosquelettiques (un tiers des cas). L’Assurance maladie a d’ailleurs enregistré une explosion de 117 % des maladies professionnelles liées aux troubles psychosociaux entre 2019 et 2023.
Cette réalité touche particulièrement les jeunes actifs : 27 % des 30-39 ans ont été concernés par une dépression ou un burn-out en 2024. Un constat qui a conduit le gouvernement à ériger la santé mentale en grande cause nationale en 2025 et à lancer, fin août, une charte d’engagement pour la santé mentale au travail.
Des inégalités marquées
L’absentéisme frappe de manière inégale. Les ouvriers affichent un taux de 6,54 %, contre 2,36 % pour les cadres. L’âge constitue également un facteur déterminant : les salariés de 60 ans et plus enregistrent un taux de 5,68 %, soit 1,74 fois plus que les moins de 30 ans (3,26 %).Toutefois, seuls 18,66 % des seniors ont eu un arrêt, contre 30,04 % chez les trentenaires, traduisant une concentration des absences sur une minorité.
Les femmes sont plus touchées que les hommes (5,19 % contre 3,60 %), tout comme les salariés à temps partiel (5,01 %) ou ceux ayant plus de dix ans d’ancienneté (5,16 %).
Certains secteurs sont particulièrement exposés. La santé, l’économie sociale et l’éducation culminent à 5,68 %, devant l’industrie et le BTP (4,59 %), ainsi que le commerce et le transport (4,33 %). A l’inverse, les services aux entreprises sont les moins concernés.
Un débat politique sensible
Face à cette progression, l’ex-gouvernement Bayrou avait envisagé de décaler l’intervention de l’assurance maladie, aujourd’hui effective à partir du quatrième jour d’arrêt, pour la reporter au septième jour. Les entreprises et leurs assureurs auraient dû prendre le relais. Cette proposition avait suscité un levier de boucliers tant du côté patronal que syndical.
L’ancien Premier ministre avait également dénoncé une “dérive” des arrêts maladie, affirmant que 50 % des arrêts de plus de 18 mois ne seraient plus justifiés au moment du contrôle. Reste à savoir si le gouvernement Lecornu reprendra ces propositions dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
“L’absentéisme s’impose comme un défi crucial pour les entreprises, les obligeant à repenser leurs pratiques managériales, leurs modes d’organisation et leurs politiques de prévention”, souligne Thomas Perrin, directeur général adjoint services du groupe Apicil. Pour lui, “la qualité de vie et conditions de travail ne peut plus être perçue comme un simple levier RH : elle devient un impératif stratégique”.
Anne Bariet
Le coût moyen des services de santé au travail est fixé pour 2026
03/10/2025
Un arrêté du 26 septembre 2025 fixe le coût moyen national de l’ensemble socle de services des services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) à 116 euros pour l’année 2026 (contre 115,50 euros pour l’année 2025) (article D.4622-27-5). Le coût moyen national de l’ensemble socle de services des SPSTI permet de calculer l’amplitude au sein de laquelle doit se situer le montant des cotisations versées par les entreprises à leur SPSTI pour financer leurs dépenses.
Le coût moyen de l’ensemble socle de services pour chaque SPSTI est calculé au titre de l’année précédant l’année en cours de la manière suivante : les charges d’exploitation de l’ensemble socle de services divisé par le nombre de travailleurs suivis pour lesquels une cotisation a été facturée pendant l’année (article D.4622-27-4 du code du travail).
Pour chaque travailleur, le montant des cotisations versées au SPSTI ne peut être inférieur à 80 % ou supérieur à 120 % de ce coût moyen national. Ainsi pour 2026, le montant des cotisations versées par l’employeur au SPSTI, pour chaque travailleur, ne pourra donc être inférieur à 92,80 euros ni supérieur à 139,20 euros. Cependant, l’assemblée générale du SPSTI a la possibilité d’approuver des cotisations qui s’écarteraient de la borne haute de 120 % et de la borne basse de 80 % dans des cas limitativement énumérés (article D.4622-27-6, II et III du code du travail).
► Depuis le 31 mars 2022, les dépenses afférentes aux services de prévention et de santé au travail sont à la charge des employeurs. Les services obligatoires fournis par le SPSTI (article L.4622-9-1 du code du travail) font l’objet d’une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité. Les services complémentaires proposés et l’offre spécifique de services (article L.4621-3 du code du travail) font l’objet d’une facturation sur la base d’une grille tarifaire. Le montant des cotisations et la grille tarifaire sont approuvés par l’assemblée générale (article L.4622-6 du code du travail).
Source : actuel CSE