La réaction des secrétaires des CSE au rapport de la Cour des comptes sur France Télévisions
29/09/2025
Dans leur rapport sur la gestion économique et financière de France Télévisions, les magistrats de la Cour des comptes évoquent le coût du dialogue social et des CSE de l’entreprise publique. Ils recommandent un audit des comités et une révision de l’accord social sur les classifications, un accord que vient d’ailleurs de dénoncer la direction. Les réactions dans notre article des secrétaires du CSE central et du CSE du siège.
Alors que le projet de fusion de l’audiovisuel public dans une holding voulue par Rachida Dati n’a toujours pas été voté par le Parlement, la Cour des comptes vient de publier un rapport de 166 pages sur la gestion économique et financière de France Télévisions, entreprise détenue à 100 % par l’Etat.
Le rapport crédite France Télévisions, récemment condamnée pour défaut de consultation de son CSE central sur l’intelligence artificielle, de ses bons résultats d’audience. Mais il s’alarme d’une situation financière jugée préoccupante (81 M€ de déficit cumulé entre 2017 et 2024, résultat net négatif de 40M€ en 2025).
L’État actionnaire devra prendre “avant le 31 décembre 2026 des mesures de rétablissement des fonds propres ou de réduction du capital social”, préviennent les magistrats. Et ce alors que le financement public à France Télévisions a baissé de 2018 à 2022 (*).
Le rapport de la Cour des comptes, très fraîchement accueilli par les syndicats (lire notre encadré) et par les élus CSE de la maison, évoque, sous le prisme de la performance financière, le dialogue social et la situation des 13 CSE de France Télévisions.
Un dialogue social qui occasionne de nombreuses réunions
Alors que la CGT reste le syndicat le plus représentatif (36,6 %), devant FO (25,7 %), la CFDT (21,8 %) et le Syndicat national des journalistes, le SNJ (15,8%), la Cour des comptes note que le fonctionnement des nouvelles instances (CSE, CSE central, CSSCT, représentants de proximité) nécessite un grand nombre de réunions : “Le nombre d’heures de travail consacrées aux réunions de CSE a quasiment doublé sur les trois dernières années” avec pas moins de 22 225 heures de CSE tenues en 2023.
Une redondance des sujets dans les différents niveaux d’instance
La direction du réseau France 3 estime ainsi consacrer “l’équivalent de 70 équivalents temps plein par an au dialogue social, soit 2,3 % des effectifs du réseau”. Alors que le CSE était censé éviter la répétition des sujets, la Cour des comptes pointe “la redondance des sujets traités entre les différents niveaux d’instance ou la remontée en CSE régional voire central de sujets de proximité”.
Les problèmes locaux évoqués par les représentants de proximité et non réglés remontent forcément en CSE
À ce propos, Pierre Mouchel, le secrétaire (CGT) du CSE central confirme l’inflation des réunions des instances : “Mais ce n’est pas de notre fait ! Alors que le CSE central se réunit normalement quatre fois par an, nous avons entre 10 et 12 réunions ! Pourquoi ? Parce que la direction convoque des CSE centraux extraordinaires pour faire passer ses projets. C’est la lessiveuse des projets !”
Quant aux redondances des sujets, l’élu l’explique par la mise en place des CSE et la centralisation du dialogue social : “Nous avons des représentants de proximité, mais ces derniers n’ont pas les mêmes attributions que les anciens CHSCT. Du coup, les problèmes locaux non réglés remontent forcément en CSE, dont le périmètre peut être énorme : il y a par exemple un seul comité social et économique pour France 3.”
Le coût des expertises des CSE
Le rapport pointe également le coût du financement des expertises demandées par les CSE.
Cela représente 770 300€ par an en moyenne de 2017 à 2024, avec un coût moyen de 65 600€ par expertise. Ces expertises, qui portent sur l’analyse de risques graves comme sur les projets de transformation, ont été réalisées pour plus de la moitié par le cabinet Secafi.
“Cela peut paraître beaucoup, mais si la direction acceptait des discussions préalables sur les projets pour trouver des solutions, ce serait peut-être différent. Et vu le nombre de dossiers à traiter, les élus ont besoin de cette assistance”, commente Pierre Mouchel, secrétaire du CSE central.
Le dialogue semble figé
Toujours au sujet du dialogue social, le rapport souligne le grand nombre d’accords négociés : 55 ont été signés entre 2021 et 2024, la moitié traitant des rémunérations. Mais trop peu d’accords traitent, selon les magistrats, de l’évolution des métiers alors que ce serait une attente des salariés selon les baromètres internes : “Sur ces sujets, le dialogue semble figé pour chaque partie prenante, avec une attitude de méfiance réciproque qui érode progressivement les bases d’une discussion constructive. L’impossibilité de trouver un accord avec les organisations syndicales pour étendre les métiers polyvalents créés pour la chaîne NoA en Nouvelle-Aquitaine (**) à d’autres activités illustre l’impasse dans laquelle se situe le dialogue”.
Une renégociation de l’accord de 2013 sur le cadre social et les qualifications
Face à ces difficultés, la Cour des comptes recommande une “rénovation du cadre social” de France Télévisions via une renégociation jugée “inéluctable” de l’accord collectif de 2013.
Cette renégociation, dit sans détour le rapport, “n’engendrera pas de réduction de la masse salariale à court terme” mais “elle permettra cependant, dans un premier temps, de lever les rigidités de la gestion des ressources humaines, et de revisiter la planification de l’activité pour la rendre plus performante”.
Les magistrats critiquent notamment le niveau des salaires et leur évolution (***).
Des suppressions d’emplois pour répondre à la situation financière critique
Dans un second temps, poursuit la Cour, “cette réflexion sur l’organisation du travail devra (..) s’accompagner d’une réflexion sur l’allocation des moyens et l’opportunité de procéder à des suppressions d’emplois pour répondre à la situation financière critique”. Voilà les organisations syndicales prévenues !
Les magistrats jugent en effet trop étroite la classification en 160 métiers. Cette classification “limite la polyvalence des salariés, freine l’évolution des compétences et favorise le recours à l’emploi non permanent”.
Certes, un plan a permis de 2019 à 2022 de réduire les effectifs (1 251 temps pleins en 2024 contre 1 335 en 2017), mais “les efforts de la direction pour faire évoluer les métiers (..) restent coûteux et insuffisants pour répondre aux besoins de transformation de l’entreprise”.
Une renégociation complète pour dessiner un cadre social modernisé
Dans sa réponse au rapport, Delphine Ernotte Cunci, la présidente de France Télévisions, partage le constat selon lequel l’accord collectif de 2013 est “devenu un frein majeur à la transformation de l’entreprise”. De fait, le conseil d’administration de France Télévisions a décidé le 10 juillet 2025 de dénoncer cet accord “pour ouvrir la voie à une renégociation complète qui a pour but de dessiner un cadre social modernisé pour France Télévisions”. La dirigeante ajoute que la rupture conventionnelle collective a permis de réduire de 903 équivalents temps plein les effectifs de 2019 à 2022.
Une négociation sensible à venir
Dans une déclaration intersyndicale au CSE central du 11 septembre, les élus ont réagi à cette dénonciation en accusant leur direction de provoquer “la plus grave crise sociale depuis 2015”. “Aucun dialogue serein et constructif ne sera possible tant que la direction ne reviendra pas sur sa décision” avertissent-ils alors que le 1er tour des prochaines élections professionnelles doit se tenir en novembre.
Les syndicats devraient saisir la justice pour dénoncer l’irrégularité de la dénonciation de l’accord de 2013, mais aussi le tribunal de commerce au sujet de la régularité de ce point évoqué lors d’un conseil d’administration, car cette dénonciation n’était pas à l’ordre du jour.
“Nous pointerons aussi la non information préalable des CSE. Car si l’employeur n’a plus à consulter les comités sur les accords collectifs conclus ou dénoncés, nous estimons que la dénonciation d’un tel accord collectif a forcément des effets sur la marche économique de l’entreprise”, nous dit le secrétaire du CSE central.
Une dénonciation en plein été
Les syndicats s’interrogent au passage sur la précipitation de cette annonce en plein été, alors que c’est un moment de pause dans l’agenda social : “Ce n’est pas le futur accord qui va règler à court terme la situation financière de France Télévisions. L’accord actuel doit survivre 27 mois et nous n’avons pour l’instant que deux réunions de négociations programmées en 2025, les 24 septembre et 21 octobre. Et maintenant la direction nous propose un accord de méthode pour nous donner plus de temps, s’étonne Pierre Mouchel. Et alors que France Télévisions prévoit déjà un déficit de 50 millions en 2025, l’avant-projet du budget de l’État pour 2026 ferait encore baisser notre dotation de 60 millions, soit en tenant compte de l’inflation un trou de 150 millions l’an prochain ! Cela signifie des coupes dans les programmes et donc de possibles baisses d’audience et donc aussi des baisses de recettes publicitaires.”
Le CSE central avait d’ailleurs tiré la sonnette d’alarme en posant un droit d’alerte économique dès octobre 2024.
Les activités sociales et culturelles des CSE
Dans son rapport, la Cour des comptes examine par ailleurs la situation comptable des 13 CSE, “généreusement dotés” selon ses termes. Ils bénéficient d’une subvention à hauteur de 0,2 % de la masse salariale pour le budget fonctionnement, et de 2,2 % pour le budget des activités sociales et culturelles (ASC) dont une bonne partie va au financement de la restauration pour les salariés.
Sur la dotation des ASC, 63 % est destinée au comité interentreprises de l’audiovisuel public (ex CI-ORTF), soit 3,5 millions d’euros en 2023. Cette contribution, expliquent les magistrats dans un passage peu clair, permet au comité interentreprises, grâce à plus de 150 salariés et intermittents, de gérer des centres de vacances (dont “le château de Lalinde doté d’un parc de 115 hectares et d’une piscine qui a coûté 1 M€”), une médiathèque, et d’organiser des voyages”.
Des petites phrases qui passent mal auprès des représentants du personnel de France Télévisions, qui rappellent que ce patrimoine social appartient aux salariés de l’audiovisuel public regroupé dans un comité inter-entreprises.
| Rappelons que la direction de Radio France entend ne plus financer l’ex CI-ORTF appelé désormais le CASCI. Cette intention annoncée courant septembre aux salariés de la Maison ronde inquiète aussi les élus de France Télévisions comme Sophie Pignal, la secrétaire du CSE central : “Que Radio France lance cette initiative sans en référer aux autres entreprises ni aux autres CSE est désolant. Cela risque de déséquilibrer tout le comité inter-entreprises”. |
Autre point soulevé par la Cour : les CSE ont également bénéficié d’une dotation exceptionnelle et transitoire pour les exercices 2020, 2021 et 2022, ce qui a permis au CSE du siège de disposer de réserves (plus de 7M€ en 2023, dont 4 M€ de fonds propres au titre des ASC et de 3,4M€ pour le budget de fonctionnement). Néanmoins, le CSE du siège serait selon la Cour des comptes dans une situation fragile : “Le déficit de son budget ASC en 2023, soit 1,3M€, correspond à une baisse de 23 % de ses fonds propres et à ce rythme ses réserves pourraient s’épuiser en 3 ou 4 ans”.
Au vu des montants en jeu, conclut la Cour des comptes, “il serait souhaitable que la gestion de ces organismes soit auditée”.
La réaction de la secrétaire du CSE siège
Sophie Pignal, la secrétaire du CSE du siège, se dit totalement surprise par ces analyses : “Je ne sais pas d’où sortent ces chiffres, nous n’avons vu personne de la Cour des comptes. C’est dommage car nous sommes totalement transparents et c’est bien normal de rendre des comptes, c’est de l’argent public”. Et L’élue CGT d’ajouter : “Les mandats de secrétaire et de trésorier du CSE siège sont des mandats à temps plein, c’est très lourd, l’investissement des élus mérite un peu de respect”.
La situation du CSE n’est absolument pas fragile
Sur le fond, la secrétaire de l’instance conteste l’analyse d’une situation financière fragile : “Nous ne sommes absolument pas en danger !” Sur la question des déficits du budget ASC, Sophie Pignal explique simplement les choses : “Avec la crise du Covid, nous nous sommes retrouvés avec des dotations qui n’étaient pas consommées. Nous n’avons pas vocation à garder toutes ces réserves, mais à les redistribuer aux salariés. Nous avons donc choisi de faire des redistributions supplémentaires (événements, chèques-vacances, etc.) en 2023, 2024 et 2025, tout en commençant à revenir à la normale, car ce sont des années exceptionnelles du fait de ces reliquats”.
Le CSE du siège, explique par ailleurs sa secrétaire, gère le restaurant d’entreprise pour 4 à 5 000 salariés, employant pour cela une soixantaine de salariés, en plus d’une dizaine de salariés pour la gestion des ASC. “Nous avons d’ailleurs lancé un audit sur le fonctionnement du restaurant pour améliorer notre offre, servir davantage de produits frais par exemple. Nous avons déjà lancé un service traiteur”, précise Sophie Pignal. Qui dit aussi réfléchir à l’opportunité de garder ou non une partie du patrimoine immobilier du CSE comme les appartements à la montagne, qui servent aux séjours vacances des salariés.
Dialoguer, ce n’est pas mettre les gens devant le fait accompli
Quant aux critiques implicites sur le coût du dialogue social, Sophie Pignal souligne que France Télévisions n’est pas une entreprise comme une autre : “Nous représentons toutes les régions et les outre-mer, tous les métiers, nous sommes très divers et nous respectons aussi un cahier des charges de service public en donnant la parole à tous les partis politiques, les organisations syndicales, les religions, tout en portant les valeurs de l’égalité des chances, de la prise en compte du handicap, etc. Quelle autre télé fait cela ? Alors, oui, tout cela a un coût. Et créer de la cohésion dans une entreprise qui est depuis dix ans en constante transformation, qui est en permanence sous les feux de la rampe, et dont on redéfinit les missions selon l’actualité politique, c’est quand même très compliqué ! Vouloir aller trop vite dans le dialogue social, c’est finalement perdre du temps. Trop souvent, les projets sont annoncés à l’extérieur, sans communication dans les CSE. C’est ce qui s’est passé pour la fin des éditions nationales de France 3 avec une annonce en conférence de presse. Si on veut un dialogue apaisé, il faut…dialoguer, pas mettre les gens devant le fait accompli”.”
(*) En 2024, sur les 3,2 Mds de chiffre d’affaires de France Télévisions, les ressources publiques représentent 2,61 Mds et les recettes publicitaires 503 M€. Selon la présidente de France Télévisions, entre 2015 et 2025, “le niveau des concours publics alloués à France Télévisions a diminué (-1% en 10 ans, en euros courants), en dépit d’une inflation de près de 20% et alors que les crédits alloués aux autres sociétés de l’audiovisuel public ont crû de +11% sur la période”. Les syndicats et CSE de l’audiovisuel public avaient protesté en 2022 contre la suppression de la redevance.
(**) France 3 Noa est la chaîne de télévision publique pour la Nouvelle Aquitaine.
(***) Le rapport critique “les rigidités” du système salarial de France Télévisions qui prévoit par exemple, pour le salarié qui n’a bénéficié d’aucune augmentation individuelle pendant 5 ans, une revalorisation automatique de 2,5 % minimum de son salaire de base. Les magistrats critiquent aussi le coût des primes d’ancienneté. “Il y a beaucoup de cadres chez nous”, observe un délégué syndical concernant la critique des rémunérations qui peut paraître élevé.
| “Est-ce le rôle de la Cour des comptes de faire de la politique antisociale ?” |
| “Réduire la masse salariale pour retrouver des marges de manœuvre, voici donc la nouvelle ambition pour le service public !” ironise, dans un communiqué commun, les syndicats CGT, CFDT, SNJ et FO de France Télévisions au sujet du rapport de la Cour des comptes. Les syndicats jugent ce rapport “très théorique et déconnecté de la réalité du terrain et des conditions de travail très dégradées des salariés”. Concernant une classification des métiers jugée trop rigide par la Cour des comptes au regard des évolutions numériques, les syndicats rappellent “les propositions faites en 2011 dans le cadre de la négociation de la nomenclature des métiers : une liste d’une dizaine de métiers du numérique, tout simplement refusée par la direction de l’époque”. Il est vrai, ajoute le communiqué, que le but de la direction “était d’externaliser les développement du numérique. Et on nous impose maintenant de payer le prix aujourd’hui de cette erreur stratégique ?” Et les quatre syndicats avertissent : “Nous nous opposons à notre direction qui entend faire sienne les conclusions de ce rapport. Les relations sociales n’ont pas fini de se tendre dans ces conditions”. |
Bernard Domergue
[ 3 Q / R] Procédure collective d’un CSE, prise en charge de la rémunération pendant la formation, changement de syndicat pendant le mandat d’élu
30/09/2025
Chaque mois, un juriste de L’Appel Expert examine 3 questions posées par des élus du personnel. Dans cet article, Sandra Dos Santos-Balez répond aux questions suivantes : Un CSE employeur peut-il faire l’objet d’une procédure collective et ses salariés se trouver exclus de la garantie de salaires AGS ? Le CSE doit-il prendre en charge la rémunération du salarié pendant son congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale ? Quand un élu du CSE change de syndicat après son élection, quelle appartenance syndicale doit être mentionnée sur la feuille d’émargement de la première réunion du CSE ?
[3 questions d’élus, 3 réponses d’expert]

Sandra Dos Santos-Balez, juriste pour l’Appel Expert, répond à 3 questions posées par des élus de CSE en septembre 2025
Un CSE employeur peut-il faire l’objet d’une procédure collective et ses salariés bénéficier de la garantie des salaires ?
Oui, un CSE employeur peut être en procédure collective, ses salariés sont inclus dans l’AGS
Un CSE a été condamné par les prud’hommes à payer une certaine somme et ne dispose plus de fonds propres. Il se pose donc la question de le placer en redressement ou liquidation judiciaire et de savoir si ses salariés peuvent bénéficier ou non des AGS (Assurance garantie des salaires, régime qui garantit le paiement des rémunérations impayées des salariés dont l’employeur est en procédure collective).
Les textes n’excluent pas les CSE des procédures collectives. Peut faire l’objet de ces procédures n’importe quelle personne morale de droit privé. Le CSE est doté de la personnalité morale de droit privé et dispose de la capacité civile. Il est donc juridiquement autonome et peut agir en justice.
De plus, le site internet de l’Urssaf indique que le CSE employeur déclare et verse des cotisations au titre de ses salariés, il gère son patrimoine et est débiteur de ses dettes sociales. Selon l’Urssaf, en cas de cessation des paiements et de liquidation judiciaire du CSE, ses biens peuvent être saisis et vendus.
Selon les articles L.620-2, L.631-2et L.640-2 du code de commerce, les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation sont applicables à toute personne morale de droit privé. Ces textes ne prévoyant aucune exclusion, le CSE peut bien être placé sous l’une de ces procédures.
Quant aux AGS, les textes applicables ne prévoient pas d’exclusion formelle des CSE. Selon l’article L.3253-6 du code du travail, “Tout employeur de droit privé assure ses salariés (…) contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail”.
Cet article assujettit à l’AGS l’ensemble des personnes morales de droit privé quelle que soit leur forme juridique dès lors qu’elles emploient des salariés.
Seule exclusion formulée : les syndicats de copropriété depuis le 26 juillet 1994 du fait de la non-application à leur égard de la loi relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. Ainsi, le CSE employeur ne se trouvant pas expressément exclu, ses salariés bénéficient en principe de la garantie AGS.
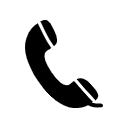
Le CSE doit-il prendre en charge la rémunération du salarié pendant son congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale ?
Non, cette prise en charge revient à l’employeur
Selon l’article L.2145-6 du code du travail, le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale a droit au maintien total par l’employeur de sa rémunération. L’employeur verse de plus les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.
Si le CSE peut prendre en charge certains frais d’hébergement, de transport ou de repas, seul l’employeur est tenu au maintien de la rémunération du salarié. Le CSE n’a donc pas à prendre en charge le paiement de la rémunération.
Quand un élu du CSE change de syndicat après son élection, quelle appartenance syndicale doit être mentionnée sur la feuille d’émargement de la première réunion du CSE ?
Il s’agit du syndicat au moment de l’élection
Un élu CGT a changé d’étiquette syndicale et a choisi FO entre son élection et la première réunion du CSE. Se pose donc la question du syndicat à mentionner sur la feuille d’émargement de la réunion : s’agit-il du syndicat au moment de son élection (CGT) ou de celui auquel l’élu appartient au moment de la réunion (FO) ?
Selon un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 20 décembre 2010 (n°09-7060), un représentant du personnel élu sur une liste syndicale et qui change d’appartenance en cours de mandat ne peut pas se prévaloir de cette nouvelle appartenance. Cet arrêt n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi en Cour de cassation, il est considéré comme définitif.
De même, la Cour de cassation a jugé le 28 septembre 2011 (n° 10-26.762) qu’un changement d’étiquette syndicale en cours de mandat ne permet pas au syndicat bénéficiaire de ce changement de se prévaloir des élus l’ayant rejoint. Un changement d’affiliation décidé après l’élection ne peut ouvrir au syndicat le droit de désigner des représentants. L’élu présent sur la liste de son syndicat d’origine ne peut pas apporter à son nouveau syndicat le bénéfice de son élection sans porter atteinte aux suffrages exprimés.
Par conséquent, seul le syndicat d’origine au moment de l’élection de l’élu doit figurer sur la liste d’émargement.
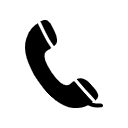
Une infographie de Marie-Aude Grimont avec les juristes de l’Appel Expert du groupe Lefebvre Dalloz
Taxe d’apprentissage : les entreprises ont jusqu’au 25 octobre pour verser leur solde sur Soltéa
01/10/2025
Le réseau des Urssaf rappelle sur son portail internet que les entreprises ont jusqu’au 24 octobre 2025 pour répartir le solde de leur taxe d’apprentissage auprès des établissements habilités par le biais de la plateforme Soltéa.
Vette plateforme, gérée par la Caisse des dépôts, permet aux entreprises de :
- choisir les établissements bénéficiaires, les formations qu’elles souhaitent soutenir en leur affectant le solde de leur taxe d’apprentissage ;
- suivre les virements effectués par la Caisse des dépôts à l’attention des établissements bénéficiaires de leur solde.
Source : actuel CSE
PSE : seule la faute lourde du Dreets engage la responsabilité de l’État
03/10/2025

L’exercice par le directeur régional du travail (Dreets) de son pouvoir de validation ou d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi ne peut justifier l’indemnisation de l’employeur par l’État que si une faute lourde a été commise par l’administration.
Lorsque la décision du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) qui valide ou homologue le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) d’une entreprise est annulée sur recours hiérarchique ou contentieux, l’employeur doit indemniser les salariés illégalement licenciés (article L.1235-11 du code du travail). Si le Dreets refuse à tort de valider ou d’homologuer son PSE, l’employeur subit également un préjudice car il ne peut pas mener à bien la procédure de licenciement économique. Il peut alors saisir le juge d’une action en responsabilité de l’Etat, afin d’obtenir réparation du dommage causé par la faute de l’administration.
Le Conseil d’Etat, par deux décisions publiées au recueil Lebon, décide pour la première fois que, s’agissant d’un PSE, seule une faute lourde du Dreets permet d’engager la responsabilité de l’Etat.
Une validation et un refus d’homologation annulés sur recours contentieux
Dans la première affaire, le refus d’homologation administrative du document unilatéral portant PSE de la société, en cessation d’activité, avait été annulé par le juge. La société réclamait à l’Etat une somme de plus de 1,5 million d’euros en réparation de son préjudice. Elle a obtenu 440 000 euros en première instance, mais ce jugement a été annulé en appel. La société a saisi le Conseil d’Etat.
La seconde affaire concernait la société Pages jaunes, devenue société Solocal après ses nombreuses restructurations. La validation de son accord majoritaire portant PSE a été annulée par le juge administratif. La société a réclamé une indemnisation de plus de 2,5 millions d’euros, mais a été déboutée. Elle s’est pourvue en cassation.
Le Conseil d’Etat limite les cas de mise en jeu de la responsabilité de l’Etat
Une responsabilité conditionnée à la faute lourde de l’administration
Dans les deux affaires, le Conseil d’Etat juge que dans les contentieux relatifs à la validation ou à l’homologation du PSE, seule une faute lourde du Dreets est de nature à mettre en jeu la responsabilité de l’Etat.
Il explique sa position par deux éléments :
- d’une part, la nature du contrôle exercé par l’administration, qui est fixé par le code du travail et précisé par la jurisprudence du Conseil d’Etat ;
- d’autre part, le rôle conféré à l’administration dans le processus d’élaboration du PSE, qui est “extérieur” : le Dreets n’est pas partie à la négociation de l’accord ou à la rédaction du document unilatéral ; il peut seulement, en cours de procédure, présenter des observations ou propositions à l’employeur et, sur demande des représentants du personnel, lui adresser des injonctions.
La faute du Dreets ayant excédé les limites de son contrôle sera réexaminée
Dans la première affaire, il était reproché au Dreets d’avoir refusé l’homologation du PSE à l’issue d’un contrôle trop zélé.
Premier motif du refus d’homologation : la procédure d’information-consultation des représentants du personnel dans le cadre de l’obligation de recherche de repreneurs aurait été irrégulière. Or le Conseil d’Etat a jugé, dans un arrêt postérieur à la décision de refus d’homologation, qu’il appartient seulement au Dreets de vérifier si une telle irrégularité fait obstacle à ce que le CSE délibère et rende son avis en toute connaissance de cause (Conseil d’Etat, 22 juillet 2015), ce que le CSE avait pu faire en l’espèce. Cette irrégularité n’aurait donc pas dû fonder un refus d’homologation.
Mais pour les juges du fond, dont le raisonnement est approuvé par le Conseil d’Etat, l’illégalité de ce motif de refus d’homologation ne constituait pas une faute lourde, compte tenu notamment de l’absence, à la date de la décision, de détermination jurisprudentielle de l’étendue du contrôle de la régularité de la procédure par l’administration et des effets d’éventuels vices sur sa décision.
Second motif du refus d’homologation : l’insuffisance, selon le Dreets, des mesures d’accompagnement prévues par le PSE. Mais il ressortait des pièces du dossier qu’en exigeant la présence de certaines mesures dans le PSE, le Dreets avait excédé les limites de son contrôle. Sur ce point, la décision de la cour administrative d’appel, qui a écarté la faute lourde, est censurée, et les juges du fond devront réexaminer la question.
Pas de faute lourde sur le contrôle du caractère majoritaire de l’accord
L’annulation de la validation du PSE de la société Pages jaunes était motivée par le caractère non majoritaire de l’accord collectif portant PSE. En effet, l’accord avait bien été signé par des organisations syndicales reconnues représentatives à l’issue du premier tour des dernières élections professionnelles. Mais l’un des signataires n’avait pas été expressément redésigné délégué syndical par son syndicat, et n’avait donc pas qualité pour le représenter, ce dont le Dreets n’avait pas été informé.
Saisi du litige, le Conseil d’Etat a jugé en 2015 que le Dreets doit vérifier la qualité des signataires de l’accord (Conseil d’Etat, 22 juillet 2015 n° 385668 et 386496). Ici, pour les juges, le Dreets n’a pas commis de faute lourde, car il a procédé au contrôle du caractère majoritaire de l’accord, en application des règles légales et jurisprudentielles applicables au moment où il a pris sa décision, nécessairement antérieure à celle du Conseil d’Etat en l’espèce.
Laurence Méchin
Financements publics aux entreprises : des députés proposent le recours à un expert-comptable par le CSE
03/10/2025
Une proposition de loi “visant à renforcer la traçabilité des financements publics accordés aux entreprises”, déposée à l’Assemblée nationale le 16 septembre, prévoit la possibilité pour le CSE (comité social et économique) de désigner un expert-comptable (notamment) en cas d’information et de consultation relatives à un financement public (lorsque l’entreprise se voit attribuer, par une personne publique, une subvention, prêt ou avance remboursable d’un certain montant).
Source : actuel CSE
Intelligence artificielle : un rapport parlementaire appelle à un effort massif de formation
03/10/2025
Les députés Emmanuelle Hoffman et Antoine Golliot ont remis un rapport de près de 400 pages, publié le 30 septembre, sur les effets de l’intelligence artificielle (IA) dans les entreprises françaises, assorti de 68 recommandations.
Face à la “domination des acteurs américains et chinois”, les deux rapporteurs plaident pour des “décisions fortes” afin de faire de l’intelligence artificielle un levier de compétitivité et de souveraineté. Le texte, fruit d’une quarantaine auditions, insiste particulièrement sur l’enjeu de la formation professionnelle.
Parmi les préconisations : intégrer l’IA dans les programmes scolaires, renforcer les filières scientifiques, mobiliser la validation des acquis de l’expérience (VAE) et le compte personnel de formation (CPF), ou encore créer un fonds de transition numérique conditionné à des obligations de formation pour les TPE-PME.
Le rapport recommande également d’inscrire l’IA au cœur du dialogue social, en l’intégrant aux négociations annuelles obligatoires et en imposant la consultation des instances représentatives du personnel dès l’engagement des projets technologiques basés sur l’IA, y compris au stade expérimental.
Les rapporteurs appellent à la conclusion d’un accord national interprofessionnel ou à l’actualisation des accords de branche sur le sujet.
Au-delà, le document aborde la sécurité des données, la diversité linguistique et la transparence des règles.
Source : actuel CSE

