L’expert assistant le CSE dans le cadre d’un projet important ne peut pas exiger une évaluation de la charge de travail
07/07/2025
L’expert désigné par le CSE dans le cadre de ses attributions consultatives ne peut pas exiger la communication de documents n’existant pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire pour l’entreprise.
En juin 2021, la SNCF procède à la consultation de son CSE central sur un projet de réorganisation dans le cadre d’un programme “Maintenir demain”. Objectif de ce projet : “‘atteindre le meilleur niveau de maintenance pour la sécurité et la ponctualité des circulations ferroviaires”.
C’est ensuite au tour des CSE d’établissement (CSEE) d’être consultés. A cette occasion, l’un d’entre eux vote une expertise.
► Remarque : le comité social et économique peut se faire assister par un expert habilité en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (article L. 2315-94 du code du travail). L’employeur paye l’expertise à hauteur de 80 %, le reste étant à la charge du CSE sur son budget de fonctionnement.
Le CSE d’établissement exige la communication de certaines informations
Estimant que l’expert n’avait pas pu disposer des informations demandées à l’employeur, le CSEE décide de porter l’affaire en justice. Il exige la communication d’un certain nombre d’informations, ainsi que la prolongation du délai de consultation à compter de la réception de ces informations.
La SNCF est notamment condamnée à communiquer au CSEE et à son expert, la société Degest, “l’évaluation de la charge de travail de chaque poste, dans la future organisation, notamment sur les nouveaux métiers”.
Pour la cour d’appel, devant qui l’employeur avait fait notamment valoir qu’il n’avait pas à évaluer la charge de travail au stade de la procédure de consultation du CSE, “l’évaluation des risques professionnels dont relève l’évaluation de la charge de travail doit nécessairement reposer sur des analyses concrètes”. Quant à “l’affirmation selon laquelle la réorganisation n’emporterait pas de modifications du métier ni du périmètre d’intervention, ni de diminution des moyens matériels mis à disposition, ni d’évolution significative des effectifs”, elle “doit pouvoir être examinée et analysée par l’expert et relève donc indubitablement de sa mission”.
La Cour de cassation ne partage pas le point de la vue de la cour d’appel.
Pas de communication d’un document sur la charge de travail
Comme le rappellent les juges, si l’employeur a bien l’obligation de fournir à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission, “l’expert … ne peut pas exiger la production de documents n’existant pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire pour l’entreprise”. Or, “les textes qui régissent la procédure de consultation du comité social et économique ne prévoient pas la communication systématique d’un document d’évaluation de la charge de travail”.
Conclusion, la SNCF ne pouvait pas être condamnée à fournir au CSE d’établissement et à son expert une évaluation de la charge de travail.
► Remarque : la règle en vertu de laquelle l’expert du CSE ne peut pas exiger la production de documents n’existant pas et dont l’établissement n’était pas obligatoire pour l’entreprise n’est vraiment pas nouvelle. Elle existait pour l’expert-comptable déjà à l’époque du comité d’entreprise (par exemple, Cass. soc., 27 mai 1997, n° 95-20.156). Elle a en revanche rarement été appliquée à l’expert susceptible d’accompagner le CSE en cas de projet important ou de risque grave. C’est tout ce qui fait l’intérêt de cette jurisprudence.
Frédéric Aouate
IA : Bercy lance un plan national
07/07/2025
Le 1er juillet, le ministère de l’Economie a annoncé le lancement d’un plan national « Osez l’IA » visant à accélérer la diffusion de l’intelligence artificielle dans toutes les entreprises.
Le plan se décline autour de 3 axes principaux :
- sensibiliser pour favoriser l’adoption à l’IA (création et mobilisation d’un réseau de 300 ambassadeurs IA, événements de mise en relation etc.) ;
- former, via une Académie de l’IA, 15 millions de professionnels d’ici 2030 ;
- accompagner les entreprises pour identifier les solutions d’IA pertinentes.
Source : actuel CSE
[ 3 Q / R] Surface du local du CSE, envoi du procès verbal à l’administration du travail, financement de la formation économique des élus
08/07/2025

Frédérique Durand
Chaque mois, un juriste de L’Appel Expert examine 3 questions posées par des élus du personnel. Dans cet article, Frédérique Durand répond aux questions suivantes : Le local du CSE doit-il mesurer une surface minimale ? Le PV du CSE doit-il être envoyé à l’inspection du travail ? Qui paie les frais liés à la formation économique et sociale des membres titulaires du CSE ?
[3 questions d’élus, 3 réponses d’expert]
Frédérique Durand, juriste pour l’Appel Expert, répond à 3 questions posées par des élus de CSE en juillet 2025
Le local du CSE doit-il mesurer une surface minimale ?
Non, il n’existe pas de surface minimale mais des conditions à respecter
L’employeur qui choisit le local du CSE doit-il respecter une surface minimale ? Selon l’article L2315-25 du code du travail, dans les entreprises d’au moins 50 salariés “l’employeur met à la disposition du comité social et économique un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions”.
Le code du travail ne précise donc rien sur la surface du local du CSE. On peut seulement en déduire que c’est l’employeur qui choisit le local du CSE. Le local doit être indépendant et ne doit pas interférer avec d’autres activités menées dans l’entreprise. Ces précisions sont illustrées par la jurisprudence. Dans un arrêt du 22 octobre 2014 (n° 13-16.614), la chambre sociale de la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel de trancher un litige entre un employeur et un CSE “sans constater que le nouveau local mis à la disposition du comité d’entreprise en remplacement de celui qu’il occupait précédemment ne lui permettait pas d’exercer normalement ses fonctions”.
Autre précision, apportée cette fois par la chambre criminelle de la même Cour, dans un arrêt du 26 janvier 2016 (n° 13-85.770) : dans cette affaire, il était question d’un local trop exigu, de deux mètres sur cinq, ne permettant pas la réunion de l’ensemble des membres du comité (sept personnes) ou la réalisation des activités collégiales prévues par la loi, est inadapté et expose l’employeur au délit d’entrave.
Pas question donc pour le CSE de tout accepter, en particulier si l’employeur lui désigne un endroit inadapté où l’instance ne pourra pas exercer réellement ses activités ni tenir ses réunions. L’employeur commettrait là un délit d’entrave.
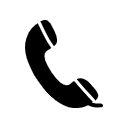
Le PV du CSE doit-il être envoyé à l’inspection du travail ?
Non, pas systématiquement
Repartons une nouvelle fois des textes pour répondre à cette question. Selon l’article L 2315-35 du code du travail, “le procès-verbal des réunions du comité social et économique peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité”.
Par ailleurs, une circulaire DRT (Direction des relations de travail du ministère) n° 12 du 30 novembre 1984 prévoit que le règlement intérieur du comité peut décider que la diffusion du procès-verbal sera automatique, que le secrétaire devra en décider ou bien encore qu’il faudra chaque fois prévoir un vote du comité.
De plus, selon l’article L 2315-33, “le CSE peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises à l’autorité administrative”, par exemple à la Dreets (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) précise l’article R 2315-24.
C’est donc bien le CSE et son règlement intérieur qui fixent les modalités de diffusion du procès-verbal de réunion.
En revanche, dans certains cas, la loi oblige la transmission du PV de CSE à la Dreets, par exemple :
– en cas de en cas de licenciement collectif pour motif économique avec PSE (C. trav. art. L 1233-48 et D 1233-5).
– en cas de demande d’autorisation de licenciement d’un représentant du personnel, l’avis du CSE sur le projet de rupture doit être consigné dans un procès-verbal établi à l’issue de la réunion. Il sera joint à la demande d’autorisation de rupture adressée à l’inspecteur du travail ” (articles R 2421-1 et R 2421-10 du Code du travail).
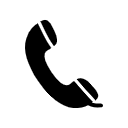
Qui paie les frais liés à la formation économique et sociale des membres titulaires du CSE ?
Le CSE via son budget de fonctionnement
L’article L 2315-63 du code du travail prévoit que “dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, sous certaines conditions et limites, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours”. Il indique aussi que le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique.
Le code du travail précise également à l’article L 2315-16 que “le temps consacré aux formations des membres du CSE est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation”.
Une ancienne circulaire DRT du 22-9-1983 à la circulaire DRT du 6-5-1983, 3-1, réputée abrogée affirmait même que “le financement de la formation inclut aussi bien le prix du stage que les éventuels frais de déplacement et d’hébergement”. Aucune jurisprudence n’a aujourd’hui repris cette circulaire. Quoiqu’il en soit, il semble logique que les frais de déplacement et d’hébergement soient bien pris en charge par le budget de fonctionnement en cas de formation économique d’un élu.
Pour mémoire, l’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalant à :
•0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à moins de deux mille salariés ;
•0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d’au moins 2 000 salariés (article L2315-61du Code du travail).
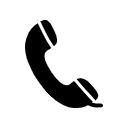
Une infographie de Marie-Aude Grimont
Avec les juristes de l’Appel Expert du groupe
Répartition du personnel et des sièges entre les collèges : le juge doit se prononcer
08/07/2025

Si le Dreets (directeur régional du travail) ne se prononce pas dans le délai imparti sur la demande de répartition entre les collèges électoraux, le juge doit procéder lui-même à cette répartition. À cette fin, il doit déterminer si les éléments d’information demandés par les organisations syndicales existent et lui sont nécessaires pour procéder à cette répartition et, dans l’affirmative, en ordonner la production.
En application des articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail, si au moins un syndicat a répondu à l’invitation de l’employeur de négocier le protocole préélectoral (PAP), mais qu’aucun accord n’a pu être obtenu sur la répartition des sièges et du personnel dans les collèges électoraux à l’issue d’une tentative loyale de négociation, il revient à la Dreets (direction régionale du travail) de décider de cette répartition. Sa décision (ou sa décision implicite de rejet, au bout de 2 mois) peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire.
Qu’en est-il de l’office du juge dans ce cadre ? Peut-il refuser de statuer, et renvoyer les parties à la négociation du PAP, au motif que l’employeur, n’ayant pas transmis certaines informations demandées par les syndicats, n’a pas négocié loyalement ? C’est sur ce point que la Cour de cassation se prononce dans cet arrêt publié du 25 juin 2025.
Le juge refuse de statuer sur la répartition entre les collèges
Dans cette affaire, une unité économique et sociale (UES) organise ses élections professionnelles. Dans ce cadre, un accord collectif prévoit que les sociétés de l’UES présentes en Île-de-France sont regroupées en 3 établissements distincts. Pour ces 3 CSEE, l’employeur invite les organisations syndicales intéressées à négocier un PAP.
En l’absence d’accord pour 2 des CSEE, l’employeur saisit la Dreets pour fixer la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les collèges, conformément à l’article L. 2314-13.
Cependant, la Dreets ne se prononce pas dans le délai imparti de 2 mois. Il en résulte une décision implicite de rejet, que conteste l’employeur devant le juge judiciaire, auquel il demande de procéder à ces répartitions.
Le juge judiciaire refuse cependant de se prononcer sur cette répartition. Il constate que la négociation du PAP n’a pas été menée loyalement : il déclare la demande irrecevable et ordonne la reprise des négociations dans un délai de 8 jours.
Pour lui, constitue une absence de négociation loyale le refus de l’employeur de délivrer aux syndicats participant à la négociation les fiches de postes et toutes les informations susceptibles de permettre la vérification de la correspondance entre les classifications de la convention collective applicable et la réalité des tâches exercées dans l’entreprise, ainsi que toutes les informations utiles à la sous-traitance.
► Remarque : rappelons que pour répartir les salariés dans les collèges électoraux, il convient de rechercher la nature des fonctions réellement exercées par les intéressés (Cass. soc., 12 mai 2021, n°19-24.476 ; Circ. DRT n° 93-12, 17 mars 1993, Annexe fiche 5, n° 2.3 : BO Trav., n° 94-1). Peu importe la qualité en laquelle ils les accomplissent. En effet, l’appartenance d’un salarié à un collège électoral est déterminée par la nature de l’emploi qu’il occupe effectivement (Cass. soc., 10 mai 1983,n° 82-60.624).
La notion de défini de justice
Mais la Cour de cassation n’est pas d’accord. Elle rappelle les articles L. 2314-13 et R.2314-13 du code du travail, et elle vise aussi l’article 4 du code civil. C’est l’article définissant et sanctionnant le déni de justice : “Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice”.
La Haute cour en déduit qu’il “appartient en conséquence, au tribunal judiciaire d’examiner l’ensemble des contestations lorsqu’aucune décision n’a été rendue par le Dreets et de statuer sur les questions demeurant en litige d’après l’ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue”.
Le tribunal judiciaire ne peut donc pas déclarer irrecevable la demande d’une société de fixer la répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges électoraux. Il doit se prononcer et procéder à ces répartitions. Si les éléments d’information demandés par les syndicats existent et sont nécessaires pour ce faire, il doit en ordonner la production.
La Cour de cassation casse donc le jugement du tribunal judiciaire et renvoie devant un autre tribunal judiciaire, qui devra se prononcer selon les règles édictées.
► Remarque : Si cette solution semble de prime abord contraire à une décision de la même chambre sociale du 6 mai 2025, d’après nous, il n’en est rien. En effet, dans cette affaire, il a été décidé que lorsque l’employeur a manqué à son obligation de loyauté dans la négociation, il n’est pas légitime à saisir la Dreets, et donc le juge judiciaire, lequel peut le renvoyer à la négociation. Cependant, ici, non seulement l’employeur a manqué à la transmission aux syndicats d’éléments d’informations déterminants, mais surtout, souligne la Cour, un courrier de l’inspecteur du travail confortait les déclarations de plusieurs syndicats sur les conditions délétères dans lesquelles se tenaient les réunions de négociation du PAP et sur les agissements déloyaux de l’employeur dénoncés par ceux-ci (Cass. soc., 6 mai 2025, n° 24-17.928).
Un autre arrêt du 12 juillet 2022 explique que la tentative loyale de négociation est une condition du recours à l’autorité administrative, et vérifie qu’il n’y a effectivement pas eu de tentative loyale de négociation. Sont en cause, certes, la communication d’informations, mais à nouveau, également, les conditions de la négociation (actualisation de l’effectif l’avant-veille de la réunion de négociation, demande de positionnement immédiat des organisations syndicales et interruption unilatérale par l’employeur des négociations) (Cass. soc., 12 juill. 2022, n°21-11.420).
Ainsi, le manquement à l’obligation de loyauté ne se déduit pas automatiquement du silence gardé par la Dreets, ni de la non-transmission de certaines informations déterminantes à la négociation. Le juge judiciaire doit alors faire son office et vérifier si ces informations sont nécessaires pour procéder à la répartition, et au besoin les demander à l’employeur, puis procéder à la répartition. Cette solution n’est pas nouvelle. Il a effet déjà été jugé que faute de PAP, le juge saisi d’une demande visant à répartir les sièges entre les collèges électoraux, doit effectuer cette répartition en s’appuyant sur les pièces fournies par l’employeur, et dans le cas où ces pièces lui paraissent insuffisantes, demander la production de justificatifs complémentaires (Cass.soc., 27 mai 2021, n° 20-10.638).
Séverine Baudouin
L’usage de l’IA pour la comptabilité/finances augmente-t-il ?
08/07/2025
Selon l’Insee, les entreprises qui utilisent l’intelligence artificielle pour la comptabilité, le contrôle de gestion ou la gestion financière sont plus nombreuses en 2024 qu’elles ne l’étaient en 2023. En revanche, la part de cet usage parmi l’ensemble des entreprises utilisant l’IA est en recul par rapport à 2023 (25 % en 2024, contre 31 % en 2023). Cette étude a été réalisée auprès d’un échantillon d’environ 10 500 entreprises implantées en France hors Mayotte, de 10 personnes occupées ou plus (salariés et non-salariés) des secteurs principalement marchands hors secteurs agricole, financier et d’assurance.
Source : actuel CSE
Aides publiques aux entreprises : la commission d’enquête recommande une évolution de l’information des CSE
09/07/2025

Olivier Reitmann, Fabien Gay
La commission d’enquête sénatoriale sur l’utilisation des aides publiques aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants a rendu son rapport hier matin. Parmi ses 26 recommandations, une meilleure information des CSE sur les crédits d’impôts, les réductions d’impôts et de cotisations sociales. Mais attention, tous les CSE ne sont pas concernés.
“Nous avons entendu 33 dirigeants de grandes entreprises, deux ministres en fonctions, deux anciens ministres, des personnalités qualifiées, les partenaires sociaux, des journalistes, des économistes”, a relevé en introduction de la présentation du rapport à la presse le président de la commission d’enquête sénatoriale Olivier Reitmann (Haute-Saône, Les Républicains). A la clé, 58 auditions plénières et 87 heures de travaux. Autant dire que la commission d’enquête s’attaquait à un gros morceau et a tiré des constats alarmants sur les aides publiques.
211 milliards d’euros d’aides ni pilotées ni évaluées
Le rapporteur Fabien Gay ( Seine-Saint-Denis, Groupe communiste), a salué l’engagement des salariés et syndicalistes rencontrés et rappelé que son groupe politique avait demandé la création de cette commission en raison du contexte économique et budgétaire. Autre motif : des PSE comme ceux d’Auchan et de Michelin et l’absence de réponse fouries par ces employeurs à l’inspection générale des finances (et aux ministres Barnier et Lombard) sur l’utilisation des aides publiques perçues.
Au-delà de ces dossiers très médiatisés, la commission a mené un travail de fourmi et abouti à des constats glaçants : les aides publiques ne sont pas définies, mal répertoriées, non centralisées, mal pilotées et opaques. A grands renforts de demandes et d’auditions, la commission a aussi établi un chiffre : 211 milliards. Tel est le montant des aides publiques versées aux grandes entreprises de plus de 1000 salariés, réalisant un chiffre d’affaires net mondial d’au moins 450 millions d’euros par an (incluant leurs sous-traitants).
On le voit, le champ de la commission d’enquête étant resserré sur les plus grosses sociétés, le chiffre réel des aides publiques est sans doute encore plus élevé s’il était élargi à des entreprises plus petites. Quoi qu’il en soit, la commission émet également 26 recommandations, parmi lesquelles une modification de l’information des CSE par l’employeur sur les aides perçues. Cependant, elle limite cette préconisation aux entreprises dépourvues d’accord relatif aux consultations récurrentes du CSE.
Une information du CSE en l’absence d’accord sur les consultations récurrentes
“J’ai reçu des milliers de messages de salariés, j’en ai encore rencontré à Dunlop dans l’Allier et chez Sanofi. Nous donnons des nouvelles prérogatives au CSE chaque année, le montant des aides publiques doit être donné et un débat doit s’organiser au sein même de l’entreprise”, a indiqué Fabien Gay, rapporteur de la commission d ‘enquête.
Attention, la lecture du rapport fournit de plus amples détails et cette bonne volonté d’information est cependant limitée. Signalons tout d’abord qu’il n’est question que d’information du CSE, mais pas de consultation et encore moins de droit de regard ni d’opposition.
Le rapport commence par rappeler les principes d’information du CSE déjà existants, et les trois consultations récurrentes sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière, et la politique sociale. Il rappelle également que de manière supplétive, en l’absence d’accord d’entreprise sur les consultations récurrentes (article L2312-19 du code du travail), l’article R2312-16 impose à l’employeur une information sur un nombre limité de rubriques de la base données économiques sociales et environnementales (BDESE) l’évolution des emplois par catégorie professionnelles, et ce, dans les entreprises de moins de 300 salariés. Il s’agit des données sur l’investissement matériel et immatériel, les aides publiques, les résultats financiers, les partenariats les transferts commerciaux et l’environnement.
Partant de ce constat, et du fait que des dispositions quasi identiques s’appliquent aux entreprises d’au moins 300 salariés, le rapport prend acte “quelle que soit la taille de l’entreprise, et en l’absence d’accord sur les consultations récurrentes du CSE”, que l’instance ne dispose pas d’informations sur les réductions d’impôts dont bénéficie l’entreprise, les crédits d’impôts et les exonérations et réductions de cotisations sociales.
“Afin de permettre une meilleure association du CSE au contrôle des aides publiques et de clarifier les obligations des entreprises, la commission d’enquête préconise d’élargir les informations de la BDESE communiquées au CSE en incluant dans les articles R. 2312-16 et R. 2312-17 précités les champs 7°B à 7°D de l’article R. 2312-8 du code du travail : c’est-à-dire les réductions d’impôts, les exonérations et réductions de de cotisations sociales, ainsi que les crédits d’impôt dont bénéficie l’entreprise“.
Une concertation préalable avec les partenaires sociaux
Il restera à faire porter les évolutions législatives nécessaires par le gouvernement. Selon le président et le rapporteur de la commission, ils ne disposent pas encore de retour de l’exécutif sur leurs préconisations. De plus, s’ils envisagent de rédiger une proposition de loi sur la base de leur rapport, ils n’en ont pas encore défini les contours. Seule chose certaine : après leur travail commun et malgré leurs positions politiques divergentes (Les républicains et Groupe communiste), leur bonne entente dans le cadre de la commission va désormais laisser place à une reprise de leur liberté de parole. Chacun pourra donc porter ses propositions.
Concernant les évolutions relatives à l’information du CSE, le rapport propose “dans un esprit proche de celui de l’article L1 du code du travail”, que cette évolution fasse l’objet “d’une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel lorsqu’une concertation sera engagée sur un sujet connexe”.
Ce sera donc aussi aux responsables des organisations patronales et syndicales de décider s’ils souhaitent travailler ensemble sur le sujet. Pour l’heure, on peut dresser un autre constat du rapport : il n’évoque pas la conditionnalité des aides publiques au maintien de l’emploi.
L’emploi, grand absent du rapport
C’est une demande unanime des organisations de salariés : conditionner les aides publiques à des mesures sociales, en particulier le maintien dans l’emploi, voire le développement de l’emploi existant. Rappelée à longueur d’interviews par les numéros un des organisations syndicales, le conditionnement des aides publiques à des politiques sociales favorables aux salariés voire à l’absence de tout licenciement, n’a cependant pas été retenue dans les préconisations du rapport.
Nous en avons fait la remarque au président et au rapporteur de la commission d’enquête. Légèrement gênés par notre demande, ils nous ont cependant apporté leur réponse. Selon Olivier Reitmann, la question a bien été évoquée au fil des auditions mais “si vous ne le trouvez pas dans le rapport, c’est qu’on a décidé de ne pas le mettre. Même si pour certains ce serait de bon aloi, on a voulu être dans le consensus et le compromis”. Sur le fond, le président de la commission nous a indiqué qu’il semblait difficile d’imposer un maintien dans l’emploi aux entreprises en raison de leur situation économique et des incertitudes sur l’avenir. Il argumente également que l’entreprise peut connaître un retour à meilleure fortune mais aussi des revers, rendant impossible un conditionnement des aides aux emplois.
Le sénateur communiste Fabien Gay se trouve naturellement plus favorable à cette proposition syndicale. Si la commission a retenu de préconiser une suspension des aides pendant deux ans en cas de délocalisation, le rapporteur se trouve contraint de s’exprimer “à titre personnel” sur le sujet : “Je sors de mon rôle de rapporteur en vous disant que je suis pour durcir les conditions d’accès aux plans de licenciements économiques”. Le président de la commission lui recommandant à l’oreille de ne pas évoquer le sujet, il nous répond également : “Je partage tout à fait ce que vous venez de dire et qui ne se trouve pas dans le rapport car il ne faisait pas l’unanimité et ne nous permettait pas d’avancer (…) mais à partir de cet après-midi, chacun retrouve aussi sa liberté de parole sur tout un tas de questions, et donc celles que vous pose”.
Pas de condition de maintien dans l’emploi donc, ni de condition sur la qualité des emplois et leur durée. En revanche, les 26 préconisations existantes ne manqueront pas de susciter des débats dans l’hémicycle… et les entreprises. A noter enfin que le président de la commission a vivement critiqué l’absence de François Hollande. certes, ce dernier n’étant pas soumis à l’ordonnance du 17 novembre 1958, il ne pouvait être convoqué mais simplement invité. Malgré les relances, il a refusé de s’y rendre, tout en acceptant deux invitations dans d’autres commissions. “Esquive ou dérobade, cela a privé nos concitoyens de ses explications sur le crédit d’impôt compétitivité et emploi (CICE) et son bilan alors que ce dispositif couteux se trouvait au cœur de son «quinquennat, a insisté Olivier Reitmann.
| Les 26 préconisations du rapport de la commission d’enquête |
| La commission recommande un choc de transparence, de rationalisation, de responsabilisation et d’évaluation des aides. Parmi les propositions les plus importantes, on peut relever : – Interdire l’octroi d’aides publiques et imposer leur remboursement aux entreprises condamnées de manière définitive pour une infraction grave ou qui ne publient pas leurs comptes – Poursuivre la réflexion sur l’efficacité des allègements de cotisations sociales par secteurs d’activité – Fixer les conditions dans lesquelles une aide publique sera évaluée dès le moment de sa création – Engager une réflexion portant sur la réduction du plafond de sous-traitance du crédit d’impôt recherche et du taux applicable, l’exclusion du dispositif de certains secteurs d’activité et la promotion de l’industrialisation en France et en Europe des procédés qui ont été découverts grâce à cette dépense fiscale – Imposer le remboursement total d’une aide de l’État ou des collectivités territoriales si l’entreprise procède à une délocalisation d’un site ou d’une activité ayant justifié l’aide dans les deux années suivantes, et prévoir les autres conditions de remboursement, partiel ou total, dès l’octroi de l’aide – Demander à l’Insee de créer d’ici le 1er janvier 2027 un tableau détaillé et actualisé chaque année sur les aides publiques aux entreprises, en fonction de leur taille – Créer un registre simplifié des aides publiques reçues par les grandes entreprises et des prélèvements obligatoires acquittés – Créer un test PME de toute nouvelle aide publique – Rendre obligatoire les études d’impact préalables à la création de toute aide Diviser par trois le nombre de dépenses fiscales et de subventions budgétaires aux entreprises d’ici 2030 La conférence de presse, le rapport et sa synthèse sont en ligne sur le site du Sénat. |
Marie-Aude Grimont
Un membre titulaire du CSE central est remplacé dans les mêmes conditions que les titulaires du CSE
09/07/2025

À défaut de remplacement possible par un suppléant au CSE central du même établissement, on va en priorité chercher un suppléant d’un autre établissement de la même liste syndicale et de la même catégorie professionnelle.
Un salarié, élu FO au sein de l’un des CSE d’établissement de la société Schindler et membre titulaire du comité social et économique central, quitte l’entreprise. Pour le remplacer au sein du CSE central (CSEC), le comité d’établissement choisit un élu du même collège mais issu de la liste CGT.
Erreur, qui permet à la direction de Schindler d’obtenir l’annulation de la désignation du salarié en qualité de membre titulaire du CSEC.
Même liste et même catégorie
Comme l’ont relevé les juges, le salarié était “membre titulaire au CSEC, appartenant à la liste syndicale FO et relevant de la catégorie professionnelle des techniciens et agents de maîtrise”. Donc, “à défaut de remplacement possible par un suppléant au CSEC du même établissement”, il devait “être remplacé par priorité par un suppléant appartenant à un autre établissement de la même liste syndicale et de la même catégorie professionnelle et titulaire au CSEE de son établissement”.
La désignation d’un élu titulaire CGT au CSE du même établissement n’était donc pas conforme aux règles prévues par le code du travail (article L. 2314-37 du code du travail). D’où son annulation.
► Remarque : cette affaire a déjà donné lieu à une jurisprudence du 6 décembre 2023 (Cass. soc., 6 déc. 2023, n° 22-21.239). La Cour de cassation y a précisé que sauf disposition conventionnelle plus favorable, il n’est pas possible de remplacer un membre suppléant du CSE central.
Qui remplace qui ?
Cette affaire est l’occasion de rappeler les règles de remplacement.
En application de l’article L. 2314-37 du code du travail, lorsqu’un membre titulaire du CSE central cesse ses fonctions, il est remplacé selon l’ordre de priorité suivant :
- par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle du titulaire à remplacer, de la même catégorie professionnelle ;
- à défaut, par un suppléant élu de la même organisation mais d’une autre catégorie professionnelle, ou d’un autre collège ;
- à défaut, par un candidat non élu présenté par la même organisation syndicale, venant sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant ;
- à défaut, par un suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Si aucun suppléant du même établissement n’est disponible, le remplacement peut s’effectuer par un suppléant d’un autre établissement appartenant à la même liste syndicale et, si possible, de la même catégorie (Cass. soc., 26 oct. 2011, n° 10-20.918).
Frédéric Aouate
Taxes chinoises sur le cognac : 34 producteurs auraient trouvé un accord selon FO
11/07/2025
En mai 2025, les acteurs de la filière du cognac en France et les élus du personnel de certains producteurs avaient sonné l’alarme : face aux droits de douane que la Chine tentait d’imposer (39 %), les représentants syndicaux craignaient une contagion des fermetures et des pertes d’emplois. Pour l’instant, le danger semble écarté : les directions de 34 maisons de cognac auraient négocié un tarif inférieur à 39 %.
Selon Pascal Saeyvoet, secrétaire fédéral à la fédération agroalimentaire de Force Ouvrière (majoritaire chez Rémy Martin par exemple), ces 34 entreprises représentent 92 % de la filière. Il ajoute : “Les équipes syndicales sont désormais informées, on attend les réunions de CSE où les élus seront informés”.
Source : actuel CSE
Embauches, licenciements, ruptures conventionnelles : les derniers chiffres de la Dares
11/07/2025
La direction de l’animation de la recherche et de études statistiques (Dares) du ministère du travail a publié hier plusieurs études sur le marché du travail pour la période du 1er trimestre 2025.
► Sur le plan des embauches, la Dares recense 6,4 millions de contrats de travail signés dans le secteur privé au 1er trimestre, soit un chiffre stable par rapport au trimestre précédent. Le nombre d’embauches en CDI continue de baisser (- 0,9 % d’un trimestre à l’autre, après une précédente baisse de 3,3 %) tandis que celles en CDD se stabilisent.
Les embauches se redressent dans l’industrie (+ 0,9 % après – 5,8 %), elles sont stables dans les services et nettement en baisse dans la construction (- 1,5 %). Le nombre de missions d’intérim progresse de 1,2 %.
► Sur le plan des ruptures de contrat de travail, l’administration comptabilise 239 700 licenciements en France pour les trois premiers mois de l’année, soit une hausse de 3 % par rapport au trimestre précédent.
Sur ce total, on dénombre 18 100 licenciements pour motif économique (stabilité par rapport à la période précédente) et 221 600 licenciements pour un motif autre qu’économique (+ 3,3 %).
► Sur le plan des ruptures conventionnelles, 128 000 cas sont recensés, soit une baisse de 1,2 % par rapport au trimestre précédent.
► Par ailleurs, 492 900 démissions sont répertoriées sur les trois premiers mois de 2025.
Source : actuel CSE

