L’employeur ne peut pas imposer au salarié itinérant un changement de secteur géographique
15/07/2025
Un salarié itinérant peut être affecté temporairement sur un autre secteur géographique. Mais si son contrat de travail ne comporte pas de clause de mobilité, une affectation pérenne sur un autre secteur constitue une modification de son contrat qu’il peut refuser.
Le déplacement dans un autre secteur géographique est possible s’il est occasionnel
La mutation d’un salarié dont le contrat de travail ne prévoit pas de clause de mobilité nécessite son accord si elle implique un changement de secteur géographique (arrêt du 3 mai 2006 ; arrêt du 17 février 2021).
Par conséquent, l’employeur peut, dans l’exercice de son pouvoir de direction, déplacer le salarié sur un autre site d’activité à l’intérieur du même secteur géographique que le lieu de travail initial (arrêt du 16 décembre 1998 ; arrêt du 4 mars 2020).
► La mention dans le contrat de travail du lieu d’exécution du travail n’a qu’une valeur informative, sauf si une clause claire et précise indique que le salarié exécutera son travail exclusivement sur ce lieu (arrêts du 3 juin 2003 n° 01-40.376 et 01-43.573 ; arrêt du 15 mars 2006).
Par exception, l’employeur peut imposer au salarié un déplacement occasionnel en dehors de son secteur géographique, à condition qu’il soit justifié par l’intérêt de l’entreprise, dans deux circonstances :
- soit lorsque ce déplacement est justifié par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié est informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l’affectation et de sa durée prévisible (arrêt du 3 février 2010) ;
- soit lorsque la spécificité des fonctions exercées par le salarié implique de sa part une certaine mobilité géographique (arrêt du 22 janvier 2003 ; arrêt du 23 octobre 2024).
La deuxième hypothèse concerne le salarié itinérant, rattaché au siège d’une entreprise ou à un établissement, mais dont les missions impliquent un certain nombre de déplacements, y compris en dehors de son secteur géographique d’activité.
La jurisprudence prend en compte les spécificités d’un tel emploi : les déplacements du salarié constituent un changement de ses conditions de travail, et non une modification de son contrat qu’il pourrait légitimement refuser.
► Le contrat de travail d’un salarié itinérant peut d’ailleurs stipuler que les déplacements de l’intéressé s’inscrivent dans le cadre habituel de son activité (arrêt du 29 janvier 2025).
Pas de déplacement pérenne de l’activité sans l’accord du salarié
La flexibilité du salarié itinérant n’autorise cependant pas l’employeur à modifier le périmètre habituel d’exercice de ses fonctions et à déplacer son activité dans une autre région. C’est ce principe que rappelle, ici, la Cour de cassation.
L’employeur soutenait que, compte tenu de la nature itinérante de l’emploi occupé par le salarié, le déplacement de son activité dans la région Grand-Est relevait de son pouvoir de direction. La Cour de cassation approuve le raisonnement de la cour d’appel, qui a considéré que le changement d’affectation proposé au salarié était pérenne, et non temporaire (ce qui aurait été possible en application de la jurisprudence précitée). Par conséquent, cette modification unilatérale du secteur géographique d’activité du salarié ne constituait pas un simple changement de ses conditions de travail, mais bien une modification de son contrat de travail.
L’employeur a donc manqué à ses obligations en imposant cette modification au salarié, ce qui justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts.
La Cour de cassation a déjà appliqué ce principe à un salarié, directeur régional exerçant son activité dans le secteur sud-ouest du territoire français, qui s’était vu imposer par l’employeur le déplacement de son activité dans le secteur sud-est (arrêt du 17 février 2021).
La rédaction sociale
Le bilan de compétences menacé d’être exclu du compte personnel de formation
15/07/2025

Les acteurs de la formation professionnelle dont la Fédération nationale des CIBC, Les Acteurs de la compétence, le Syndicat national des organismes de formation (Synofdes), s’inquiètent d’une possible suppression du financement des bilans de compétences par le compte personnel de formation (CPF) dans le cadre de la loi de finances 2026.
Une mobilisation inédite se dessine dans le secteur de la formation professionnelle. La semaine dernière, plusieurs organisations représentatives – la Fédération nationale des CIBC (centres institutionnels des bilans de compétences), Les Acteurs de la compétence, le Syndicat national des organismes de formation (Synofdes) et la Fédération française des professionnels de l’accompagnement et du bilan de compétences (FFPABC) – ont lancé un “cri d’alarme” face à la perspective d’une exclusion des bilans de compétences du dispositif du compte personnel de formation (CPF).
Cette mesure, qui pourrait être intégrée au projet de loi de finances 2026, s’inscrit dans la continuité des restrictions déjà appliquées. La loi de finances 2025 a en effet supprimé l’éligibilité au CPF des formations d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprise, désormais limitées aux seules certifications inscrites au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou au Répertoire spécifique (RS).
Un outil plébiscité par les actifs
Pourtant, les chiffres témoignent de l’importance du dispositif. Selon les données de la Dares de juillet 2024, les formations relatives au “développement des capacités d’orientation, d’insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles” – catégorie qui englobe les bilans de compétences – occupent la deuxième place des formations les plus suivies, après celles portant sur les transports et la manutention.
Plus précisément, 6,2 % de l’ensemble des formations réalisées en 2023 concernaient des bilans de compétences.
En 2024, ces derniers représentent 5,9 % des dossiers financés via le CPF et 7,4 % des fonds dépensés, selon les données rapportées par la fédération patronale Les Acteurs de la compétence. Un usage “ciblé” et “circonscrit” qui ne “cannibalise pas” les fonds du CPF, selon les organisations mobilisées.
La notoriété de cet outil confirme son ancrage : 92 % des actifs interrogés connaissent le bilan de compétences, d’après le sixième baromètre de l’emploi et de la formation 2024 du Centre Inffo, le plaçant en deuxième position après l’apprentissage et loin devant le conseil en évolution professionnelle (45 %).
Une “catastrophe” pour les petits centres de bilans de compétences
“C’est un cri d’alarme que nous lançons, le bilan de compétences est menacé”, a déclaré Garance Yverneau, secrétaire générale de la fédération patronale Les Acteurs de la compétence. Pour elle, cette éventuelle suppression constituerait “une catastrophe” pour les petits centres de bilans de compétences qui “ne pourraient pas se relever”.
L’argumentaire développé par les professionnels du secteur met l’accent sur les enjeux sociaux et économiques. “Se priver d’un outil aussi efficace serait dramatique pour les actifs [qui] ne pourraient pas se reconvertir, à l’heure du choc démographique, des mutations du marché de l’emploi liées aux transitions écologiques [et à] l’intelligence artificielle”, souligne Garance Yverneau, rappelant qu'”un actif sur deux envisage une reconversion professionnelle”.
Nathalie Déchelette, déléguée générale de la fédération nationale des CIBC, a rejoint cette analyse. Elle rappelle que ces centres, comptant 750 permanents répartis sur l’ensemble du territoire, “ont toute [leur] place” face à “un monde du travail en perpétuelle évolution”.
Un dispositif encadré depuis 1991
Institué par la loi du 31 décembre 1991 et réaffirmé par la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018, le bilan de compétences bénéficie d’un cadre réglementaire spécifique. Une instance de labellisation reconnue par l’Etat encadre cette activité, contrairement à d’autres formations du CPF.
Les organisations professionnelles plaident pour une “structuration durable du marché” plutôt que pour une restriction de l’accès. Elles pointent les effets de “la dérégulation du marché” consécutive à la mise en place du CPF, qui a entraîné “une hétérogénéité des pratiques et des prix” ainsi qu'”une hétérogénéité de la qualité des prestations”.
Selon une étude Harris interactive présentée hier par les organisations mobilisées, les bilans de compétences permettent aux bénéficiaires d’atteindre “complètement ou partiellement leurs objectifs initiaux”, avec une amélioration de leur situation professionnelle pour une majorité d’entre eux.
Les acteurs de la formation professionnelle redoutent désormais que cette mesure n’impacte particulièrement “les salariés les plus fragiles, les seniors, les personnes en longue maladie et les femmes” qui pourraient voir leurs évolutions professionnelles “totalement freinées”.
D’autres acteurs patronaux sont appelés à rejoindre cette mobilisation, à l’image du Medef, de la CPME, de l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (Udes) ou encore du Mouvement des entreprises de taille intermédiaire (Meti). Un courrier doit être adressé en ce sens, dès le début de la semaine prochaine, à la ministre du travail ainsi qu’au ministre de l’économie.
Anne Bariet
Suppression de jours fériés, gel des prestations sociales, arrêts maladie, contrats de travail : le plan à 43,8 milliards de François Bayrou
16/07/2025

François Bayrou le 15 juillet 2025
Mardi 15 juillet, François Bayrou a annoncé ses orientations budgétaires. 43,8 milliards seront piochés dans des suppressions de jours fériés, une nouvelle réforme de l’assurance chômage ou encore une “année blanche”, c’est-à-dire le gel pendant un an des prestations sociales.
Fin du suspense et du lancement des ballons d’essais testés dans la presse ces dernières semaines. Le Premier ministre a listé les économies envisagées pour le prochain budget. Devant plusieurs rangs de membres du gouvernement, la presse étant reléguée au fond de la salle et dans un silence quasi scolaire, François Bayrou est longuement revenu sur sa doctrine personnelle de réduction des dépenses publiques.
La dette, “cette malédiction”, “un piège” qui fait que le pays “ne peut pas survivre”, un endettement supplémentaire de “5 000 euros par seconde”, un “danger mortel” dont il veut se faire le protecteur. C’est pourquoi il a intitulé sa conférence de presse “Le moment de vérité”, ajoutant qu’il avait porté le sujet lors de plusieurs campagnes présidentielles et que le hasard lui donne aujourd’hui “la charge d’en saisir le pays”.
Sauveur de la France mais lucide, il sait que le risque politique de la censure plane tout de même au-dessus de son gouvernement : “Il n’y a que des risques pour le gouvernement : sans majorité à l’Assemblée nationale, et les soutiens du gouvernement ne sont pas toujours convaincus…? Tout concourt donc au fatalisme et à ce qu’on ne fasse rien, le gouvernement sait qu’il est à la merci des oppositions”. Et si ce plan est présenté deux mois avant la période traditionnelle, c’est “pour laisser plus de temps à la réflexion et aux idées”.
Est-ce pour cette raison que François Bayrou dit accueillir toute autre proposition, qu’elle émane des partis politiques, des parlementaires, des partenaires sociaux, du Conseil économique social et environnemental, qui pourraient survenir pendant l’été ? Il espère sans doute consolider le consensus autour de ses mesures qui risquent de secouer la rentrée sociale, à commencer par le gel des prestations et la suppression de deux jours fériés.
Adieu le lundi de Pâques et le 8 mai ?
François Bayrou vise un retour à l’équilibre et la fin de l’augmentation de la dette par un plan pluriannuel sur quatre ans, de 2026 à 2029. Le déficit de 5,4 % en 2025 devra se réduire à 4,6 % en 2026, puis 4,1 % en 2027, 3,4 % en 2028 et enfin 2,8 % en 2029.
Cette trajectoire est accompagnée de grands principes : la baisse de la dépense publique, une participation de tous à un effort supportable. “Le travail et les entreprises doivent être épargnés” a précisé le Premier ministre, tout en annonçant un peu plus tard des mesures visant directement les salariés.
Au premier chef, il propose de supprimer deux jours fériés : le lundi de Pâques et le 8 mai. L’idée est de “réconcilier le pays avec le travail”, sans toutefois que ce montant, lié à un surcroît de production, ne soit évoqué plus précisément que “plusieurs milliards”. Le Premier ministre se dit cependant ouvert à des propositions d’autres dates.
Emploi des jeunes et des seniors : une nouvelle réforme de l’assurance chômage
“Nous ne sommes pas assez nombreux à travailler, il faut augmenter la part de nos concitoyens qui travaillent”, a affirmé le Premier ministre.
Malgré deux accords très récents entre partenaires sociaux sur l’assurance chômage et les seniors (en novembre 2024) en cours de transposition dans la loi, François Bayrou veut remettre le couvert et relancer une négociation sur l’assurance chômage dans les prochains jours.
Syndicats et patronat ne vont donc pas tarder à recevoir une nouvelle lettre de cadrage. Il s’agira de modifier les conditions d’indemnisation de la rupture conventionnelle, accusée de remplacer à tort les démissions, de rendre les conditions d’affiliation “plus souples”, d’affiner les conditions d’indemnisation voire d’augmenter la dégressivité des allocations, autant dans leur montant que dans leur durée de versement. Des points qui rappellent le projet de réformé de Gabriel Attal avant la dissolution, et que l’ancien Premier ministre devenu député à la faveur de la dissolution a depuis transformé en proposition de loi…
Améliorer la qualité du travail : une autre négociation en vue
Le deuxième négociation envisagée par le gouvernement, qui pourrait faire l’objet d’une lettre de cadrage fin août, concerne un objectif de “fluidification du marché du travail”, l’idée semblant être d’étendre le champ de la négociation d’entreprise.
Le gouvernement veut “améliorer les conditions de travail, faciliter les recrutements, augmenter les offres de travail”. Ces orientations sont précisées par la ministre du travail, Astrid Panosyan-Bouvet : il s’agira d’aménager les contrats de travail à durée déterminée et indéterminée notamment des contrats intérimaires et de chantiers. Il sera question de réduire le délai permettant au salarié de contester son licenciement (Ndlr : une idée déjà envisagée par Bruno Le Maire et dont on voit mal comment elle peut en tant que telle remplir les caisses de l’Etat) hors cas de harcèlement et de discrimination, de permettre la hausse du temps de travail, de monétiser la cinquième semaine de congés payés, de freiner le nombre d’arrêts de travail.
La ministre souhaite qu’il soit possible d’aborder ces sujets par accord. Elle vise également “une amélioration de la qualité du travail” en luttant contre le temps partiel subi des femmes (un chantier déjà évoqué en 2023 lors de la conférence sociale d’Elisabeth Borne). Du côté de la lutte contre les accidents du travail graves et mortels, elle veut réintroduire un dialogue social “de proximité” mais n’ouvre à aucun moment la voie d’un retour du CHSCT. Elle compte en revanche, même si cela reste vague, “intégrer le principe d’écoute dans les politiques de prévention”.
Comme contreparties, la ministre en charge du travail évoque notamment un abaissement du seuil de représentation des salariés dans les conseils d’administration.
La “dérive” des arrêts maladie
Selon le Premier ministre, les contrôles sur les arrêts maladie de plus de 18 mois montrent que 50 % d’entre eux ne sont plus justifiés au moment du contrôle. Il ne précise cependant pas de mesure concrète pour y remédier mais dénonce “un autre blocage” : “Au-delà de 30 jours d’arrêt, la reprise du travail nécessite l’avis du médecin du travail. Mais comme nous en manquons, des gens qui souhaitent travailler de nouveau en sont empêchés”. C’est pourquoi l’avis sera basculé sur le médecin généraliste.
Côté santé, il souhaite également une réforme en profondeur du régime de prise en charge des affections de longue durée (ALD) dès 2026 en sortant du principe du remboursement à 100% des médicaments sans lien avec l’affection déclarée. Il demande également une plus grande efficacité à l’hôpital (en mutualisant les matériels et en permettant de transférer à un autre établissement un médicament proche de sa date de péremption), la mise en œuvre définitive du dossier médical partagé évitant aux patients de consulter plusieurs fois pour vérifier un diagnostic ou de multiplier le même examen. Il souhaite enfin développer la vaccination contre la grippe, relevant que les trois quarts des personnes en réanimation contre cette maladie ne sont pas vaccinés.
Catherine Vautrin a de son côté évoqué une évolution du complément de garde et du congé de naissance, une hausse des franchises sur les médicaments, “un suivi renforcé des arrêts maladie et une réévaluation des patients en arrêt”. On le voit, un chantier sur les arrêts maladie sera nécessairement ouvert dans le PLFSS 2026.
Une “année blanche” pour les prestations sociales
Piste déjà lancée dans la presse, l’année blanche se confirme. Ce gel des prestations sociales rapporterait 7,1 milliards d’euros. Le Premier ministre rappelle qu’il s’agit de ne pas modifier en 2026 les montants perçus en 2025. Autrement dit, les prestations ne seront pas indexées comme chaque année. Toutes les prestations seraient concernées. “L’inflation aidera” précise François Bayrou pour alléger la blessure infligée aux plus fragiles puisqu’elle ne s’établirait qu’autour de 1 %. Pour mémoire, les syndicats y sont farouchement opposés, en particulier sur les retraites (lire notre article sur le financement des retraites dans cette édition).
Les barèmes de l’impôt sur le revenu et de la CSG ne seront ne revanche pas modifiés par rapport à 2025. Cependant, le gouvernement compte partir à la chasse de certaines niches sociales, en particulier celles qui bénéficient aux plus favorisés. L’abattement de 10% pour frais professionnels des retraités sera supprimé et remplacé pour les plus fragiles par un forfait annuel avantageant les petites retraites.
Autre mesure de justice, une contribution de solidarité définie lors du vote du budget visera les plus hauts revenus, et sera accompagnée de mesures complémentaires pour lutte contre l’optimisation abusive des “patrimoines non productifs”. Par ailleurs, une “allocation sociale unifiée” sera créée pour rendre “la solidarité plus lisible”. Rappelons également, sur les retraites, que le PLFSS (projet de financement de la sécurité sociale) 2026 reprendra les mesures issues du conclave sur les retraites des femmes, la pénibilité et l’abaissement à 66,5 ans de l’âge d’annulation de la surcote.
S’il n’est pas question pour l’instant de TVA sociale, le Premier ministre voit ces chantiers comme “un basculement d’assiette” consistant à chercher des sources de financement de la protection sociale ailleurs que dans le travail. Il n’annonce pourtant pour l’instant aucun transfert de financements par des cotisations sociales vers de l’impôt.
Toujours afin de faire passer l’addition, François Bayrou accompagne cette mesure d’un plan de lutte contre la fraude fiscale et sociale : un projet de loi sera déposé à l’automne et visera la détection, la sanction et le recouvrement des sommes fraudées. Un point qui doit particulièrement être travaillé : les organismes comme l’Urssaf sont aujourd’hui dépourvus de moyens juridiques de saisir les sommes sur les comptes en banque ou dans les patrimoines des fraudeurs. C’est pourquoi, sur les 16,6 milliards de détections de fraudes annoncées en 2024, seulement 11 milliards sont effectivement récupérés par les caisses. Il est donc souhaitable que le projet de loi inclue des mesures sur ce point.
L’année blanche concernera aussi les budgets des ministères, tous visés par l’austérité. Il sera également question de ne pas remplacer les départs un fonctionnaire sur trois partant en retraite et de réduire les emplois publics de 3 000 postes.
Simplification et travail sur les filières pour améliorer la production
Le chantier de la simplification revient ! François Bayrou saisit le sujet pour faire passer aux entreprises un travail sur les aides publiques. Il s’agira d’échanger une subvention contre plus de liberté. Une entreprise pourrait donc perdre une aide publique en échange d’une simplification administrative. François Bayrou entend ainsi tirer les leçons du rapport de la commission sénatoriale sur les aides publiques aux entreprises qui a chiffré à 211 milliards ces aides versées aux structures employant au moins 1 000 salariés.
Toutes les tailles d’entreprises seront concernées dans ce “donnant-donnant” que le Premier ministre ne comptabilise pas encore mais qu’il évalue à plusieurs milliards. Il sera aussi question d’améliorer l’accès des entreprises au financement, notamment européens. 900 millions d’euros y seront consacrés. Autre chantier en faveur des entreprises : les délais de paiement feront l’objet d’une sanction à hauteur de 1% du chiffre d’affaires.
Précision de taille : ce chantier sera mené par ordonnances et non par projet de loi. Lancé dès l’automne, il se poursuivra tout au long de l’année 2026. Pour mémoire, la CPME avait lancé une proposition de 80 mesures de simplification à l’issue du rapport parlementaire “Rendre des heures aux Français” dont certaines visaient par exemple le monopole syndical au premier tour des élections professionnelles et des changements de seuils sur les CSE.
Enfin, l’Etat peut davantage travailler sur l’ensemble des filières plutôt que sur des dossiers isolés d’entreprises en difficulté. Dans une stratégie globale de redressement du commerce extérieur, il passera en revue les filières déficitaires afin de repérer les productions les plus propices à une installation en France plutôt qu’à l’étranger. Par ailleurs, les fonds de France 2030 seront davantage affectés à l’intelligence artificielle et à la cybersécurité. Et afin de remédier aux défauts de recrutements d’ingénieurs, François Bayrou soutient le plan “Filles et mathématiques” destinée à orienter plus de femmes dans les emplois scientifiques et déployé par la ministre de l’éducation Elisabeth Borne.
Toujours dans l’optique de favoriser la production, le ministre de l’économie et des finances Éric Lombard a annoncé des réductions de coût de l’énergie au bénéfice des entreprises de la chimie (avec des contrats d’approvisionnement de 30 Terawatts/heure d’ici la fin de l’année) et un soutien de crédit d’impôt recherche au profit de l’industrie lourde, et notamment des entreprises de l’acier. La sidérurgie fera l’objet de “mesures de sauvegarde renforcée”, effet sans doute du plan de sauvegarde de l’emploi d’ArcelorMittal. Pour l’automobile, il compte encourager le made in Europe et “muscler l’arsenal de défense commerciale contre la concurrence chinoise”. Enfin, pour favoriser les achats en France sur des circuits courts, une taxe sur les petits colis sera créée afin de protéger le commerce français “de la marée de concurrence déloyale”.
Nouvelles négociations interprofessionnelles, conférence sociale, préparation du budget, la rentrée s’annonce déjà très chargée sur le plan social… Il reste à voir comment les syndicats vont tenter d’influer ces mesures et s’ils souhaitent mobiliser les salariés pour protéger certains acquis.
| Une “année noire pour le monde du travail”, “davantage de flexibilité” : les premières réactions syndicales |
| Pour la CGT, François Bayrou a ouvert “un chantier aussi brutal qu’idéologique. Ce n’est pas un plan d’économies, c’est une déclaration de guerre aux droits des travailleuses et des travailleurs”. Pour la confédération de Montreuil, deuxième syndicat français, il s’agit “d’une cure d’austérité sans précédent pour le monde du travail” et d’une “fuite en avant austéritaire”. Elle compte bien appeler à la mobilisation et considère que pour l’instant, “rien n’est joué”. À Force Ouvrière, on voit aussi “moins de fonctionnaires et de service public” ainsi que des mesures non justifiées : “En 2023, 2024 et 2025, les retraites ne contribuent pas au déficit de la France. Les régimes sont équilibrés. (…) Sur l’assurance chômage, toutes les études de l’Unédic démontrent que la baisse de l’indemnisation n’a aucun effet sur le retour à l’emploi”. On conteste en revanche que pour les entreprises, aucun chiffre d’économies ne soit fourni. Le communiqué se termine ainsi : “Nous solliciterons les autres organisations syndicales pour une riposte à la hauteur des attaques”. Tout en se disant consciente de “la gravité de la situation budgétaire”, la CFDT critique l’inéquité du plan Bayrou : “Les annonces (..) prévoient des efforts significatifs et très concrets pour les salariés et agents de la fonction publique. Mais des mesures très floues et imprécises pour les plus hauts revenus et les entreprises”. Le syndicat se dit opposé à une “année blanche”, au non remplacement d’un fonctionnaire sur trois, à la suppression de deux jours fériés ainsi qu’à une nouveau durcissement de l’assurance chômage. “La perspective d’une nouvelle réforme du code du travail avec pour principal objectif de “lever les obstacles” sur le marché du travail signifie déréglementer et accentuer la flexibilité”, estime la CFDT qui dénonce “une impasse”. La confédération entend inviter début septembre les autres organisations syndicales et patronales “pour débattre des réelles priorités du monde du travail”. L’UNSA dénonce une vision “injuste et déséquilibrée” : “Les travaux de l’OFCE (Observatoire Français des Conjonctures Économiques) montrent clairement que les politiques budgétaires récentes ont davantage bénéficié aux 10 % les plus riches qu’aux classes moyennes et populaires. La baisse des impôts sur le capital et la réduction des prélèvements obligatoires pour les grandes entreprises ont accentué les inégalités sans stimuler l’investissement productif à la hauteur des promesses”. La CPME salue au contraire “la fin de l’aveuglement budgétaire”. L’organisation patronale “se félicite des mesures courageuses annoncées au travers des orientations budgétaires dévoilées par le Premier ministre, François Bayrou. Beaucoup d’entre elles rejoignent les préconisations de la CPME qui s’inscrit dans cette volonté de casser enfin la spirale infernale de l’augmentation des dépenses publiques. Ces annonces méritent d’être saluées même s’il faut, bien entendu, attendre de savoir ce qu’il adviendra de ce projet après examen par le Parlement”. La CPME salue également la volonté de simplification du gouvernement. |
Marie-Aude Grimont
Mayotte : prolongation des allocations chômage et de l’activité partielle
16/07/2025
Paru ce week-end au Journal officiel, un décret prolonge, jusqu’au 30 septembre 2025, pour les demandeurs d’emploi résidant à Mayotte et ayant épuisé leurs droits, le bénéfice de :
- l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ;
- l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
- l’allocation des travailleurs indépendants (ATI).
Sont aussi reconduits la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d’affiliation à l’assurance chômage et le délai à compter de la fin d’un contrat de travail et avant l’expiration duquel doit intervenir l’inscription comme demandeur d’emploi ou le dépôt de la demande d’allocation.
Le texte réglementaire prolonge également jusqu’au 30 septembre 2025 la durée d’application de la majoration temporaire des taux horaires de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle pour les établissements situés à Mayotte.
Source : actuel CSE
Les partenaires sociaux défendent Action Logement auprès de François Bayrou
16/07/2025
Groupe paritaire chargé de construire, réhabiliter et financer des logements sociaux et intermédiaires tout en favorisant l’accès au logement des salariés, Action Logement se trouve-t-il aujourd’hui menacé de passer dans la main de l’État ? Anciennement appelé “1 % logement”, ou “1% patronal”, l’organisme et les partenaires sociaux qui le gèrent craignent une mainmise des pouvoirs publics sur ses ressources depuis que l’Insee l’a classé en “administration publique”. Un projet d’arrêté serait en cours de rédaction.
Syndicats et patronat (Medef, CPME, CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC) ont adressé (voir ci-dessous) un courrier à François Bayrou la semaine dernière afin de prendre la défense du premier bailleur social européen, deuxième financeur du logement social en France. Selon cette lettre, “les partenaires sociaux du groupe demandent aujourd’hui de retirer tout projet d’arrêté qui conduirait à freiner les missions d’Action Logement, toujours au rendez-vous de ses engagements depuis 70 ans”. Ils réclament “de la stabilité et de la visibilité à long terme” afin de préserver “un modèle qui a fait ses preuves”.
À l’heure où le Premier ministre recherche 40 milliards d’économies, rappelons que les finances d’Action Logement ont déjà fait l’objet de ponctions par le gouvernement (500 millions d’euros en 2020, 1 milliard d’euros en 2021, 300 millions d’euros en 2023). Son budget (1,9 milliard d’euros pour l’année 2024) attire donc les convoitises.
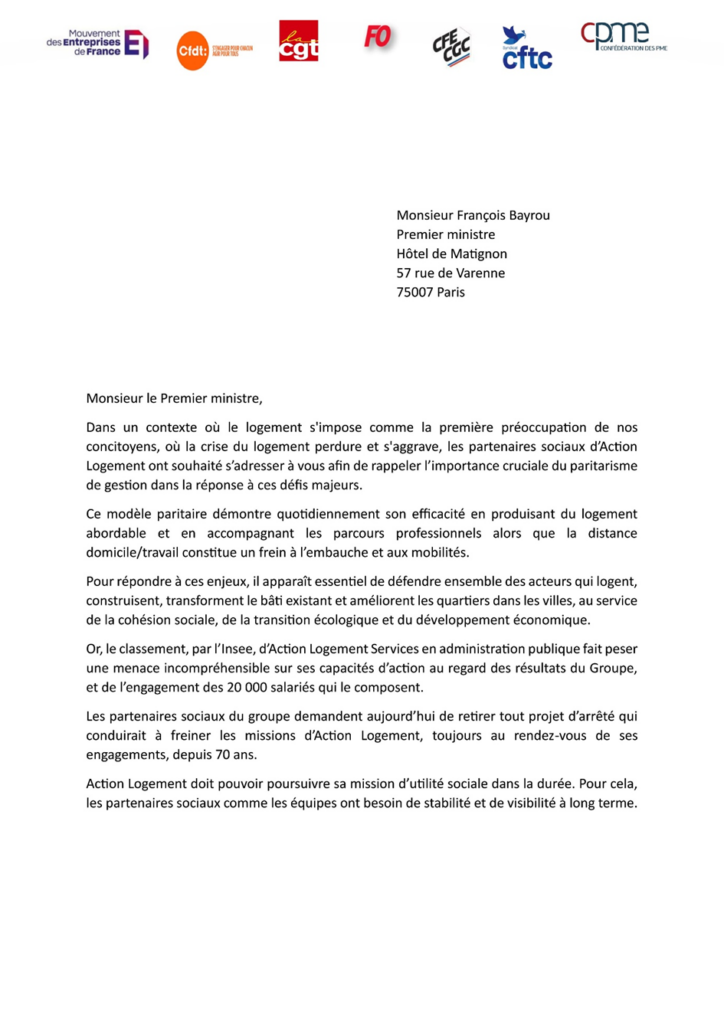

Source : actuel CSE
Les pourboires volontaires centralisés et répartis par l’employeur sont soumis à cotisations sociales
17/07/2025

Les sommes laissées par les clients à titre de pourboires en faveur du personnel en contact avec la clientèle constituent une rémunération soumise à cotisations sociales lorsqu’elles sont remises à l’employeur pour qu’il les reverse aux salariés concernés.
Par un arrêt du 5 juin 2025 destiné à être publié au Bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que les pourboires volontaires, collectés par l’employeur dans le but d’être reversés au personnel, constituent une rémunération devant être soumise à cotisations sociales.
► Rappelons que depuis le 1er janvier 2022, un dispositif d’exonération temporaire des pourboires s’applique. Il a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2025 par la loi de finances pour 2025. Les pourboires remis volontairement aux salariés en contact avec la clientèle dont la rémunération ne dépasse pas 1,6 Smic sont exonérés de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu. La solution rendue par la Cour de cassation ne s’applique donc pas dans ce cas.
Redressement d’une société pour des pourboires volontaires collectés par l’employeur
À l’issue d’un contrôle Urssaf, une société fait l’objet d’un redressement, portant sur des pourboires volontaires non soumis à cotisations et contributions sociales. Ces pourboires payés par carte bancaire étaient collectés par l’employeur et enregistrés sur un compte d’attente de transit, avant d’être reversés aux salariés pour la part de pourboires leur revenant. La société se pourvoit en cassation pour contester ce redressement.
Elle estimait que leur nature juridique était différente des pourboires dus au titre du service et inclus dans la facturation de la prestation et qu’ils ne constituaient pas un complément de rémunération devant être pris en compte pour déterminer la base de calcul des cotisations. La société soulignait qu’elle avait offert ici une simple commodité aux clients souhaitant payer ces pourboires par carte bancaire, tandis que d’autres clients les versaient directement en espèces.
Les pourboires collectés par l’employeur ne constituent pas une libéralité mais une rémunération soumise à cotisations
La Cour de cassation confirme le redressement des sommes litigieuses et rejette le pourvoi. En se référant aux articles L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, et L.3244-1 du code du travail, elle précise que : “les sommes volontairement remises à titre de pourboires par les clients à destination du personnel en contact avec la clientèle sont soumises à cotisations sociales dès lors qu’elles sont remises à l’employeur pour qu’il les reverse au personnel”.
Ainsi, dès lors qu’il centralise les pourboires pour les reverser ensuite au personnel, ces sommes volontaires qui ont été remises à la société par des tiers à l’occasion du travail de ses salariés, ne constituent pas une libéralité mais une rémunération entrant dans l’assiette des cotisations. Tel est le cas, comme en l’espèce, lorsque :
- un client majore le montant de sa facture en réglant par carte bancaire lorsqu’il ne dispose pas d’espèces ;
- les pourboires ainsi laissés sont collectés et enregistrés sur un compte d’attente de transit avant d’être reversés aux salariés pour la part de pourboire leur revenant.
Jean-David Favre et Eléonore Barriot
Une proposition de loi facilite la conciliation entre un mandat local et une activité professionnelle
17/07/2025
Une proposition de loi visant à encourager, à faciliter et à sécuriser l’exercice du mandat d’élu local a été adoptée le 10 juillet 2025 par l’Assemblée nationale. Elle avait été adoptée en première lecture par le Sénat le 23 juillet 2024.
Le texte prévoit notamment des dispositions visant à faciliter la conciliation du mandat avec l’exercice d’une activité professionnelle.
Le congé accordé à un candidat à une élection locale passerait ainsi de 10 à 15 jours.
Le candidat serait par ailleurs mieux protégé. Le texte transpose ainsi dans le code du travail deux garanties déjà prévues par le code général des collectivités territoriales. La garantie de l’assimilation des autorisations d’absence et des crédits d’heures à du temps de travail effectif pour le calcul des droits aux prestations sociales, et l’interdiction de modifier, sans l’accord de l’élu, la durée ou les horaires de travail initialement prévus au contrat, en raison de ses absences liées à l’exercice de son mandat.
Selon l’exposé des motifs de cet amendement, “ces dispositions ne font pas doublon : leur absence du code du travail nuit à leur lisibilité et à leur application, notamment par des employeurs souvent peu familiers du droit”.
La proposition de loi enrichit l’entretien dont bénéficie l’élu. L’article L.6315-2 du code du travail prévoit qu’au début de son mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental ou de conseiller régional le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. La proposition de loi prévoit que cet entretien puisse avoir lieu ensuite au maximum une fois par année civil
Cet entretien pourrait permettre de prendre en compte de l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice du mandat, par ce salarié.
Le Sénat doit désormais examiner la proposition de loi en seconde lecture.
Source : actuel CSE
Le gouvernement lance de nouvelles actions en faveur de l’emploi des jeunes
18/07/2025

La ministre du travail, Astrid Panosyan-Bouvet, la ministre de l’éducation nationale, Elisabeth Borne, et la ministre des sports, Marie Barsacq, ont présenté le 16 juillet, devant le Conseil national pour l’emploi, la nouvelle stratégie gouvernementale en faveur de l’emploi des jeunes.
Les plans pour l’emploi des jeunes se succèdent. Après l’initiative “1 jeune, 1 solution” , le gouvernement s’apprête à lancer de nouvelles mesures pour faire face au sous-emploi des jeunes. Présenté le mercredi 16 juillet au Conseil national pour l’emploi (CNE) par les ministres du travail, de l’éducation nationale et des sports, ce plan prévoit de nouvelles mesures pour améliorer l’insertion professionnelle des jeunes autour de trois grands axes stratégiques “qui ne sont pas nouveaux”, a reconnu la ministre du travail lors d’un point presse à l’issue de cette réunion. “Mais il y a sans doute des marges de manœuvre et de progrès sur l’exécution de ces axes et la capacité de tous les acteurs à travailler ensemble”, a-t-elle souligné.
Les trois axes sont les suivants :
- mieux orienter, mieux former, mieux informer les jeunes sur les métiers qui recrutent “et qui offrent des perspectives notamment dans les filières scientifiques, techniques, technologiques avec une vigilance sur le sujet de la féminisation de ces métiers”, a insisté Astrid Panosyan-Bouvet ;
- renforcer les liens entre les jeunes et l’entreprise tout au long de leur parcours “en structurant mieux les contacts avec le monde professionnel : de l’apprentissage jusqu’au contrat engagement jeune” ;
- prévenir les ruptures de parcours, accompagner les jeunes fragiles, promouvoir des parcours intensifs d’insertion.
11 nouvelles pistes déployées
Concrètement, le ministère du travail a présenté au Conseil national pour l’emploi 11 nouvelles mesures :
- enrichir les données d’Inserjeunes et d’Insersup pour mieux informer sur les débouchés et les réussites des parcours, via les plateformes avenir(s) et “1 jeune 1 solution”. Il s’agit d’améliorer la coordination entre les différentes plateformes ;
- mobiliser davantage les entreprises dans les parcours de découverte des métiers dès le collège, avec une attention à la féminisation des filières scientifiques ;
- proposer à tous les lycéens professionnels en dernière année des ateliers collectifs et des entretiens individuels avec France Travail et les missions locales (dispositif Avenir Pro) ;
- développer 50 000 places en deux ans de formation de spécialisation d’un an en alternance sur les premiers niveaux de qualification, en lien avec les branches professionnelles ;
- systématiser une expérience en entreprise dans les deux premiers mois du contrat d’engagement jeune (CEJ) et construire des parcours adaptés aux besoins des filières. ;
- construire et déployer une formation de référence pour les conseillers du réseau pour l’emploi afin de les former à la stratégie de mobilisation des entreprises ;
- mobiliser les “task force entreprise” pour engager les employeurs en faveur de l’emploi des jeunes (recrutements, stages, mentorat, etc.) ;
- assouplir les conditions d’exercice d’une activité professionnelle de courte durée ou à temps partiel pour les étudiants, afin de favoriser le travail étudiant compatible avec les études ;
- piloter l’obligation de formation des 16-18 ans dans une logique de résultats et clarifier les responsabilités des acteurs impliqués ;
- développer et mobiliser les solutions de parcours intensifs pour les jeunes les plus éloignés de l’emploi (Epide, E2C, service civique, écoles de production, etc.) ;
- renforcer le pilotage du mentorat et l’orienter vers les publics prioritaires, pour soutenir les transitions vers l’emploi ou les études.
Répondre aux facteurs de sous-emploi des jeunes
Ce nouveau plan à destination des jeunes vise à répondre à ce constat récurrent : une insertion professionnelle des jeunes qui reste difficile tous niveaux de qualification confondus. “Un jeune sur trois connaît une trajectoire marquée par le chômage ou l’inactivité après ses études et le chômage des jeunes approche les 20 %. Près de 1,4 million de jeunes âgés de 15 à 29 ans ne sont aujourd’hui ni en études, ni en emploi, ni en formation (les “NEETs”)”, indique le ministère du travail.
Selon le gouvernement, plusieurs paramètres expliquent ce sous-emploi : une connaissance insuffisante des métiers et du niveau d’insertion à l’issue des formations suivies, une survalorisation du diplôme et de la formation initiale théorique longue, plutôt que de l’expérience et de la formation pratique ou continue, un éloignement encore trop grand des formations et politiques publiques d’accompagnement des besoins de l’entreprise et du monde du travail en général. Enfin, un manque de synchronisation entre les différentes politiques publiques et les parties prenantes qui agissent en faveur de l’emploi des jeunes.
Autant d’obstacles que le gouvernement entend lever avec cette nouvelle stratégie “qui sera déployée avec les acteurs de terrain – régions, branches, missions locales, entreprises, collectivités, associations, au plus près des besoins locaux”.
Florence Mehrez
Insertion dans l’emploi des étrangers : une circulaire propose un nouveau cadre d’action
18/07/2025

Une circulaire des ministres de l’intérieur et du travail du 26 juin 2025 propose un cadre d’action afin de “favoriser l’insertion dans l’emploi des étrangers primo-arrivants”, notamment dans les métiers en tension.
“Le gouvernement a fait de la maîtrise des flux migratoires une priorité”, souligne d’emblée la circulaire conjointe des ministres de l’intérieur et du travail, envoyée le 26 juin 2025 aux préfets de région et aux directeurs généraux de France Travail et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii). Ce contexte rappelé, les ministres précisent ensuite que l’objectif de la circulaire est de “répondre aux besoins en recrutement des entreprises” et que, pour ce faire, “il est essentiel de former davantage les étrangers en situation régulière déjà présents en France, notamment ceux qui sont arrivés récemment, et de renforcer leur accès à l’emploi, particulièrement aux métiers en tension” et ce “avant de favoriser l’introduction d’une main-d’œuvre étrangère et les régularisations d’étrangers en situation irrégulière”.
► Lors d’une conférence de presse du 10 avril 2025, le ministre de l’intérieur avait opéré une claire distinction entre les étrangers en situation régulière au chômage et ceux qui, en situation irrégulière, sont employés dans un métier en tension et pourraient être régularisés par le travail (dans les conditions rappelées par une circulaire du 23 janvier 2025, qui insistait sur le caractère exceptionnel de la procédure). “Nous faisons un choix en termes de hiérarchie, de priorisation” avait notamment affirmé le ministre assumant préférer consacrer ses « efforts » aux étrangers en situation régulière et au chômage, pour les former aux métiers en tension” (ministère de l’intérieur, dossier de presse, 10 avril 2025).
La circulaire, qui s’inscrit dans le cadre des lois du 18 décembre 2023 pour le plein-emploi et “immigration” du 26 janvier 2024 détaille un certain nombre de mesures afin de mieux intégrer les primo-arrivants et de faire des entreprises des “éléments moteurs de l’intégration des étrangers”. On retiendra notamment les axes suivants.
► L’annexe à la circulaire répertorie un certain nombre de “bonnes pratiques territoriales” ayant inspiré ce cadre d’action.
Mise en place de l’automaticité de l’inscription à France Travail
L’inscription à France Travail des signataires du contrat d’intégration républicaine (CIR) en recherche d’emploi sera automatique “courant 2026”, indiquent les ministres.
D’ici là, ils invitent les préfets, France Travail et l’Ofii à veiller “à ce que le premier entretien du CIR permette effectivement à l’Ofii d’accompagner ces personnes dans leur inscription auprès de l’opérateur France Travail, et à ce que soient mis en place dans ce cadre des échanges d’informations suffisants entre l’Ofii et France Travail”, notamment sur le niveau de langue, les qualifications, le parcours professionnel.
► À propos de l’objectif d’une inscription automatique à France Travail, la circulaire du 30 avril 2025 indiquait que “grâce aux travaux d’interconnexion des données entre l’Ofii et France Travail, l’objectif programmé est l’inscription automatique de tous les étrangers signataires de CIR déclarant souhaiter travailler dès 1er janvier 2026” (instruction du 30 avril 2025).
La circulaire souhaite aussi que les actions de repérage, de sensibilisation et d’information sur le Réseau pour l’emploi (RPE) mises en œuvre par les acteurs associatifs, les services de l’État et les opérateurs concernés soient déployées au bénéfice des étrangers en situation régulière sur l’ensemble des territoires.
En outre, afin de “faciliter la reconnaissance des compétences professionnelles attendues par les employeurs”, les procédures d’équivalence de diplômes et de validation des acquis de l’expérience doivent être favorisées.
Volonté d’adapter les formations aux besoins des entreprises
La circulaire rappelle également qu’à compter du 1er janvier 2026, en application de la loi “immigration” du 26 janvier 2024, le niveau de langue requis (écrit et oral) sera rehaussé au niveau A2 pour les cartes de séjour pluriannuelles et B1 pour les cartes de résident.
Elle appelle en conséquence à mobiliser “l’ensemble de l’offre déployée par France Travail et les autres acteurs du RPE afin de construire des parcours d’intégration” qui “doivent être adaptés aux caractéristiques des étrangers – en y intégrant de la formation linguistique – et aux compétences professionnelles requises pour les secteurs et métiers visés”.
Autre priorité : dès la signature du CIR, l’articulation entre l’apprentissage de la langue et le retour à l’emploi des étrangers primo arrivants doit être renforcé.
Ainsi, pour le signataire du CIR “proche du niveau A2 ou recherchant un emploi dans un secteur en tension”, il convient de prévoir “une prise en charge par France Travail et un accès direct aux formations mises à disposition par les financeurs”.
Consécration des entreprises comme “éléments moteurs de l’intégration des étrangers”
La circulaire rappelle enfin le dispositif de formation linguistique destiné aux étrangers allophones signataires d’un CIR, prévu par l’article 23 de la loi du 26 janvier 2024 (entré en vigueur depuis le 1er janvier 2025), qui doit notamment leur permettre de suivre des formations linguistiques de l’Ofii sur leur temps de travail, ou de s’absenter pour suivre une formation dans le cadre de leur compte personnel de formation.
Pour les ministres signataires, la visibilité de ce dispositif doit être assurée “auprès des employeurs et des étrangers en vous appuyant notamment sur France Travail, l’Ofii et les associations partenaires de la politique d’immigration et d’intégration”.
On relèvera encore que les ministres considèrent que “compte tenu des difficultés particulières d’accès à l’emploi auxquelles les étrangers sont confrontés dès leur arrivée”, ce public “s’inscrit pleinement dans les priorités d’intervention de [la loi pour le plein-emploi], visant à proposer un accompagnement plus intensif aux personnes éloignées de l’emploi”.
Véronique Baudet-Caille
[Veille JO] Les textes parus cette semaine : inflation, légion d’honneur, libertés, protection sociale
18/07/2025
Voici un récapitulatif des textes parus au Journal officiel (JO) du vendredi 11 juillet au jeudi 17 juillet inclus, avec les liens renvoyant aux articles que nous avons pu faire sur ces sujets.
► Nous ne traitons pas ici les textes liés aux conventions collectives, car nous vous proposons tous les mois un baromètre des branches sur ces nouveautés.
Immigration et intégration
- Un décret du 15 juillet 2025 (n° 647) précise les modalités de la formation civique et linguistique destinée aux étrangers qui souhaitent s’installer durablement en France et sollicitent une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident
- Un autre décret du 15 juillet 2025 (n° 648) rehausse le niveau de langue exigé pour des personnes souhaitant acquérir la nationalité française par naturalisation, par réintégration ou par déclaration de nationalité à raison de leur mariage avec un conjoint français. Le texte introduit également un examen civique permettant de vérifier le niveau de connaissances en matière d’histoire, de la culture et de la société françaises.
Légion d’honneur
- Dans le Journal officiel du 13 juillet 2025, font partie des promus de la Légion d’honneur, au grade de chevalier, Bernard Thibault, ancien secrétaire général de la CGT, et Joël Mottier, président d’honneur de la fédération CFE-CGC de l’assurance
Libertés
- Est paru au JO du 17 juillet 2025 un avis sur “la restriction de l’espace civique, un enjeu majeur pour la démocratie et les droits humains” de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH)
Nominations
- Un décret du 11 juillet 2025 porte renouvellement dans les fonctions de directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie, directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (Thomas Fatome)
Protection sociale
- Un décret du 10 juillet 2025 porte prolongation de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et l’allocation des travailleurs indépendants (ATI) et de la majoration des taux horaires de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle à Mayotte
- Un arrêté du 8 juillet 2025 porte approbation des modifications apportées aux statuts du régime d’assurance vieillesse complémentaire et du régime d’assurance invalidité-décès de la section professionnelle des agents généraux d’assurance (CAVAMAC)
Rôle économique du CSE
- Avis du ministère de l’économie et des finances relatif à l’indice des prix à la consommation
- Est parue au JO du 16 juillet 2025 la loi n° 2025-640 du 15 juillet 2025 portant création de l’établissement public du commerce et de l’industrie de la collectivité de Corse
Source : actuel CSE
La CNCDH sonne l’alerte sur la répression et les discriminations syndicales
18/07/2025
Dans un avis publié au Journal Officiel du 17 juillet 2025, la Commission consultative des droits de l’homme (CNCDH) alerte sur la restriction de l’espace civique et l’enjeu que cela représente pour la démocratie, notamment en ce qui concerne les libertés syndicales. Elle précise que la France, bien que forte d’un tissu syndical riche et actif, n’échappe pas au climat délétère qui se profile dans de nombreux pays démocratiques vis-à-vis de la restriction croissante des droits et libertés fondamentales.
La CNCDH pointe notamment du doigt :
- les pressions exercées par plusieurs groupes d’intérêts sur les revendications syndicales et professionnelles ;
- les actes d’intimidation et de violence exercés par des groupes issus de mouvances identitaires ciblant notamment les syndicalistes ;
- le risque de “procédures-bâillon”, c’est-à-dire de l’utilisation des voies de droit dans un but d’intimidation (généralement diffamation, dénigrement, violation du secret des affaires, et dans les cas les plus extrêmes, apologie du terrorisme), visant entre autres les syndicalistes ;
- la surveillance accrue des acteurs syndicaux par de nouvelles règles administratives, des stratégies de maintien de l’ordre, et une judiciarisation croissante des mobilisations portant atteinte à la liberté de manifestation ;
- la pratique du fichage des militants syndicaux autorisée par plusieurs décrets et la collecte de données personnelles concernant des participants à des manifestations aux moyens d’outils numériques ;
- les interdictions de manifester en prétextant des risques de trouble à l’ordre public, souvent non avérés.
La CNCDH rappelle qu’une personne syndiquée sur deux déclare avoir été discriminée en raison de son activité syndicale au cours de sa vie professionnelle : sanctions disciplinaires, licenciements illégaux. Les syndicalistes, déplorent la commission, font également face à une répression des mouvements de grève, accentuée depuis les mobilisations contre la réforme des retraites. Ces atteintes constituent un facteur dissuasif à l’engagement syndical, qui est désormais perçu par les salariés comme un risque, rapporte la CNCDH.
Source : actuel CSE


