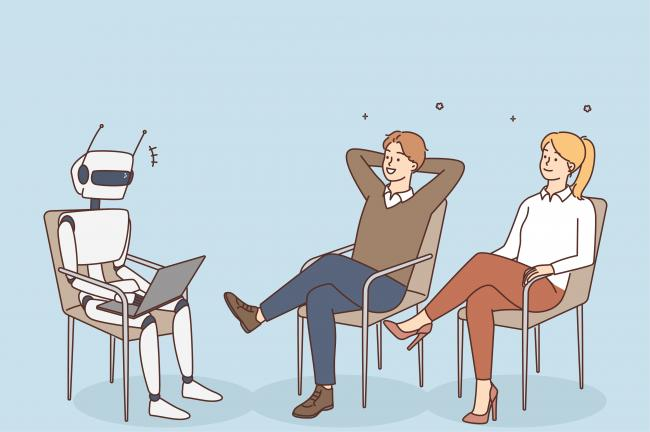Un rapport préconise de rendre incontournable la consultation du CSE sur un projet IA
06/10/2025
Un rapport parlementaire préconise de modifier le code du travail pour rendre incontournable par l’employeur la consultation du CSE en cas de projet d’outils d’intelligence artificielle (IA). Les députés suggèrent aussi la conclusion d’un accord national interprofessionnel au sujet du dialogue social sur ces nouvelles technologies.
Un nouveau rapport, parlementaire cette fois, se penche sur l’intelligence artificielle au travail (*). Ses auteurs, les députés Emmanuelle Hoffin (Ensemble pour la République) et Antoine Golliot (Rassemblement national), qui appartiennent à la commission des affaires économiques de l’Assemblée, abordent de nombreux aspects parmi lesquels le dialogue social autour de ces nouvelles technologies.
Certes, explique le rapport, le droit outille, en théorie, les représentants du personnel pour s’emparer du sujet de l’introduction dans une entreprise d’outils d’intelligence artificielle, dont les effets sur les risques professionnels doivent être inclus dans le document unique d’évaluation des risques professionnels, le Duerp.
Les points d’appui dans le code du travail
Le rapport cite ces points précis :
- le CSE doit être informé et consulté sur l’introduction de nouvelles technologies (art. L.2312-8 du code du travail), l’instance pouvant recourir à un expert habilité (art. L. 2315-94). ;
- le comité doit être informé préalablement à la mise en place de moyens de contrôle de l’activité des salariés, de méthodes ou techniques d’aide au recrutement des candidats à un emploi (art. L. 2312-37 et L. 2312-38) ;
- la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) peut aborder les changements induits par les usages de l’IA (art. L. 2242-20). Cette négociation peut aborder la question des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques (art. L. 2242-2).
A ces dispositions s’ajoutent des modes de consultation propres à certaines entreprises comme des “groupes de travail IA”, “comité IA” ou autre “commission mixte de gouvernance du numérique”. Ajoutons que de rares entreprises ont noué de véritables échanges sur le sujet via des commissions numériques du CSE, comme par exemple Covea, ou via un accord comme Axa.
Des dispositifs qui restent théoriques
Malgré ces éléments de droit prévus par le code, dans les faits, “rien n’assure (..) que le fonctionnement des entreprises garantisse l’exercice, par les salariés, d’un droit collectif à l’information et à la consultation sur les modalités et les effets d’un développement des usages de la technologie”.
Cette incertitude, poursuit le rapport, pose avant tout le problème “du caractère opérant des procédures de saisine des instances représentatives du personnel et du champ de la négociation collective”. C’est d’ailleurs bien la raison des contentieux qui se développent, certains CSE, comme celui de France Télévisions, obtenant la condamnation de leur employeur pour absence de consultation de l’instance.
Les parlementaires déplorent dans la foulée “l’absence de dynamique dans le champ des négociations collectives”, l’absence d’un véritable dialogue social portant sur l’impact de l’IA sur l’activité de production. “Il n’existe aucun accord de branche quant à l’usage de l’IA et le nombre d’accords d’entreprise demeure insignifiant”, peut-on lire dans le rapport (Ndlr : nous vous avons signalé récemment l’un de ces rares accords d’entreprise portant sur la consultation du CSE sur l’IA).
Le développement des technologies IA “ne figure parmi les thèmes abordés par les partenaires sociaux que de manière sectorielle et extrêmement marginale”, constatent les auteurs.
Un accord national interprofessionnel jugé nécessaire
Comme l’ont déjà préconisé certains juristes, les rapporteurs se prononcent donc pour la conclusion d’un accord national interprofessionnel (ANI) et d’accords de branche “susceptibles de donner un cadre au développement de l’intelligence artificielle”. Les députés imaginent “un instrument de droit souple” qui permettrait “de créer des instruments d’évaluation de l’impact de la technologie sur chaque métier et à mettre en place les formations adéquates”.
Une méthodologie déjà suggérée par l’accord cadre européen du 22 juin 2020 sur la transformation numérique des entreprises : “Ce texte fournit une méthodologie pour appréhender les transformations de l’entreprise et du travail qui pourrait servir de fondement à un volet du dialogue social spécialement consacré aux usages de l’intelligence artificielle”.
Rendre la consultation du CSE incontournable
L’autre recommandation des députés a directement trait à la consultation du CSE et aux contentieux que son absence génère.
Il s’agit “d’expliciter dans la loi l’obligation d’engager des procédures d’information et, le cas échéant, de consultation des instances représentatives du personnel dès l’engagement des projets reposant sur l’introduction de procédés technologiques appuyés sur l’IA, y compris au stade expérimental”.
Cette recommandation découle du constat largement établi par les syndicats et les élus : la saisie des IRP est très inégale selon les employeurs, certains estimant que la mise en place d’une IA dans l’organisation ne relève que de leurs prérogatives sans avoir à en rendre compte. “De surcroît, ajoutent les députés, la mise en œuvre des procédures de consultation n’offre pas la faculté de mener une revue au long cours du développement des usage de l’IA : le rythme de déploiement effectif des outils conduirait à ce que l’avis rendu par les instances ne porte que sur les principes et objectifs, sans garantie d’un réexamen de ses effets pratiques dans les réunions ultérieures”.
Il serait donc utile, estiment les députés, de s’assurer que les IRP sont saisis “dès l’engagement d’un projet d’IA”. Comment ? En s’inspirant des décisions judicaires récentes selon lesquelles un projet d’introduction de l’IA justifie à lui seul la consultation du CSE et le recours à un expert, sans qu’il ne soit plus besoin de démontrer des répercussions sur les conditions de travail (*). En l’état actuel des textes, ces décisions de première instance peuvent en effet être confirmées ou infirmées par la Cour de cassation, surtout si l’employeur argue qu’il s’agit d’une expérimentation.
Ajouter l’IA à la liste des sujets obligatoirement négociés
Par ailleurs, le rapport plaide pour l’inscription de l’introduction de nouvelles technologies dans la liste des thèmes relevant des négociations devant être engagées chaque année (salaires, temps de travail, partage de la valeur, égalité professionnelle, qualité de vie au travail, etc.).
Les députés souhaiteraient donc voir complété l’article L. 2242-13 du code du travail, mais ils envisagent aussi l’utilité de mentionner explicitement l’introduction des nouvelles technologie dans le champ de la consultation du CSE sur les orientations stratégiques (art. L. 2312-14).
Bernard Domergue
Pourquoi ne faites-vous pas grève ? Des élus CSE répondent
06/10/2025

Nisrine, Djamila et Rajan, élus CSE d’un service de santé au travail
Tous les représentants du personnel ne font pas grève à l’appel des organisations syndicales. Mercredi et jeudi dernier, nous avons demandé aux membres des CSE présents au salon Eluceo du Stade de France les raisons de leur choix. Impossibilité de perdre une journée de salaire, peur des représailles, rejet de tout ce qui s’apparente à du “négatif” ou de la confrontation, lassitude, conviction qu’une nouvelle journée d’action ne changera pas la donne : les motifs sont multiples.
“Faites-vous grève ce jeudi 2 octobre ? Et si non, pourquoi ?” Les réponses à ces deux questions simples ont été parfois déconcertantes dans les allées du salon Eluceo de Paris au stade de France. Nous les avons parcourues les mercredi 1er octobre, veille de l’appel intersyndical contre un budget austéritaire et pour une suspension de la réforme des retraites, et le jeudi 2 octobre, jour de grève et de manifestations (*).
Une question de pouvoir d’achat
“Faire grève ? Ah non moi je ne peux pas poser un jour de congé”, nous réplique ainsi une élue qui s’esquive aussitôt. La réponse peut laisser coi, mais il est vrai que des salariés ayant participé à la journée du 10 septembre “Bloquons tout” avaient parfois posé une RTT ou un jour de congé pour s’absenter du travail plutôt que de se déclarer en grève.
Je n’aime pas ce qui est négatif, je n’aime pas la confrontation
“Je travaille dans un réseau de boutiques de vêtements, on ne peut pas se permettre”, avance cette autre membre de CSE en fin de mandat. Autrement dit, les salaires ne sont pas tels qu’on puisse supporter une journée de rémunération de moins sur la fiche de paie.
Un état d’esprit non vindicatif, la peur de la direction
Plus loin, un groupe d’élus secoue la tête pour signifier ce qui semble une évidence pour eux : “Non, nous ne faisons pas grève, chez nous on ne fait pas ça”. Pourquoi ? “Je n’aime pas ce qui est négatif. D’ailleurs, je ne regarde plus les informations”, nous répond une représentante du personnel qui fait partie du groupe. Mais en tant qu’élue du personnel, n’êtes-vous pas inévitablement amenée à être confrontée à des choses négatives ?, lui fait-on remarquer. “S’il faut défendre un salarié, je vais l’aider, mais je ne suis pas dans la confrontation”, nous répond-elle.
Pas possible de faire grève chez nous, c’est un management par la terreur
La confrontation, cet élu d’une entreprise de logistique de plusieurs centaines de personnes n’ose pas l’imaginer non plus, vu le climat social dans sa société. Lui ferait bien grève mais, nous glisse-t-il, “dans mon entreprise, il y a plusieurs licenciements en ce moment et c’est un management par la terreur”.
D’autres priorités pour le moment
La peur des représailles de l’employeur, ce n’est visiblement pas ce qui conduit Yannick à ne pas envisager la grève. Pour lui, il y a d’abord une question d’agenda.
Les activités sociales et culturelles d’abord
Ce responsable d’une commission d’activités sociales et culturelles d’un grand CSE est venu au salon pour voir des prestataires afin de préparer le Noël… 2026. Il veut construire un programme d’activités sur une journée complète, c’est sa priorité du moment. Pour autant, l’élu confie avoir fait grève il y a 15 jours, le 18 septembre, “contre les projets du gouvernement” : “Mais là, je ne pense pas que cette nouvelle journée puisse avoir un effet. Il y a déjà eu 2 journées de grève (Ndlr : en comptant la journée « Bloquons tout » du 10 septembre), cette troisième journée arrive soit trop tôt soit trop tard. Et faire 3 jours de grève en moins d’un mois, ce n’est pas possible”. Et Yannick d’ajouter : “En plus je travaille dans l’ingénierie. Chez nous, c’est pas comme sur les sites de production, faire grève n’est pas dans la culture”.
Benoit, élu CSE dans la recherche médicale, partage ce scepticisme sur les modes d’action : “Les grévistes, je les soutiens mais moi je ne fais pas grève. Je ne pense pas que cela va changer les choses”, dit-il en ajoutant que personnellement il pense inéluctable de devoir travailler plus longtemps.
Notre direction a accepté une revalorisation salariale donc je ne fais pas grève
Ce n’est sans doute pas l’avis des élus CSE d’un service de santé au travail (voir notre photo ci-dessus) que nous rencontrons un peu plus loin.
Des concessions de la direction
Certes, ils ne font pas grève, mais entre autres raisons c’est au nom d’une certaine idée de leur travail et de leur service auprès des salariés : “En tant qu’infirmière, j’ai travaillé à l’hôpital avant. C’est un service public, d’ailleurs il y avait des réquisitions en cas de grève”, dit Djamila. Son collègue Rajan envisageait néanmoins de faire grève mais il a renoncé après que sa direction ait finalement lâché du lest sur une revalorisation salariale.
7 jours de carence pour les arrêts maladie, ça va être terrible déjà que des salariés malades n’osent pas cesser de travailler
Des préoccupations internes qui ne font pas oublier à ces élus confrontés quotidiennement aux sujets des conditions de travail et des maladies professionnelles les impacts des projets gouvernementaux comme celui consistant à imposer 7 jours de carence avant l’indemnisation d’un arrêt de travail : “Nous sommes bien placés pour voir que déjà, actuellement, avec 3 jours de carence, de nombreux salariés ne s’arrêtent pas de travailler alors qu’ils sont malades. Vous imaginez ce qui va se passer avec 7 jours ?!”
Impossible de faire grève trop souvent
Michel et Raïssa, élus d’un CSE de 850 salariés en Ile-de-France, ont fait grève une fois en septembre, mais pas jeudi dernier. “On s’est mobilisés une fois, ça a permis aux syndicats d’être reçus à Matignon. On est prêt à le refaire, mais pas toutes les semaines ! Ce jeudi, ça ne s’annonçait pas massif” disent les deux élus qui travaillent dans le secteur du logement social. Comme nous l’avait déjà fait remarquer un délégué syndical rencontré lors de la manifestation parisienne du 18 septembre, Michel nous fait en partant cette observation : “Ce qu’on voit dans notre entreprise, une absence d’écoute et de dialogue social, c’est bien ce qu’on voit aussi au niveau national avec le gouvernement”.
(*) Nous avons fait le choix de ne retenir que les réponses des non-grévistes, car nous avions déjà consacré un article et un podcast aux représentants du personnel ayant fait grève le 18 septembre. Précisons que certains des élus rencontrés à Eluceo mercredi et jeudi matin nous disaient vouloir faire grève et manifester à Paris jeudi après-midi.
Bernard Domergue
L’expert-comptable ne peut pas étendre sa mission au-delà des orientations stratégiques de l’entreprise
07/10/2025

Lorsqu’il assiste le CSE dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques, l’expert-comptable ne peut pas englober dans sa mission un projet de réorganisation.
Le code du travail donne au CSE la possibilité de se faire assister par un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise (article L. 2315-87 du code du travail). La mission de l’expert porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise (article L. 2315-87-1).
Il est de l’intérêt de l’expert et du CSE de veiller à ne pas sortir du cadre de l’expertise et à ne pas étendre le périmètre de la mission légale au-delà des orientations stratégiques. Car, si tel était le cas, l’employeur pourrait contester pour recadrer, avant même que l’expertise ne soit enclenchée, l’intervention de l’expert.
C’est exactement ce qui s’est passé dans cette affaire, ayant donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2025.
Une lettre de mission assez large
À l’occasion de la consultation sur les orientations stratégiques de l’année 2024, le CSE d’une association chargée de la gestion d’un service de santé au travail prend la décision de se faire assister par un expert-comptable.
La lettre de mission de l’expert comporte un certain nombre de points se rapportant à un projet de rapprochement avec une autre association de médecine du travail. Il y est notamment prévu que l’expert se chargera de “l’évaluation des conséquences du projet de rapprochement sur les emplois, notamment sur les potentiels doublons et autres potentiels regroupements géographiques” et de “l’identification des grands principes qui guideront la nouvelle organisation du travail issue de cette orientation stratégique”.
L’association saisit la justice afin d’obtenir la redéfinition de la mission confiée à l’expert-comptable par le CSE et le retrait du cahier des charges de l’expert les points se rapportant au projet de rapprochement. Moins de temps consacré à la mission, des honoraires moins élevés !
Les juges font droit à la demande de l’association.
Une information-consultation était déjà prévue sur le projet
Comme le rappelle la Cour de cassation, “la consultation ponctuelle sur la modification de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise ou en cas de restructuration et compression des effectifs n’est pas subordonnée au respect préalable par l’employeur de l’obligation de consulter le comité social et économique sur les orientations stratégiques de l’entreprise (voir Cass. soc., 21 sept. 2022, n° 20-23.660).
Ici, il avait été constaté que l’association avait adressé au comité, le 18 décembre 2023, un document relatif à la phase préparatoire de construction du projet de rapprochement et qu’un accord de méthode signé le 8 mars 2024 avec les organisations syndicales prévoyait une procédure d’information-consultation sur le projet en question.
En conséquence, pour les juges, “ce projet désormais élaboré n’avait pas à être soumis au comité dans le cadre de sa consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise initiée le 16 février 2024”. De sorte que “la mission d’expertise définie dans la lettre de mission du 22 février 2024 excédait le périmètre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’association”. Il y avait donc bien lieu de retirer de la lettre de mission de l’expert-comptable les points du cahier des charges faisant référence au projet de rapprochement et d’ordonner à l’expert de “réviser à la baisse l’estimation du temps consacré à sa mission, ainsi redéfinie, et de ses honoraires”.
Frédéric Aouate
Moins de croissance du fait de la crise politique ?
08/10/2025
L’Insee avait déjà pointé dans ses prévisions 2025 le poids des incertitudes politiques : un climat d’anxiété des ménages provoquant une moindre consommation due à un effort d’épargne supplémentaire, et un climat des affaires très pessimiste, les chefs d’entreprises étant réticents à investir.
Cette fois, c’est l’OFCE, l’office français des conjonctures économiques, qui chiffre l’impact de la crise politique actuelle. Dans une interview auprès de l’AFP, l’économiste Éric Heyer estime à 0,5 point la moindre croissance de l’économie française entre juin 2024 (date de la dissolution) et décembre 2025, soit 15 milliards d’euros de moins qu’attendu.
Source : actuel CSE
IA générative : quel impact environnemental ?
10/10/2025

En cas d’adoption massive de l’IA, les émissions de GES des datacenters pourraient atteindre jusqu’à 500 millions de tonnes de CO2 d’ici 2035.
Augmentation des émissions de gaz à effet de serre, utilisation de ressources rares, dont l’eau… L’explosion de l’IA générative n’est pas sans conséquence pour l’environnement même s’il peut aussi représenter un levier de décarbonation. Tour d’horizon des impacts écologiques de l’IA avec Thomas Gilormini, chercheur en décarbonation, et Florian Pothin, data scientist.
Sans data centers, il n’y aurait pas d’IA générative. Problème : ces équipements sont énergivores. En Irlande, 21 % de la production d’électricité totale est utilisée pour faire fonctionner les data centers en 2023, contre 5 % en 2015, selon l’Office central des statistiques irlandais (CSO). Et depuis 2017, la consommation d’électricité mondiale due aux data centers – au profit de l’IA ou non – augmente de 12 % par an, d’après l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
Or, qui dit consommation d’électricité dit impact carbone ? « Oui, mais cela dépend principalement du pays dans lequel l’électricité est produite avec des moyens plus ou moins carbonés. Actuellement, les géants de la tech utilisent beaucoup de data centers aux USA, pays dans lequel le mix électrique est composé d’énergies fossiles comme le gaz ou le charbon. D’ailleurs, pour pouvoir répondre à une demande d’électricité qui explose, notamment du fait de l’IA, les États-Unis ont annoncé reporter la fermeture de certaines centrales à charbon », note Thomas Gilormini, chef de projet climat chez Toovalu* et chercheur en décarbonation.
L’IA génère une augmentation des émissions de gaz à effet de serre
Ce phénomène entraîne une augmentation des émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à la production d’électricité. « Aujourd’hui, les data centers représentent environ 180 millions de tonnes de CO₂. Si la tendance actuelle se poursuit, selon le scénario de base et avec une adoption partielle de l’IA générative par la population mondiale, ce chiffre atteindra 300 millions de tonnes en 2035. En cas d’adoption massive, il pourrait même grimper jusqu’à 500 millions de tonnes de CO₂ », précise Florian Pothin, data scientist chez Toovalu et doctorant.
Bien que ces volumes représentent moins de 1,5 % des émissions mondiales, la croissance des émissions liées aux data centers est parmi la plus rapide.
L’IA peut aussi accélérer la décarbonation
Parallèlement, l’IA peut aussi contribuer à réduire les émissions de GES, notamment en optimisant les réseaux électriques, en améliorant les processus industriels ou en accélérant la décarbonation des systèmes de transport. Son impact potentiel est estimé à une réduction d’environ 5 % des émissions mondiales liées à l’énergie d’ici 2035, selon l’AIE.
Cependant, ces bénéfices doivent être nuancés : des effets rebond ou l’émergence de nouveaux usages liés à l’IA pourraient contrebalancer une partie de ces gains. Il n’existe donc pas encore de prévisions fiables sur l’impact net de l’IA. Une chose est sûre : l’IA n’est pas une solution miracle au changement climatique. Elle peut certes accélérer la décarbonation, mais son déploiement doit s’inscrire dans une réflexion globale afin que ses avantages environnementaux ne soient pas annulés par ses propres impacts, prévient l’AIE.
Une consommation d’énergie 100 % renouvelable ?
Certains Gafam, comme Google, s’engagent toutefois à recourir à de l’énergie renouvelable d’ici à 2030. Une décision qui leur permettrait de verdir leur activité ? « Google a des serveurs aux États-Unis branchés sur le réseau américain qui n’est pas “100 % renouvelable”, précise Thomas Gilormini. Pour asseoir sa communication, Google achète des certificats d’origine “renouvelable”. Son alimentation dépend toujours de l’ensemble du réseau américain mais ses fournisseurs d’électricité s’engagent à produire de l’électricité renouvelable, à hauteur de sa consommation, et à l’injecter au sein du réseau. Cette approche est critiquée. »
Les normes de reporting concernant les émissions de GES recommandent d’ailleurs une transparence sur ce point : lorsque sont déclarées des émissions de gaz à effet de serre associées à des fournisseurs « verts », il convient aussi de déclarer les émissions réelles liées au mix électrique du pays dans lequel l’électricité est consommée.
L’IA nécessite également des ressources en eau
Au-delà de la problématique liée à la consommation d’électricité, quels sont les autres impacts de l’IA générative ? « La consommation d’eau servant à refroidir les serveurs des data centers pourrait doubler d’ici 2030, selon les projections de l’AIE », mentionne Thomas Gilormini. Or l’eau n’est pas une ressource infinie. Allouer davantage d’eau aux data centers « peut générer de la sécheresse au niveau local, poursuit-il. La priorisation des usages devient un enjeu. Et pour produire de l’électricité, on a aussi besoin d’eau. Il y a donc un double impact lié à la consommation d’eau de l’IA. »
« Actuellement l’IA représente 500 milliards de litres d’eau. En 2030, cela pourrait s’élever à 1 200 milliards de litres. Ce montant va plus que doubler », résume Florian Pothin.
L’IA a aussi un impact sur l’utilisation de minéraux
Troisième impact de l’IA, celui sur l’usage de minéraux nécessaires pour fabriquer l’ensemble des composants électroniques, les serveurs classiques et ceux spécifiques à l’IA avec leurs puces « GPU » (de l’anglais graphics processing unit), dont la durée de vie ne dépasse pas, en général, 5 ans. Les minéraux sont principalement extraits en Afrique. Là encore, ce sont des ressources finies. La question de la priorité donnée à l’utilisation des ressources demeure, car ces composants pourraient être utilisés pour électrifier des transports ou d’autres projets.
« Cela touche une zone bien précise du monde puisque 70 % des puces sont construites en Asie du sud-est à Taïwan ou Taipei notamment, précise Florian Pothin. La consommation d’électricité dans ces zones explose. Lorsqu’il y a des surcharges sur le réseau, comment rationaliser son utilisation et arbitrer entre les besoins des entreprises ou de la population ? Ou faut-il construire de nouvelles centrales ? Aujourd’hui ces questions commencent à se poser dans ces zones-là, et cela pourrait se généraliser. »
Au-delà des data centers, prévoir des smartphones intégrant de l’IA générative
L’engouement de la population en faveur de l’IA générative – largement poussée par son intégration dans des applications utilisées quotidiennement comme les boîtes mails, messageries ou moteurs de recherche – conduit aussi les constructeurs à proposer de nouveaux terminaux aux utilisateurs : des modèles de smartphones ou d’ordinateurs portables intégrant de l’IA et nécessitant des développements technologiques.
Les géants de la tech mettent un gros coup d’accélérateur pour sortir des modèles adaptés à l’IA. « Apple promeut actuellement son Apple Intelligence. Google, son Google Gemini, etc., décrit Florian Pothin. Toutes les publicités sont centrées sur ces IA qui sont à la fois logicielles et matérielles. Indirectement les géants de la tech poussent ainsi les usages de ces technologies énergivores. Ce qui se traduit encore par une augmentation des besoins en électricité, en eau, en matières premières, etc., tant par les utilisateurs que par les fournisseurs de solutions IA. »
*Toovalu est une entreprise du groupe Lefebvre Dalloz, éditeur d’ActuEL direction juridique.
Sophie Bridier
L’intelligence artificielle remodèle l’emploi dans l’ombre
10/10/2025
Près d’un dirigeant sur deux (46 %) affirme avoir réduit ses effectifs en raison de l’intelligence artificielle (IA), selon une étude du cabinet de conseil en ressources humaines LHH, menée entre janvier 2024 et mars 2025 auprès de 8 281 personnes en transition professionnelle dans 17 pays. Pourtant, seuls 12,4 % des salariés licenciés attribuent leur départ à cette technologie – un écart de perception de 34 points qui traduit, selon LHH, une “transformation silencieuse mais profonde du marché du travail”.
Cette méconnaissance n’est pas sans conséquences. Les personnes dont le licenciement est lié à l’IA peinent davantage à rebondir : seulement 36,9 % d’entre elles retrouvent un emploi dans les trois mois, contre 46,2 % pour les autres candidats. Elles présentent également deux fois plus de risques de connaître une période de chômage supérieure à 12 mois.
Paradoxe de cette révolution technologique : ce sont les secteurs les plus avancés qui subissent le plus fort taux de licenciements liés à l’IA. Dans le secteur des logiciels informatiques, 23,3 % des départs y sont attribués, contre seulement 2,5 % dans l’énergie et l’environnement. Une preuve, souligne l’étude, que l’expertise technologique ne protège plus de l’obsolescence des compétences.
Source : actuel CSE