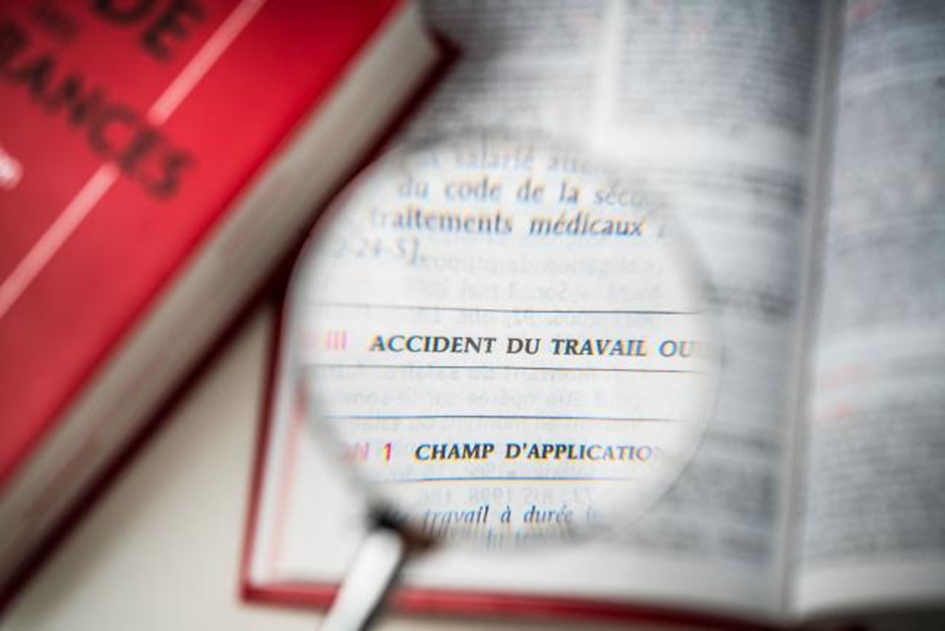Réparation des AT/MP : “Nous avons évité la catastrophe de l’article 39”
08/07/2024
Après neuf mois de négociation difficile, le Comité de suivi de l’accord national interprofessionnel (Ani) sur les AT/MP (accidents du travail et maladies professionnelles) du 15 mai 2023 a accouché d’une “nouvelle architecture générale d’indemnisation des AT/MP”. Une formule attachée au compromis de 1898, à travers une réparation forfaitaire et une rente duale, louée par la majorité des partenaires sociaux, mais critiquée par les associations des victimes.
La nouvelle formule proposée par les partenaires sociaux, détaillée dans un relevé de décision du 25 juin, est une “transformation majeure”, selon Eric Chevée, vice-président en charge des affaires sociales à la CPME. Invité, avec deux représentants de Force ouvrière et Maître Karim Felissi, avocat conseil de la Fnath, à détricoter ce texte technique par l’Association des journalistes de l’information sociale (Ajis) le 3 juillet, le représentant patronal des petites entreprises se réjouit d’un “compromis [qui] reste dans l’esprit de celui de 1898”. Comprendre : le deal dérogatoire et rare en Europe – qui troque une indemnisation automatique mais réduite pour l’accidenté du travail, contre une double protection pour l’employeur (réparation forfaitaire et immunité civile) – reste le fil rouge de cette “nouvelle architecture”.
Ravis d’avoir repris la main, les partenaires sociaux se félicitent à la quasi-unanimité de la copie rendue. Elle est applaudie, selon Eric Chevée, par toutes les organisations patronales qui “vont signer, ça c’est sûr” défendue par Force ouvrière (FO) qui estime “signer la fin d’une injustice” et plébiscitée par la CFTC qui “s’engage pour une meilleure réparation”. Eric Chevée assure avoir également eu la confirmation de la CFDT et l’avis favorable de la CFE-CGC. Seule la CGT “réfléchit” encore. Sans doute sensible aux critiques des associations des victimes. “Je tire mon chapeau au patronat français qui est extrêmement malin, a réagi Maître Felissi, pour la Fnath (association des accidentés de la vie). Pour nous, cette réforme est trompeuse. Aujourd’hui, on a un système qui indemnise mal et qui continuera à mal indemniser ou très peu pour ne pas générer plus de charges à la branche AT/MP.”
“L’article 39, c’était déshabiller Pierre pour habiller Paul”
Pour autant, l’avocat de l’association des accidentés de la vie concède une amélioration. “On a évité la catastrophe de l’article 39, assure-t-il. [Ce dernier] déshabillait Pierre pour habiller Paul, en réduisant la part professionnelle pour financer la part personnelle. Ça, ça n’existe plus.”
Contrairement à la Cour de cassation, et comme l’exécutif, les partenaires sociaux proposent que la rente AT/MP soit duale, c’est-à-dire qu’elle indemnise le préjudice professionnelle (pertes de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité permanente) et le préjudice personnel (déficit fonctionnel permanent ou DFP qui correspond aux conséquences dans la vie courante d’un accident).
Le gouvernement avait proposé une évaluation du préjudice personnel plus ou moins calquée sur celle du préjudice professionnel, qui aurait eu pour effet, selon FO, de ne pas prendre en compte certains pans du DFP et de réduire l’indemnisation des victimes. Raison pour laquelle les partenaires sociaux proposent d’attacher à ce préjudice personnel, grande nouveauté, une évaluation (et une indemnisation) “spécifique [et] distincte” du préjudice professionnel.
“Le changement le plus important est que, désormais, le taux d’incapacité fonctionnelle est évalué de manière totalement autonome par rapport au taux d’incapacité professionnelle”, nous explique FO. L’ensemble des composantes du DFP sont ainsi pris en compte par la rente. Ce que ne faisait pas le calcul de l’article 39. Et ce qui n’était pas couvert par la rente depuis le revirement de la Cour de cassation début 2023. “Cette absence d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent par la rente AT-MP avait pour les victimes la saveur d’une double peine (financière et morale)”, considère FO dans un communiqué du 28 juin.
“Un nouveau système qui s’approche de celui utilisé en droit civil”
Si aucun changement n’est à prévoir pour le préjudice professionnel, l’incapacité personnelle serait ainsi évaluée selon le barème du concours médical et une nouvelle indemnisation serait calculée selon le référentiel Mornet, utilisé par les juges civils dans le contentieux de la réparation du dommage corporel. “On a créé un nouveau système qui s’approche du système utilisé en droit civil”, résume la juriste de FO. À ceci près, que l’évaluation doit être adaptée à la sphère travail et que l’indemnisation civile serait réduite de moitié pour les accidentés du travail. “Sans faute inexcusable de l’employeur, demain, on vous donne 50 % de ce que vous auriez eu le droit d’avoir en droit civil”, explique la syndicaliste.
On vous donne 50 % de ce que vous auriez eu le droit d’avoir en droit civil
Une différence de traitement entre un accidenté de la route et un accidenté du travail justifié, selon FO, par le compromis de 1898. “En droit civil, vous avez trois choses à démonter : un fait générateur, un dommage et un lien de causalité. Ensuite, vous allez devant le juge, c’est une procédure longue, onéreuse et émotionnellement compliquée. C’est seulement au bout de 5 à 10 ans que vous obtenez votre indemnisation. Le compromis de 1898 facilite la vie des victimes car à partir du moment où votre AT/MP est reconnu administrativement, vous avez le droit automatiquement à votre indemnisation. Vous n’avez pas besoin de payer un avocat, d’aller pendant 10 ans devant les tribunaux, etc.”
Un paradigme donnant-donnant que goûte peu Maitre Felissi. “Le compromis n’est pas une histoire de salaire et de prix, s’emporte-il. C’est une histoire d’indemnisation d’un dommage corporel. Que la branche n’ait pas la capacité d’indemniser totalement une personne tétraplégique qui ne peut se servir que de son petit doigt et qui est obligé d’aller à la MDPH [Maison départementale pour les personnes handicapées]… On ne peut pas faire de compromis social sur des sujets éthiques. Les droits subjectifs sont les droits les plus profonds de la personne humaine.”
Ce à quoi, Jean-Marie Branstett, administrateur FO à la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CAT-MP), répond : “On peut toujours s’améliorer mais nous ne sommes tout de même pas complètement à la traîne pour ce qui est de l’indemnisation. On pourrait faire mieux mais c’est toujours un problème de négociation. De temps en temps, il faut admettre avancer petit pas par petit pas.”
Notons que FO souhaite que cette nouvelle architecture soit reprise dans le PLFSS (projet de loi de financement de la sécurité sociale) pour 2025 mais s’inquiète de la conjoncture politique. “Nous allons proposer le texte au gouvernement qui sera en place mais nous n’avons aucune garantie qu’il soit repris, ou repris tel que nous le souhaitons”.
Vers une réparation “quasi intégrale” en cas de faute inexcusable…
Un autre sujet brûlant a été arbitré par les partenaires sociaux : celui de la réparation du DFP (déficit fonctionnel permanent) en cas de faute inexcusable (FIE). “Tout l’enjeu pour les interlocuteurs sociaux était d’améliorer l’indemnisation des victimes d’AT-MP en réintroduisant le DFP dans la rente, sans léser les victimes d’une FIE”, nous résume la juriste de FO.
Le problème étant le suivant : si la rente est censée améliorer la réparation du DFP hors FIE, elle la diminue avec FIE par rapport à la solution apportée par la Cour de cassation début 2023. “La jurisprudence de la Cour de cassation était extrêmement favorable aux personnes, explique Maître Felissi. Elle disait : “Ça suffit maintenant, y’en a marre, quand il y a une faute inexcusable, quand l’employeur est allé trop loin, on indemnise votre DFP”. Sur certains dossiers, on est à 300 voire 400 000 € pour la victime. Ce qui n’existera plus avec cette réforme.”
En cas de FIE, on passe à 100 % du référentiel Mornet
Une assertion que FO tient à tempérer. “Je rappelle que l’on compte moins de 2 000 dossiers de faute inexcusable par an, ce qui fait quand même très peu de dossiers par rapport au nombre d’accidenté et de malades du travail, rétorque la juriste du syndicat. En plus, la méthode de calcul que nous proposons permet d’avoir une majoration de rente significative en cas de FIE. On passe à 100 % du référentiel Mornet. Vous arrivez donc à des sommes quasi similaires à une réparation intégrale”. Avant de nous préciser que : “Avec la nouvelle architecture, la seule différence pour ces victimes sera que le DFP sera versé sous forme de rente viagère et non pas sous forme de capital.” Un choix qui « sécurise » la santé financière de la branche AT/MP.
“Ça bloque toute évolution de la jurisprudence, souffle l’avocat de la Fnath. Vous voulez lui casser les pattes. C’est pour ça que vous faites cette réforme. Pour que la Cour de cassation ne dise pas un jour que c’est terminé, que vous allez indemniser ces gens [les accidentés du travail] de la même façon que les autres. Ces gens-là ont des droits subjectifs comme toute personne et il n’y a pas de raison objective, morale et juridique de ne pas le faire.”
La Fnath, qui a eu accès à un document “réflexions paritaires faisant suite aux groupes de travail 2024 sur la dualité des rentes AT /MP” daté du 16 avril, développe ses inquiétudes dans un communiqué du 30 avril.
… qui protège les petits patrons
Avec la réintégration du DFP dans la rente, l’employeur fautif, comme souhaité par le gouvernement à l’occasion du PLFSS pour 2024, ne serait plus seul à prendre en charge financièrement le préjudice fonctionnel, le montant correspondant à la rente non majorée étant payé par la mutualisation employeur. La Caisse de la sécurité sociale ne pourra lui demander qu’un remboursement pour la part majorée et il ne supportera, seul, que l’indemnisation des autres préjudices non couverts par la rente (souffrances temporaires, préjudice d’agrément, préjudice esthétique, préjudice sexuel, etc.).
“C’est très important pour les TPE/PME, rend compte Eric Chevée. En cas d’accident du travail, sans le système AT/MP, elles disparaissent. Les dirigeants n’ont pas la possibilité de se planquer derrière une chaîne de décisions ou des délégations de responsabilité qui diluent la responsabilité. Nous marquons une différence avec les grandes entreprises”. Réaction de Maître Felissi : “Sur ces sujets, on a trop laissé les grandes entreprises donner le la, estime-t-il. Elles ont les moyens mais refusent que le prix de l’indemnisation leur coûte plus cher. On aurait pu trouver un système intelligent qui protège les TPE/PME du risque tout en permettant une véritable justice sociale pour les salariés.” Note pour plus tard ?
Matthieu Barry
Arrêt de travail : un décret précise les modalités de la contre-visite demandée par l’employeur
08/07/2024
Est paru ce week-end au Journal officiel un décret précisant les modalités et les conditions de la contre-visite médicale diligentée par l’employeur au domicile du salarié ou à un lieu communiqué par lui, ou sur convocation au cabinet du médecin mandaté par l’employeur pour effectuer la contre-visite.
Le contenu de ce texte est relativement court :
« Art. R. 1226-10. – Le salarié communique à l’employeur, dès le début de l’arrêt de travail délivré en application de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’occasion de tout changement, son lieu de repos s’il est différent de son domicile et, s’il bénéficie d’un arrêt de travail portant la mention “sortie libre” prévue à l’article R. 323-11-1 du même code, les horaires auxquels la contre-visite mentionnée à l’article L. 1226-1 peut s’effectuer.
« Art. R. 1226-11. – La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l’employeur. Ce médecin se prononce sur le caractère justifié de l’arrêt de travail, y compris sa durée.
« La contre-visite s’effectue à tout moment de l’arrêt de travail et, au choix du médecin :
« – soit au domicile du salarié ou au lieu communiqué par lui en application de l’article R. 1226-10, en s’y présentant, sans qu’aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées en application de l’article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale ou, s’il y a lieu, aux heures communiquées en application de l’article R. 1226-10 du présent code ;
« – soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation. Si le salarié est dans l’impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il en informe le médecin en en précisant les raisons.
« Art. R. 1226-12. – Au terme de sa mission et sans préjudice des obligations qui lui incombent en application du II de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, le médecin informe l’employeur, soit du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail, soit de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile.
« L’employeur transmet sans délai cette information au salarié. »
► Nous reviendrons sur ces dispositions dans une prochaine édition.
Source : actuel CSE
Contre-visite de l’employeur : les modalités sont enfin fixées
10/07/2024

Le texte réglementaire n’avait jamais été publié. C’est désormais chose faite avec le décret du 5 juillet 2024 qui précise les modalités et conditions de la contre-visite médicale demandée par l’employeur. La principale nouveauté de ce texte réside dans la possibilité d’organiser la contre-visite au cabinet du médecin.
L’employeur a le droit de faire procéder à une contre-visite au domicile du salarié par le médecin de son choix. L‘article L.1226-1 du code du travail prévoit en effet que l’absence justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident doit être constatée par certificat médical et par une contre-visite organisée par l’employeur s’il y a lieu.
L’article L.1226-1 du code du travail renvoie à un décret le soin de déterminer les formes et les conditions de la contre-visite. Ce décret – qui n’avait jamais été publié jusqu’à présent – vient de l’être le 6 juillet. Il crée quatre nouveaux articles dans le code du travail (articles R.1226-10 à R.1226-12 du code du travail), qui organisent la contre-visite de l’employeur.
Ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 7 juillet 2024.
► En l’absence de dispositions réglementaires, la jurisprudence avait défini de nombreuses règles qui restent d’actualité.
Communication du salarié
En premier lieu, le nouvel article R.1226-10 du code du travail précise que le salarié doit communiquer à l’employeur, dès le début de son arrêt de travail, ainsi qu’à l’occasion de tout changement, son lieu de repos s’il est différent de son domicile. Il doit également porter à sa connaissance les horaires auxquels la contre-visite peut s’effectuer, s’il bénéficie d’un arrêt de travail portant la mention “sortie libre”.
► L’avis d’arrêt de travail comporte une rubrique “adresse où le malade peut être visité (si différente de l’adresse habituelle)” qui doit être renseignée le cas échéant. Le volet n° 3 est transmis par le salarié à l’employeur.
En cas de changement de lieu de convalescence en cours d’arrêt de travail, le salarié devra en informer l’employeur afin que celui-ci puisse effectuer une éventuelle contre-visite médicale.
Par ailleurs, la jurisprudence avait déjà admis que le salarié disposant d’un arrêt de travail en “sortie libre” devait informer l’employeur des horaires au cours desquels les contre-visites peuvent s’effectuer (arrêt du 4 février 2009), afin de permettre le contrôle de son état de santé.
Objet et modalités de la contre-visite
La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l’employeur. Il se prononce sur le caractère justifié de l’arrêt de travail, y compris sa durée (article R.1226-11 du code du travail).
La contre-visite s’effectue à tout moment de l’arrêt de travail et, au choix du médecin :
- soit au domicile du salarié ou au lieu qu’il lui a communiqué, sans qu’aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées ou aux heures communiquées par le salarié en cas de “sortie libre” ;
- soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation. En cas d’impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, le salarié en informe le médecin en en précisant les raisons.
Issue de la contre-visite
L’article R.1226-12 du code du travail prévoit que le médecin informe l’employeur :
- soit du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail ;
- soit de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié (notamment refus de se présenter à la convocation ou absence lors de la visite à domicile).
L’employeur transmet également sans délai cette information au salarié.
Au terme de sa contre-visite, le médecin doit également respecter les obligations issues du code la sécurité sociale (article L.315-1 du code de la sécurité sociale). Ainsi, lorsque le médecin mandaté par l’employeur conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail ou de l’impossibilité de procéder à l’examen du salarié malade, il transmet, dans un délai de 48 heures, son rapport au service médical du contrôle médical de la caisse de sécurité sociale.
Au vu de ce rapport, le médecin-conseil de l’assurance-maladie peut demander à la caisse :
- soit de suspendre les indemnités journalières. Le salarié dispose alors d’un délai de 10 jours francs à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités, pour demander à la caisse de sécurité sociale dont il relève, un examen de sa situation par le médecin-conseil. Ce dernier doit se prononcer dans un délai de quatre jours francs à compter de la saisine du salarié ;
- soit de procéder à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré.
Si, après examen de l’assuré, le médecin-conseil conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail, il en informe immédiatement l’intéressé et lui communique oralement une date de reprise du travail. Il informe également les services administratifs de la caisse et le médecin traitant (article R.315-1-3 du code de la sécurité sociale).
L’employeur est alors en droit de ne pas verser les prestations complémentaires (arrêt du 26 octobre 1982).
► Rappelons que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 avait tenté de renforcer les conséquences de la contre-visite médicale diligentée par l’employeur sur le versement des IJSS. Dans une décision du 21 décembre 2023, le Conseil constitutionnel avait censuré cette mesure.
Virginie Guillemain
La nouvelle COG de l’Assurance maladie pour 2023-2028 est signée
10/07/2024
La Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CAT/MP) et la Caisse nationale d’Assurance Maladie ont signé, le 5 juillet, avec l’Etat la Convention d’objectifs et de gestion (COG) de l’Assurance Maladie – Risques professionnels pour la période 2023-2028.
► La COG détermine les objectifs et les actions à mettre en œuvre sur la période déterminée.
Afin de renforcer la politique de prévention, le cadrage budgétaire prévoit une augmentation progressive des moyens jusqu’en 2028 (notamment dotations INRS et aides financières directes pour la branche Risques professionnels de l’Assurance maladie).
Quatre axes stratégiques ont été déterminés :
- renforcer la prévention des risques professionnels pour la rendre plus efficiente : baisse de la sinistralité, prévention des TMS et des risques chimiques et psychosociaux, des chutes… par la mise en place d’accompagnements personnalisés et d’aides financières directes aux entreprises ;
- améliorer l’accès aux droits et l’accompagnement des assurés : notamment accompagnement des assurés et simplification des procédures déclaratives, développement de la communication et de l’usage du C2P ;
- renforcer la relation de service vers les entreprises : développement de l’offre de services via le compte entreprise ;
- garantir ses services fondamentaux : équilibre financier de la branche, qualité et fiabilité de gestion.
Source : actuel CSE
Un décret précise les modalités de la médecine du travail pour les personnes détenues
10/07/2024
Un décret du 8 juillet 2024 établit les modalités du suivi individuel de l’état de santé des personnes détenues qui travaillent, assuré par les médecins des unités sanitaires en milieu pénitentiaire.
Le texte fixe également les règles applicables au suivi individuel renforcé de l’état de santé des personnes détenues qui travaillent, assuré par les médecins des services de prévention et de santé au travail.
Le décret traite également des examens médicaux de reprise et précise, pour la mise en œuvre de la médecine du travail en détention, le conventionnement à mettre en place.
Source : actuel CSE
Le compte AT/MP intègre le compte entreprise
11/07/2024
Depuis le 2 juillet, le compte entreprise intègre les fonctionnalités du compte AT/MP (accidents du travail et maladies professionnelles). Il existe désormais un seul point d’entrée pour tous les services en ligne de l’Assurance Maladie et de l’Assurance Maladie – Risques professionnels sur net-entreprises.fr.
Le même bouquet de services perdure :
- la consultation des taux de cotisation notifiés avec le détail de leur calcul ;
- la notification dématérialisée des décisions de taux de cotisation ;
- les sinistres récemment reconnus impactant les futurs taux ;
- un bilan individuel des risques professionnels permettant de se comparer avec les autres entreprises de mêmes taille et secteur ;
- l’attestation des indicateurs des risques professionnels, nécessaire dans le cadre d’une réponse à un marché public ;
- et un service de demande en ligne des Subventions Prévention, pour aider l’employeur à financer des solutions de prévention des risques professionnels.
Seule l’ergonomie évolue. Aucune action n’est à effectuer :
- si l’employeur était inscrit(e) au compte AT/MP, il dispose également d’un accès direct aux fonctionnalités de l’ancien compte AT/MP, en cliquant sur la pastille “Consulter ses taux AT/MP et prévenir ses risques professionnels” (anciennement compte AT/MP), qui permet d’arriver directement sur la page “Consulter les taux de cotisation AT/MP” de la rubrique “Votre entreprise” ;
- s’il était inscrit à net-entreprises.fr, mais pas au compte AT/MP : à partir du menu Net-entreprises, il faut cliquer sur “Gestion”, puis “Gérer les déclarations”. Après avoir sélectionné le service “Consulter ses taux AT/MP et prévenir ses risques professionnels” et valider, l’employeur aura un accès sous 48 heures.
Source : actuel CSE
Un enregistrement réalisé à l’insu de l’employeur peut permettre de prouver un accident du travail
11/07/2024
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a décidé récemment que, dans un procès civil, l’illicéité dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Par un arrêt du 6 juin 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation applique pour la première fois cette solution au contentieux des accidents du travail. Elle approuve la cour d’appel d’avoir jugé qu’un salarié peut produire un enregistrement audio effectué à l’insu du gérant de la société avec qui il a eu une altercation, afin de voir reconnaître tant le caractère professionnel de l’accident résultant de cette altercation que la faute inexcusable de l’employeur après avoir constaté que les juges ont bien mis en balance de manière circonstanciée le droit au respect de la vie privée du gérant et le droit à la preuve de la victime.
► A noter : la deuxième chambre civile rejoint ainsi la chambre sociale de la Cour de cassation qui a déjà fait application de cette jurisprudence en matière prud’homale (arrêt du 17 janvier 2024 ; arrêt du 14 février 2024).
Source : actuel CSE
Le plan national de gestion des vagues de chaleur est mis à jour
12/07/2024
Une instruction interministérielle du 18 juin 2024 associée au plan national de gestion des vagues de chaleur mis à jour viennent d’être publiés. Ils devraient permettre de renforcer l’efficacité de l’organisation en cas d’épisode de canicule.
L’été 2023 a été le 4e plus chaud jamais enregistré en France. Au total, quatre épisodes de canicule ont été recensés et ont concerné 73 % de la population du pays. 1 500 décès attribuables à la chaleur ont également été enregistrés durant ces périodes de canicule.
Dans ce contexte, en complément des dispositions spécifiques de gestion sanitaire des vagues de chaleur du plan Orsec départemental, une instruction interministérielle du 18 juin 2024 précise les nouvelles mesures à mettre en œuvre dans les territoires afin :
- de se préparer de façon systématique en amont de la période estivale du 1er juin au 15 septembre ;
- d’anticiper l’arrivée prévue d’une vague de chaleur ;
- de définir les actions à mettre en œuvre aux niveaux national et local pour prévenir et limiter les impacts notamment sur la population (organisation, économie, transport, travail, vie sociale, culturelle, sportive, santé , confort, etc.).
Source : actuel CSE
Risque routier professionnel : pour sensibiliser, le gouvernement publie les chiffres-clés
12/07/2024
La prévention du risque routier professionnel figure parmi les priorités du Plan santé au travail 2021-2025, prévention qui doit notamment passer par une meilleure connaissance du sujet. Le plan énonce ainsi que “les données par secteur devront encore être précisées”.
C’est ce qu’a fait le ministère du travail en publiant lundi un document présentant les chiffres clés relatifs à ce risque. Il y rappelle que le risque routier professionnel “est un risque professionnel majeur : chaque année, les accidents routiers professionnels (accidents de trajet domicile-travail et accidents de mission confondus) sont la deuxième cause de mortalité au travail en France. 485 personnes ont été tuées lors d’un déplacement lié au travail en 2022”. Cela représente 1,3 décès par jour et 30 % de l’ensemble des accidents mortels liés au travail.
Plus alarmant encore, pas moins de 27 815 500 travailleurs sont concernés par le risque routier et 37 % des accidents corporels de la route impliquent au moins un usager en déplacement lié au travail. Le document insiste aussi sur le fait qu’un décès sur 10 concerne un travailleur embauché depuis moins de un mois et que 39 % des salariés décédés sur un trajet domicile-travail ont moins d’un an d’ancienneté : “La sensibilisation au risque routier professionnel doit se faire dès l’embauche !”
Avec ces données, le ministère espère aider à mieux orienter la politique de prévention : “La publication de chiffres clés et d’informations plus détaillées sur ce risque en France doit permettre la mobilisation des branches professionnelles, des entreprises, des représentants des salariés, des salariés eux-mêmes et de l’ensemble des acteurs de la prévention pour améliorer la prise en compte de ce risque professionnel à part entière”.
Quelques conseils sont d’ailleurs prodigués en fin de document.
Source : actuel CSE