PLFSS pour 2026 : les modalités du nouveau congé supplémentaire de naissance
20/10/2025
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 crée un nouveau congé supplémentaire de naissance ouvert aux deux parents d’une durée ne pouvant pas excéder deux mois et faisant suite aux congés de naissance, de paternité et d’accueil de l’enfant, ou d’adoption.
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2026, dont la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale débutera l’examen demain, crée un nouveau congé de naissance supplémentaire (nouvel article L.1225-46-2 du code du travail).
Les fiches d’évaluation préalable des articles du PLFSS pour 2026 permettent d’en comprendre les enjeux. Cette réforme est ainsi motivée par :
- un congé maternité en France qui est plus faible que dans d’autres pays européens ;
- une durée du congé maternité qui n’a pas évolué depuis 1980 ;
- et la nécessité de contribuer à améliorer la répartition des tâches parentales et domestiques.
“Le choix de créer un congé supplémentaire plutôt que d’allonger la durée des congés existants de maternité, paternité et d’adoption vise d’une part à permettre une distinction claire entre le congé initial qui est assorti d’un régime juridique propre (dont l’interdiction d’emploi pour les congés de maternité et de paternité, la protection dite absolue de l’emploi pendant le congé de maternité et le rattrapage salarial) et un congé supplémentaire facultatif qui bénéficie d’un régime juridique distinct”, explique la sécurité sociale.
En outre, il s’agit de préserver les dispositions conventionnelles qui existent sur ce sujet. “Ce choix permet d’écarter tout concours entre la nouvelle disposition légale et les stipulations conventionnelles existantes sur le congé de maternité notamment. Des accords collectifs offrent en effet la possibilité aux salariées enceintes de prolonger leur congé de maternité de plusieurs semaines, avec maintien de la rémunération. Avec la création de ce nouveau congé légal, les clauses conventionnelles sont maintenues”, est-il indiqué.
À noter : le congé sera applicable pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er juillet 2027, ainsi qu’aux enfants nés avant cette date dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.
Un congé de deux mois
Chacun des deux parents pourra bénéficier d’un congé supplémentaire de naissance d’une durée d’un mois ou de deux mois au choix du salarié s’ajoutant à son droit à congé de maternité, à congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou à congé d’adoption, lorsque ce dernier est épuisé.
Chaque parent pourra prendre le congé simultanément ou en alternance avec l’autre. La fiche préalable d’évaluation indique que le congé supplémentaire pourra être pris à la suite du congé de maternité, paternité ou d’adoption ou a posteriori, dans la limite de neuf mois.
Le congé ne pourra pas être fractionné.
► À noter : la condition d’avoir épuisé son droit à congé ne s’appliquera pas au salarié qui n’a pas exercé tout ou partie de ce droit faute de pouvoir bénéficier des indemnités et allocations y afférentes.
Les modalités du congé
Le congé sera assorti d’un délai de prévenance de l’employeur quant à la date de prise du congé et de sa durée qui devrait être fixé par décret entre 15 jours et un mois.
Il pourra être réduit lorsque le congé est pris immédiatement après le congé de paternité ou le congé d’adoption. Le texte réglementaire devra également préciser le délai dans lequel les jours de congé devront être pris. Ce délai devra tenir compte des situations dans lesquelles le congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption peut être augmenté en application des articles L.1225-17 à L.1225-22 du code du travail (naissances multiples, état pathologique, hospitalisation de l’enfant…) ou d’une convention ou d’un accord collectif de travail.
Ce délai de prévenance sera réduit si le salarié prend son congé supplémentaire de naissance immédiatement après le congé de paternité ou le congé d’adoption.
La durée du congé supplémentaire de naissance sera assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Ce dernier conservera le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.
► À noter : Les périodes d’indemnisation de ce congé permettront la validation de droits à retraite.
Le salarié ne pourra exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé.
En cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié pourra reprendre son activité avant le terme prévu du congé supplémentaire de naissance.
La rémunération des parents pendant le congé
Pendant la durée du congé, le salarié percevra une indemnité journalière, à condition de cesser tout travail salarié durant la période d’indemnisation et de remplir les conditions fixées à l’article L.313-1 du code de la sécurité sociale (avoir travaillé au moins 150 heures au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédant l’arrêt et avoir cotisé, au cours des six mois civils précédents sur la base d’une rémunération au moins égale à 1 015 fois le montant du Smic horaire fixé au début de cette période).
Le montant de cette indemnité correspondra à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière, qui seront déterminé par un décret en Conseil d’Etat. Ce montant pourra être dégressif entre le premier et le second mois du congé. La fiche d’évaluation préalable indique ainsi que le premier mois sera indemnisé à hauteur de 70 % du salaire net antérieur et le deuxième mois à 60 %.
L’indemnité journalière afférente au congé ne pourra pas se cumuler avec :
- l’indemnité journalière versée en cas de maladie (article L.321-1 du code de la sécurité sociale) ;
- les indemnités journalières applicable au congé de maternité, au congé d’accueil et de paternité et au congé de deuil (articles L.331-3 à L.331-9 du code de la sécurité sociale) ;
- les indemnités journalières versées en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles (article L.433-1 du code de la sécurité sociale) ;
- les indemnités servies aux demandeurs d’emploi par l’assurance chômage ou le régime de solidarité ;
- le complément de libre choix du mode de garde de l’enfant ;
- la prestation partagée d’éducation de l’enfant ;
- l’allocation journalière de présence parentale ;
- l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;
- l’allocation journalière de proche aidant.
► À noter : ce droit à congé n’empêchera pas de bénéficier ensuite de la Prépare qui indemnise la prise d’un congé parental d’éducation ou d’un congé parental. Toutefois, les deux prestations ne pourront pas être prises en même temps.
Les garanties applicables pendant le congé
Pendant toute la durée du congé, l’employeur ne pourra pas rompre le contrat de travail du salarié sauf en cas de faute grave du salarié ou de l’impossibilité pour l’employeur de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la naissance ou à l’arrivée de l’enfant.
La reprise du travail
Pendant le congé supplémentaire de naissance, le contrat de travail sera suspendu.
À l’issue du congé, le salarié devra retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Par ailleurs, le salarié bénéficiera d’un entretien professionnel si ce dernier n’a pas déjà été réalisé à l’issue des congés de maternité ou d’adoption.
Florence Mehrez
Aurore Vitou nommée directrice de cabinet du ministre du travail
20/10/2025

À la suite de sa démission, puis de sa nouvelle nomination à Matignon, Sébastien Lecornu a reformé son pôle social à l’identique. Un arrêté du 15 octobre 2025 confirme ainsi
- Aymeric Morin en tant que conseiller social, chef de pôle ;
- Anne-Briac Bili, conseillère santé, adjointe au chef de pôle (seulement jusqu’au 12 octobre 2025) ;
- Julie Leroy, conseillère travail, emploi et formation ;
- Alix de Roubin, conseillère solidarités ;
- Etienne Barraud, conseiller comptes sociaux.
Le nouveau ministre du travail et des solidarités, Jean-Pierre Farandou, bâtit également son cabinet. Sont ainsi nommés par arrêté du 15 octobre 2025 :
- Aurore Vitou, directrice du cabinet (elle était auparavant depuis septembre 2024 directrice adjointe de cabinet de la ministre du travail et de l’emploi, après avoir été sous-directrice des relations de travail de 2022 à 2025, sous directrice adjointe des relations individuelles et collectives de travail de 2021 à 2022. Elle est diplômée de Sciences Po et de l’Ecole nationale d’administration) ;
- Ulric de La Batut, directeur adjoint du cabinet ;
- Marine Mantel, chef de cabinet.
Source : actuel CSE
Retraites, seuils d’effectifs, Sécurité sociale, prud’hommes : des amendements déposés sur le PLF 2026 en matière sociale
20/10/2025
Examiné cette semaine en Commission des finances, le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 fait l’objet de plus de 1 700 amendements.
Parmi eux, un amendement n° I-CF956 déposé par le député Droite Républicaine Xavier Breton propose d’aligner le mode de calcul de l’effectif de l’entreprise, tel que prévu par l’article L. 1111-2 du code du travail, sur les modalités prévues par le code de la Sécurité sociale (article L. 130-1).
Selon l’exposé des motifs de cet amendement, “deux méthodes de décompte coexistent : d’une part, le décompte des effectifs “sécurité sociale”, utilisé notamment pour l’épargne salariale ; d’autre part, le décompte des effectifs en droit du travail, qui varie selon les obligations concernées (par exemple pour la mise en place du CSE). À cela s’ajoute une hétérogénéité des périodes de référence prises en compte : selon l’obligation sociale considérée, le mode de calcul diffère, ce qui complique la compréhension des règles et leur mise en œuvre”. Cela serait facteur d’erreurs selon le député auteur de cet amendement qui précise qu’il a été proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.
L’amendement permet cependant de maintenir l’effet de seuil autour de 11 salariés pour la mise en place du CSE, “en harmonisant la période de référence sur 12 mois consécutifs”.
Divers amendements reviennent également sur le remplacement de l’abattement de 10 % des pensions de retraite par un forfait de 2 000 €. Soit ils proposent de supprimer cet article (n° I-CF250 par exemple), soit de modifier le montant du forfait à 2 500 € (n° I-CF251 Droite Républicaine), 3000 € (n° I-CF237, groupe Socialiste), 2 800 € (n° I-CF463 Ensemble), seulement 450 € (n° I-CF1802 Ensemble) ou encore 3000 € pour une personne seule et 4000 € pour un couple (n° I-CF1742 Socialistes).
Un amendement propose de maintenir l’abattement de 10 % pour les pensions supérieures à 20 000 € annuels et de transférer la fraction d’abattement forfaitaire qui excède le montant du revenu de l’un des membres du foyer fiscal à l’autre membre du foyer (n° I-CF1248 LFI). Un amendement I-CF1390 propose de conjugaliser le plafonnement de l’abattement de 10 % sur les pensions et retraites (LIOT) et un amendement n° I-CF88 de maintenir l’abattement de 10 % en Outre-Mer (Droite Républicaine). Un député du groupe Liot propose enfin de défiscaliser les revenus d’activité professionnelle des retraités dans la limite du SMIC pour encourager l’emploi des retraités (I-CF1645).
Plusieurs amendements (Socialistes, Ecologistes ou LFI, n° I-CF920 par exemple) suggèrent de supprimer l’article 30 du PLF qui prévoit de mettre fin à la gratuité des recours en prud’hommes en créant une taxe de 50 €.
Enfin, deux amendements veulent revenir sur l’article 40 qui prévoit de modifier les fraction de TVA affectées à la sécurité sociale. Ces fractions tiennent compte du transfert au budget de l’État du gain attendu de la réforme des allègements généraux de cotisations patronales, issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Un amendement LFI propose de supprimer cet article (I-CF324), considérant que “la formalisation des transferts financiers entre l’État et la Sécurité sociale, afin de compenser leurs coûteuses exonérations (…) [mettent] notre sécurité sociale sous dépendance financière de l’État”.
Un amendement I-CF325 (LFI) propose quant à lui de supprimer la redirection des excédents de l’Unédic vers l’État, “ce qui n’est ni plus ni moins que la subtilisation des cotisations des travailleurs et des assurés à l’assurance-chômage”, indique son exposé des motifs.
Source : actuel CSE
Barème “Macron” : les périodes de maladie ne sont pas déduites de l’ancienneté du salarié
22/10/2025
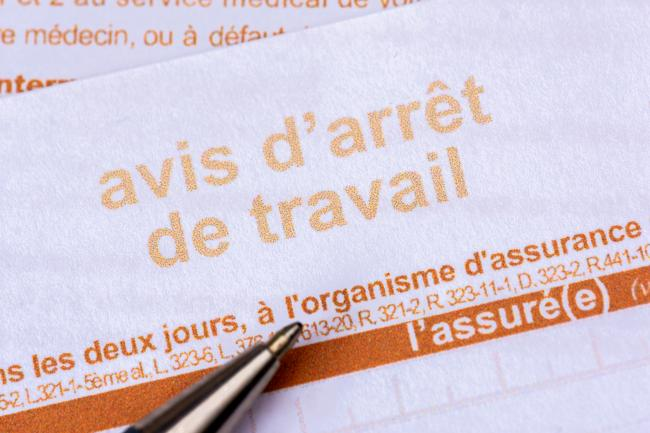
Pour calculer l’indemnisation du salarié dont le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le juge ne doit pas déduire de son ancienneté les périodes de suspension de son contrat de travail.
Une salariée embauchée en mai 2016 fait l’objet d’un licenciement verbal en avril 2019. Son licenciement, non motivé, est jugé sans cause réelle et sérieuse. Mais la cour d’appel la déboute de sa demande d’indemnité pour licenciement abusif car elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter de novembre 2016 et compte donc, selon les juges du fond, moins d’un an d’ancienneté. Double erreur, censurée par la Cour de cassation.
Les périodes de suspension du contrat ne sont pas déduites de l’ancienneté
Le barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, prévu par l’article L.1235-3 du code du travail, fixe les montants minimaux et maximaux de l’indemnité que l’employeur est condamné à verser au salarié abusivement licencié. Le montant de cette indemnité dépend de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et de son salaire mensuel.
La Cour de cassation souligne que ce texte ne comporte aucune restriction en cas de suspension du contrat de travail du salarié. Par conséquent, la cour d’appel ne pouvait pas déduire de l’ancienneté de la salariée ses périodes d’arrêt maladie, pour en conclure que celle-ci était inférieure à un an et qu’elle n’avait pas droit à une indemnisation.
La Cour de cassation transpose ici à l’indemnité due en application du barème “Macron” une solution qui avait déjà été retenue sous l’empire des textes antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (arrêt du 17 octobre 1979 ; arrêt du 7 décembre 2011).
Même avec une ancienneté inférieure à un an, la salariée aurait eu droit à réparation
Pour la cour d’appel, la salariée, qui travaillait pour une entreprise de moins de 11 salariés, n’avait pas droit à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse car elle justifiait de moins d’un an d’ancienneté. Selon les juges du fond, en effet, le barème prévu par l’article L.1235-3 du code du travail ne prévoit pas de montant minimal d’indemnité pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté.
Mais ce raisonnement était, en tout état de cause, erroné. La Cour de cassation a en effet récemment jugé que le salarié qui compte moins d’un an d’ancienneté dans une entreprise de moins de 11 salariés a droit à une indemnité fixée par le juge, dans la limite d’un mois de salaire (arrêt du 12 juin 2024).
En l’espèce, l’ancienneté à retenir pour calculer l’indemnité de la salariée courait de mai 2016 à avril 2019, soit deux ans et 10 mois. En application du barème, la salariée pouvait donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire. La Cour de cassation, statuant au fond, lui a accordé une indemnité correspondant au montant maximal du barème.
Laurence Méchin
La crise sanitaire a réduit la conflictualité dans les entreprises
23/10/2025

De 2020 à 2022, la crise sanitaire a vu les entreprises déclarer moins de conflits collectifs, souligne une étude du ministère du travail. Ces conflits étaient provoqués par les revendications salariales, les mauvaises relations de travail et les mauvaises conditions de travail.
En éloignant les salariés les uns des autres, la crise sanitaire a-t-elle aussi entraîné de moindres conflits au travail ? La Dares (direction de l’animation et de la recherche du ministère du travail) répond positivement dans une étude. De 2020 à 2022, la conflictualité (grèves, débrayages, pétitions, etc.) a concerné 11 % des établissements de plus de 10 salariés du secteur privé non agricole, soit 5 points de moins par rapport à la période 2014-2016.
Moins d’actions sans arrêts de travail
Cette conflictualité a pris la forme d’un arrêt de travail (dans 8 % des cas, comme lors de la période précédente, avec une hausse d’un point des arrêts de travail de 2 jours et plus) ou par exemple d’un débrayage (4% au lieu de 5 % auparavant).
Les actions sans arrêt de travail (type grève perlée, grève du zèle, refus d’heures supplémentaires, etc.) sont en fort recul (3 % des établissements au lieu de 8 % auparavant). La pétition, par exemple, concerne seulement 2 % des établissements, au lieu de 5 %, sans doute du fait des mesures de distanciation sociale imposées par le Covid (*).
“La crise sanitaire semble plutôt contribuer à limiter l’expression de tensions et de conflits collectifs”, constate l’étude. Cette baisse touche également, mais moins fortement, les établissement disposant d’une présence syndicale ( – 2 points, avec 27 % des établissements concernés) ou d’une représentation collective (- 3 points, avec 6 % d’établissements concernés)
Les retraites ont réveillé les conflits interprofessionnels
Selon l’auteur, Maxime Lescurieux, les conflits dans cette période de crise sanitaire ont été plutôt interprofessionnels, liés notamment à la question des retraites et aux revendications sur le pouvoir d’achat. Ainsi, la part d’établissements touchés par ces conflits interprofessionnels a doublé entre les deux périodes, en passant de 2 à 4 %.
Ces conflits interprofessionnels ont particulièrement touché l’enseignement, la santé et l’action sociale privés (11 %), la finance et l’assurance (10 %) et le transport-entreposage (8 %).
Une baisse générale à tous les secteurs sauf dans la finance-assurance
Comme on le voit dans le tableau ci-dessous, cette baisse conflictuelle s’observe dans tous les secteurs, à l’exception de la finance et assurance (+ 3 points). Cette exception s’explique par les restructurations des entreprises de ce secteur et par d’importants changements dans l’organisation du travail (digitalisation, réduction du nombre d’agences, intensification du travail et progression des risques psychosociaux).
Ce recul concerne également les plus grands établissements : la conflictualité dans les sociétés de plus de 500 salariés baisse de 6 points entre 2014-2016 et 2020-2022. Néanmoins, la taille de l’entreprise, avec la présence des organisations syndicales, s’avère toujours déterminante : le pourcentage d’entreprises déclarant des conflits collectifs passe de 18 % de 50 à 99 salariés à 57 % pour les établissements de 500 salariés et plus.
Les causes des conflits collectifs : d’abord les salaires
Un autre enseignement de l’étude porte sur l’élément générateur des conflits. On trouve ici les causes suivantes :
- les revendications salariales (présentes dans 62 % des établissements concernés par au moins un conflit collectif, soit une hausse de 20 points par rapport à l’enquête de 2017 !) ;
- Les mauvaises relations de travail, dues à des “brimades et à des problèmes disciplinaires” (dans 27 % des établissements concernés par un conflit collectif, soit + 3 points par rapport à 2014-2016) ;
- Les mauvaises conditions de travail (dans 25 % des établissements, soit une baisse de 4 points par rapport à 2014-2017). Sont ici surreprésentés les secteurs (transports, commerce) employant les métiers de deuxième ligne qui ont assuré la continuité de la vie économique pendant la crise sanitaire.
- Le temps de travail (13 %) ;
- L’emploi et les licenciements (11 %), etc.
Conflits individuels : de fortes disparités selon les secteurs
Selon la Dares, les conflits individuels, qui signent aussi une forme de conflictualité plus ou moins forte au travail (entraînant des arrêts de travail et des démissions, etc.), s’avèrent stables. Cette stabilité recouvre toutefois des évolutions contrastées. Ces conflits individuels sont ainsi en hausse :
- dans le secteur de la finance et l’assurance (+ 13 points) ;
- dans les établissements en franchise ou location gérance (78 % de ces établissements sont concernés !) ;
- dans l’hébergement-restauration (55 % des établissements font état de fortes tensions entre collègues de travail) ;
- dans la santé et l’action sociale privées (53 %).
Toujours moins d’actions aux prud’hommes
À noter que 19 % des établissements de plus de 10 salariés ont connu au moins un recours aux prud’hommes, soit 7 points de moins que lors de la période 2014-2016.
Le premier motif de saisine étant le licenciement (motif de 67 % des recours) devant la contestation des indemnités de rupture du contrat de travail.
Le recours aux prud’hommes s’accroit avec la taille de l’entreprise et la présence d’une représentation du personnel. Rappelons que le projet de loi de finances pour 2026 prévoit de faire payer 50 euros pour toute action prud’homale…
(*) Définitions données par la Dares. Grève perlée : ralentissement de travail, diminution concertée du rythme de production. Grève du zèle : ralentissement du travail sous prétexte du respect scrupuleux du règlement. Refus d’heures supplémentaires : cas où au moins deux salariés refusent en même temps des heures supplémentaires demandées par leur hiérarchie
Bernard Domergue
Une transaction peut limiter dans le temps la requalification de CDD en CDI
23/10/2025

Les effets d’une demande de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne peuvent remonter au-delà du premier contrat conclu après la transaction.
Dans cette affaire, un salarié est engagé par la société France Télévisions en qualité de chef monteur en contrats à durée déterminée d’usage à compter du 1er décembre 2000.
Il signe avec son employeur une transaction le 10 juillet 2009 puis, cinq ans plus tard, le 17 février 2014, conclut à nouveau avec cette même société un nouveau CDD d’usage qui sera suivi de plusieurs autres jusqu’au terme du dernier contrat, le 17 août 2017.
Il saisit la juridiction prud’homale le 11 septembre 2018 et obtient la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée, mais seulement à compter du 17 février 2014, date de la reprise de ses relations contractuelles avec la société.
En cas de requalification de CDD en CDI, le salarié est considéré en CDI depuis le premier CDD irrégulier…
Or, le salarié estimait qu’il fallait également requalifier les CDD conclus avant la transaction intervenue en 2009, et ainsi remonter jusqu’au 1er décembre 2000.
Il se pourvoit en cassation, au motif que, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier, qu’il est en droit de se prévaloir d’une ancienneté remontant à cette date et “que ce report ne peut être affecté par une transaction, même lorsque celle-ci a pour objet de mettre fin à tout litige né ou à naître”.
► En effet, la Cour de cassation considère classiquement qu’en cas de requalification d’un contrat à durée déterminée, le salarié est en contrat à durée indéterminée depuis le premier contrat à durée déterminée irrégulier (notamment arrêt du 29 janvier 2020).
… à moins qu’une transaction soit intervenue avant la conclusion des derniers contrats
Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation, qui rappelle que :
- les parties avaient signé une transaction le 10 juillet 2009 qui avait pour objet de mettre fin à tout litige né ou à naître entre les parties et selon laquelle celles-ci s’étaient déclarées remplies de l’intégralité de leurs droits à cette date ;
- le salarié n’avait exécuté aucune prestation de travail pour le compte de la société entre juillet 2009 et février 2014.
Dès lors, les effets de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à l’égard de la société ne devaient pas remonter au-delà du premier contrat conclu postérieurement à la transaction, à savoir au-delà du 17 février 2014.
Ainsi, en l’espèce, si l’intervention d’une transaction à l’issue du dernier CDD, qui avait pris fin cinq ans avant la reprise des relations contractuelles, ne fait pas obstacle à la requalification de CDD irréguliers en CDI, elle en limite les effets. Seuls les CDD irréguliers conclus postérieurement à cette transaction peuvent être requalifiés en CDI.
► À noter que, le même jour, la Cour de cassation a rendu un autre arrêt en matière de transaction, rappelant que l’action en nullité d’une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil (arrêt du 8 octobre 2025).
Delphine De Saint Rémy
Comment redonner du sens au travail ? Les pistes de la Fondation Jean Jaurès
23/10/2025
Dans une étude publiée vendredi 17 octobre 2025, la Fondation Jean Jaurès, club de réflexion indépendant proche du PS, interroge la notion de sens au travail.
Premier constat : “l’ampleur de la quête de sens dans le travail est concomitante à la diminution de l’engagement envers l’employeur”.
L’auteur identifie plusieurs raisons à la perte de sens au travail :
- dans les grandes structures, des changements fréquents d’orientations stratégiques ;
- l’accélération de l’automatisation des tâches avec le développement de l’IA ;
- une organisation rigide du travail.
Dès lors, comment permettre aux salariés de retrouver du sens dans leur activité professionnelle ? Plusieurs pistes sont évoquées par la Fondation Jean Jaurès :
- une plus grande souplesse dans l’aménagement du travail des équipes ;
- l’élargissement des missions de l’employeur vers des sujets sociétaux ;
- accorder plus de temps de respiration aux salariés, par exemple en leur permettant d’occuper des missions transversales ou de suivre des formations qui s’écartent de leur activité principale.
Source : actuel CSE
Le représentant du personnel ne doit pas être privé d’un avantage social du fait de l’exercice de son mandat
24/10/2025

Le taux de service actif attaché à l’emploi occupé par le salarié avant qu’il ne soit détaché à 100 % constitue un avantage social de retraite dont il ne peut être privé en raison de l’exercice de ses mandats.
Notre affaire se déroule au sein de la société RTE Réseau de transport d’électricité, une filiale du groupe EDF.
En cause : un dispositif conventionnel de services actifs. Cet accord de branche permet de prendre en compte la pénibilité de certains emplois des industries électriques et gazières (IEG) via un départ anticipé à la retraite en fonction d’un taux de service actif attribué chaque année.
Un accord d’entreprise limitatif
Le problème vient du fait qu’un accord d’entreprise sur le parcours des salariés RTE exerçant des mandats représentatifs et/ou syndicaux limite à 4 ans le maintien du taux de service actif associé à l’emploi d’origine occupé par les salariés avant qu’ils ne soient détachés à 100 % de leur temps de travail en raison de fonctions syndicales ou représentatives.
À l’issue des 4 ans, le bénéfice des services actifs est suspendu jusqu’à la reprise d’une activité « métier ».
À la demande d’une organisation syndicale, cette disposition conventionnelle est jugée discriminatoire.
Dans un arrêt du 1er octobre 2025, la Cour de cassation décide qu’un salarié, titulaire de mandats, ne peut être privé du fait de l’exercice de son mandat d’un avantage social attaché à son emploi. Or, pour les juges, “le taux de service actif attaché à l’emploi occupé par le salarié avant qu’il ne soit détaché à 100 % de son temps de travail en raison de ses différents mandats, syndicaux ou représentatifs, constituait un avantage social dont il ne pouvait pas être privé.
Frédéric Aouate
La partie recettes du projet de loi de finances n’est pas adoptée en commission
24/10/2025
La partie recettes du projet de loi de finances pour 2026 a été rejetée hier par la commission des finances, seuls les députés d’Ensemble ayant voté pour son adoption. Cela fait tomber les amendements adoptés. La commission va maintenant examiner le volet dépenses. Mais ce rejet semble de mauvaise augure pour l’examen en séance publique du texte initial du gouvernement, qui commence ce vendredi 25 octobre à 15h.
Rappelons que ce texte comprend, pour la partie recettes, des dispositions comme :
- une contribution de 50€ pour l’engagement de toute action aux prud’hommes ou devant un tribunal judiciaire ;
- le gel du barème de l’impôt sur le revenu ;
- des augmentations d’impôts pour les entreprises : une taxe sur le patrimoine financier des holdings et la prolongation d’un an de la surtaxe exceptionnelle sur les bénéfices de 400 grandes entreprises ;
- des augmentations d’impôt pour les revenus les plus élevés ;
- des baisses d’impôts pour les entreprises (impôts de production, “CVAE”), etc.
Dans sa partie dépenses, le PLF, qui acte une baisse importante des crédits pour les politiques de l’emploi et du travail, prévoit pour l’instant des mesures comme :
- un plafonnement des dépenses pour des formations non certifiantes via le Compte personnel de formation (CPF) et l’exclusion du financement par le CPF des bilans de compétences ;
- la suppression de l’aide forfaitaire aux apprentis d’un montant de 500 € pour l’inscription au permis de conduire, etc.
Source : actuel CSE
[Veille JO] Les textes parus cette semaine : Conventions internationales, fonction publique, gouvernement, nominations
24/10/2025
Voici un récapitulatif des textes parus au Journal officiel (JO) du vendredi 17 octobre au jeudi 23 octobre inclus, avec les liens renvoyant aux articles que nous avons pu faire sur ces sujets.
► Nous ne traitons pas ici les textes liés aux conventions collectives, car nous vous proposons tous les mois un baromètre des branches sur ces nouveautés.
Conventions internationales
- Loi n° 2025-983 du 22 octobre 2025 autorisant la ratification de la convention n° 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs
Fonction publique
- Un arrêté du 17 octobre 2025 porte renouvellement d’agrément national d’associations et unions d’associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique
Gouvernement
- Un décret du 22 octobre 2025 modifie le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres
Nominations
- Un arrêté du 15 octobre 2025 porte nomination au cabinet de la ministre déléguée auprès de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, chargée de l’autonomie et des personnes handicapées
- Un arrêté du 17 octobre 2025 porte nomination au cabinet de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
- Un arrêté du 21 octobre 2025 porte nomination au cabinet du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat
- Un arrêté du 22 octobre 2025 porte cessation de fonctions et nomination à la présidence de la République
Source : actuel CSE

